These essays are meant to bring information about collectors, collections, and hidden hands to light.
Ces essais ont pour but de mettre en lumière des informations sur les collectionneurs, les collections et les acteurs cachés.
Photo Essay | Essai photographique
Documenting Clovis-Alexandre Desvarieux’s visit to the Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library, October 2023
Documentation de la visite de Clovis-Alexandre Desvarieux à la collection d’histoire naturelle Blacker Wood, bibliothèque McGill, octobre 2023

Written by | écrit par Matthew Barreto
View Essay
Haitian artist Clovis-Alexandre Desvarieux visited McGill University Library in December 2023 as part of an ongoing collaborative effort between the Hidden Hands group and local artists. Clovis’ own work grapples with notions of the sacred, drawing heavily on Haitian mythological and environmental concepts to display and problematize ideas of progress and balance.
Clovis used his cultural expertise and lived experience as a Haitian residing and working in Canada to assist the Hidden Hands group in their study of René-Gabriel de Rabié’s natural history drawings from 18th-century Saint-Domingue. De Rabié’s albums—housed in the Blacker Wood Natural History collection at McGill—comprise vivid recreations of Haiti’s fish, birds, insects, invertebrates and plants. De Rabié’s training as an engineer certainly shines in his use of vivid watercolour and the structural care placed into his various recreations of Saint-Domingue’s wildlife.
Clovis noted a possible motivation for de Rabié’s work, commenting on how, to some degree, he may have acknowledged the environmentally destructive effects of his work on the Island. The various structures he built, along with the plantation lifestyle that dominated the island, necessarily compete with the nature he so meticulously recreated. In doing so, de Rabié may have attempted his own form of preservation in his cataloguing.

The prevalence of plantation culture also betrays the organisation of de Rabié’s collection as an economic botany, favouring sugar, coffee, indigo, and cotton as his first entries. However, with the level of detail he puts into his works, it is clear that—to some degree—he was also falling in love with Saint-Domingue’s lush and varied natural world.
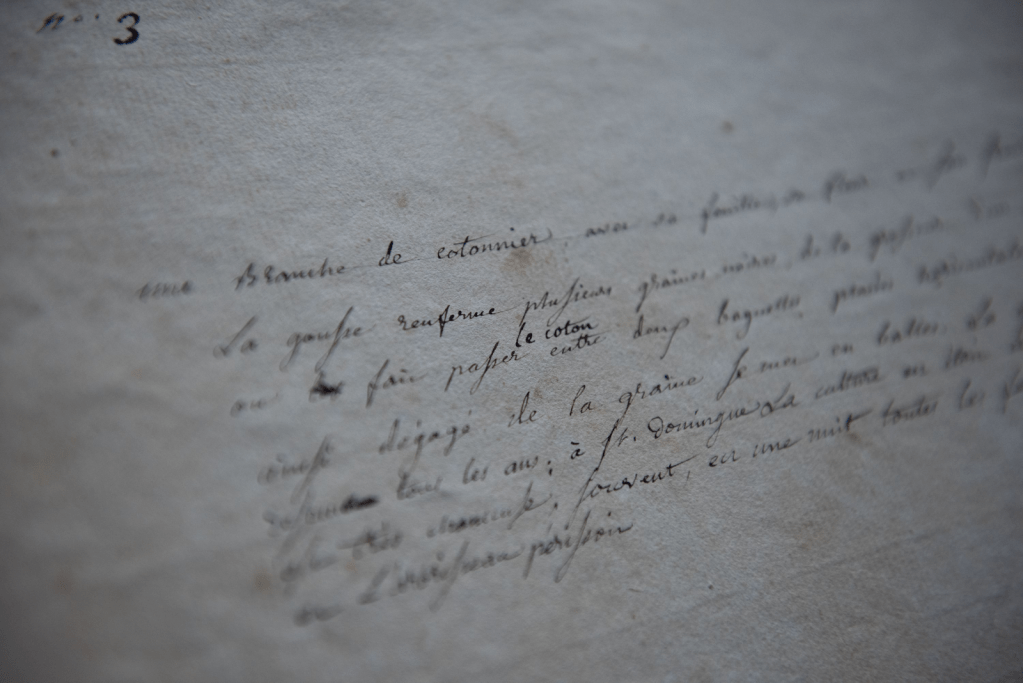
Other images in Fruits album are largely plants that were commonly eaten by either the enslaved, enslavers, or both groups. Long annotations accompany many of the entries in this section discussing the uses of such plants. These annotations were likely done by de Rabié’s daughter Jaquette Rabié de la Boissière, with the aid of her son, following her inheritance of the albums. Daughter and grandson discussed varied topics, from production techniques of cash-crops to which fruits colonial palates favoured, and to some enslaved peoples’ practices with plants.

Victoria Dickenson, the director of the research project at McGill, noted that de Rabié owned a place à vivre in Saint-Domingue, a kind of country home with its own kitchen gardens, tended to by enslaved garçon et femmes de jardin. It is likely that these enslaved workers aided de Rabié in his procurement of his plant specimens, if not collecting them outside his property, then tending to them on the grounds.
Clovis-Alexandre commented that in such an environment, it wouldn’t be uncommon for the bananas, mangos, and papayas that de Rabié painted to be nigh everywhere. Clovis-Alexandre even mentioned that papayas are so stubborn that their trees will grow out of the very concrete!

Akin to the bounty of fruit-bearing plants, Clovis-Alexandre also commented on the high prevalence of butterflies. De Rabié framed his own collection of butterflies under glass. Unfortunately, the existing collections at the Muséum d’histoire naturelle in Paris hold no specimens that might be attributed to de Rabié, but de Rabié’s careful reconstruction of these insects in watercolour remains in his albums. Clovis-Alexandre ruminated on the possible religious implications of butterflies, as—in various cultures within the Atlantic world and beyond—butterflies hold religious importance as vehicles of seasonal change, life, and even reincarnation.

Victoria noted the methodical documentation of insect life cycles, as de Rabié showed the varied stages of caterpillar, pupa, and finally brilliantly coloured butterfly. As with the fruit collection, it is likely that garçon et femmes de jardin assisted with the collection of these specimens. Further, Victoria added that de Rabié’s grandson, Armand-Gabriel Paparel de la Boissière, may have also had a hand in collecting specimens. As a ward of his grandfather from a young age, it is not difficult to imagine a young Armand-Gabriel by his grandfather’s side collecting both bugs and plants for de Rabié to later recreate in watercolour.
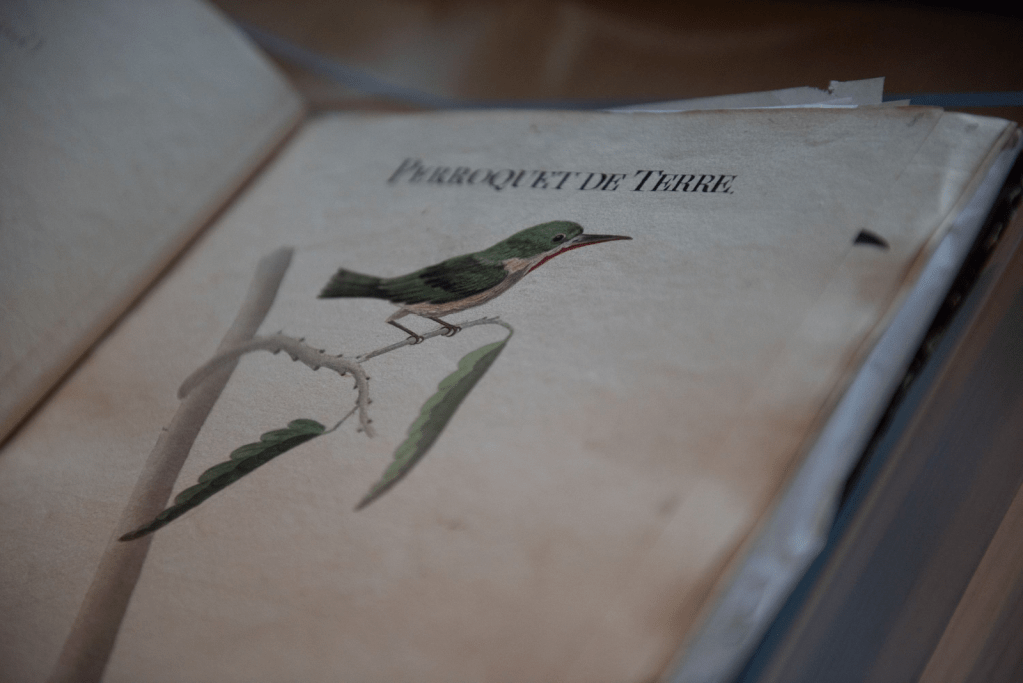
De Rabié’s collection also features many of Saint-Domingue’s birds. Particularly notable is the prevalence of doves in his collection. Clovis-Alexandre stated that his mother in Haiti has taken a habit of leaving grain out for the doves, which flock to his family balcony and grounds in waves to collect their food.
Of particular note in the bird section of the collection, to Clovis, were the Malfini and the Guinea Fowl. The Malfini is a species of hawk commonly thought of as Haiti’s Eagle; it is a massive bird feared by farmers for its particular appetite for chickens. Clovis-Alexandre noted that the gaze of the Malfini can be felt. You may not know where it is, but you can certainly feel its eyes. The Guinea Fowl, as Victoria noted, was likely brought over to the island for game hunting or food. The foreign bird became a symbol of the Duvalier regime in the second half of the 20th century, signifying resilience and an inability to be tamed. Clovis-Alexandre quipped that Duvalier himself was a “foreign bird,” originally coming from Martinique, and being one of the few families in Haiti that cannot trace their roots on the island to the 1791 Haitian Revolution.
Clovis-Alexandre posed a larger commentary on the way these plants, birds, and insects interact. He stated that these three operate in the same ecosystems and propagate each other. The birds feed on the plants and insects, the insects feed on the plants, and the plants in turn rely on their foragers to spread their seeds and continue their life cycles. The three intersect to provide de Rabié the subjects of his work, yet his work on the island places all three at risk.
Much of de Rabié’s work itself took place away from his place à vivre, largely on the coasts of Saint-Domingue. Here de Rabié would aid in building batteries and forts to protect against British encroachment and observe coastal wildlife and plants. A voyage back to France in the mid-1770s also provided apt time to document some of the numerous fish that call the Caribbean and South Atlantic home. De Rabié may have also bought fish from local fishers and canotiers. These enslaved boatmen were frequently advertised for their services in the island’s newspaper Affiches Américaines, and probably captured many of the fish which de Rabié painted in his collection. Clovis-Alexandre noted the practice of fishing in Haiti, where Haitian fishermen masterfully grab fish with their bare hands. De Rabié displayed his own masterful work, capturing the vibrant shades of Saint-Domingue’s fish, which—outside of the water—quickly lose their colour.


Among those fish captured in de Rabié’s collection are the Stingray and Pufferfish, a duo which Clovis-Alexandre suggested may be a good feature for a comic book, one where the pair fight crime, while also teaching of Haiti’s natural environment and the importance of conservation. De Rabié also illustrated a Conch, a sea snail prized for its beautiful shell and for its meat in a type of ceviche-like dish. Clovis-Alexandre told us of the importance of the conch shell within Haitian culture as a symbol of gathering. The shells are blown into, sounding like a horn, and are used to initiate meetings and gatherings. The Conch is also a central symbol of Haitian resistance, with a conch shell being featured in a statue, being blown by the maroon Mackandal—one of the island’s first revolutionary leaders against enslavement in the 1750s.

Towards the end of Clovis-Alexandre’s visit, the conversation surrounding de Rabié’s collection circled back to the centrality of sugar on Saint-Domingue, and to the wider world at the time. Clovis-Alexandre noted that one-third of Europe’s sugar at the time came from Saint-Domingue, with everything from French confectionary goods to people in Saint Petersburg using the product in their coffee. Along with the economic prosperity and luxury goods Saint-Domingue bestowed on Europe, these same processes marked unparalleled damage on the environment and enslaved bodies. The ongoing effects from colonial clear-cutting and soil degradation continue to impact the island’s ecology, and many of the species de Rabié illustrated face mass habitat loss outside of reserves.
Compounding this issue is the island’s increased urbanisation, which naturally challenges both rural lifestyles and Haiti’s plants, animals, and insects. Further, Clovis-Alexandre noted that while the collection makes clear its focus on cash crops and edible plants, those used in medicine and ritual are minor features. Loss of traditional environmental knowledge proves to be an ongoing issue in Haiti. The Hidden Hands group, as well as Le Jardin botanique des Cayes in Haiti, are working together to further understand de Rabié’s collection and translate these findings for a broader audience. While there is still much work to be done, Clovis-Alexandre’s visit offered invaluable first-hand insight on Haiti’s ecology, and is a step forward in engaging with the de Rabié collection in a meaningful way.
This photo essay has discussed the various types of plants and animals contained within the de Rabié collection at McGill University, as well as touched on the relation between Haiti’s past and present. If you have any questions, please feel free to contact us.
Voir l’essai
En octobre 2023, l’artiste haïtien Clovis-Alexandre Desvarieux s’est rendu à la Bibliothèque de l’Université McGill dans le cadre d’une collaboration entre le groupe Hidden Hands et des artistes locaux. Son œuvre aborde les notions du sacré et s’inspire largement des concepts mythologiques et environnementaux haïtiens pour présenter et remettre en question les idées de progrès et d’équilibre.
Clovis a mis à profit son expertise culturelle et son expérience à titre d’Haïtien vivant et travaillant au Canada pour contribuer à l’étude par le groupe Hidden Hands des dessins d’histoire naturelle de René Gabriel de Rabié, réalisés à Saint-Domingue au xviiie siècle. Les albums de René de Rabié, conservés dans la Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill, présentent des reproductions éclatantes de poissons, d’oiseaux, d’insectes, d’invertébrés et de plantes d’Haïti. La formation d’ingénieur de René de Rabié transparaît manifestement dans son utilisation d’aquarelle aux couleurs vives, et dans le soin apporté à la structure de ses différentes reproductions de la faune et de la flore de Saint-Domingue.
Clovis-Alexandre Desvarieux a noté une motivation possible pour le travail de René de Rabié, indiquant que ce dernier a pu, dans une certaine mesure, reconnaître les effets destructeurs de son travail sur l’environnement de l’île. Les différentes structures qu’il a construites, ainsi que le mode de vie dominant sur l’île, qui tournait autour des plantations, sont nécessairement en concurrence avec la nature qu’il a si méticuleusement représentée. René de Rabié a peut-être tenté sa propre forme de conservation en répertoriant la faune et la flore.

La prévalence des cultures de plantation dans cette collection trahit également l’accent mis par le naturaliste sur la botanique économique, le sucre, le café, l’indigo et le coton étant représentés en premier. Le niveau de détail dans ces œuvres, toutefois, montre également un certain amour pour la nature luxuriante et variée de Saint-Domingue.
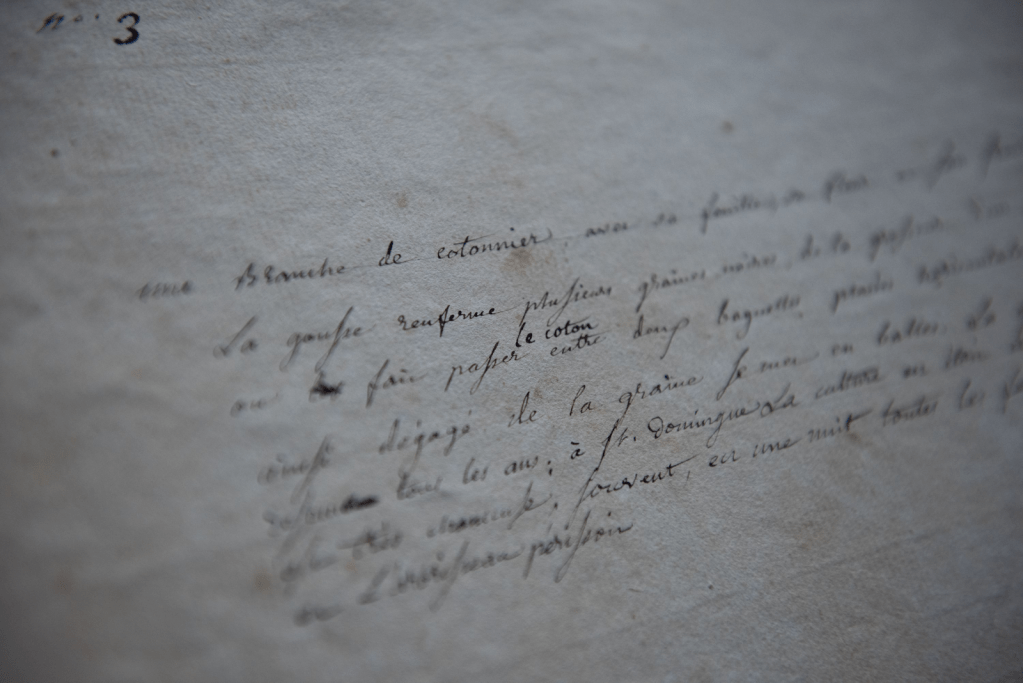
Les autres images de l’album Fruits représentent principalement des plantes couramment consommées par les esclaves ou les esclavagistes. De longues notes décrivant les utilisations de ces plantes accompagnent les nombreuses images de cet album. Ces notes ont probablement été rédigées par la fille de René de Rabié, Jacquette Rabié de la Boissière, avec l’aide de son fils, après qu’elle eut hérité des albums. Les notes de la fille et du petit-fils abordent divers thèmes, dont les techniques de production des cultures commerciales, les fruits préférés des colons et certaines pratiques potagères des esclaves.

Victoria Dickenson, directrice du projet de recherche à l’Université McGill, a souligné que René de Rabié possédait une place à vivre à Saint-Domingue, une sorte de maison de campagne avec ses propres potagers, entretenus par des « garçons et femmes de jardin » en esclavage. Ces esclaves ont probablement aidé René de Rabié à se procurer ses spécimens de plantes, en les cueillant à l’extérieur de sa propriété ou en les cultivant sur ses terrains.
Clovis-Alexandre Desvarieux a fait remarquer que les bananes, les mangues et les papayes peintes par de Rabié étaient probablement présentes un peu partout aux alentours de la maison, et ajouté que les papayers sont si résistants qu’ils poussent même à travers le béton!

Clovis-Alexandre a également commenté la forte présence de papillons dans l’œuvre de René de Rabié, qui possédait une collection de papillons sous verre. Malheureusement, les collections existantes du Muséum d’histoire naturelle de Paris ne contiennent aucun spécimen qui lui aurait appartenu, mais la représentation minutieuse de ces insectes à l’aquarelle subsiste dans les albums du naturaliste. Clovis-Alexandre a mentionné les possibles connotations religieuses des papillons, car dans diverses cultures, notamment dans l’Atlantique, les papillons sont le symbole religieux du changement saisonnier, de la vie et même de la réincarnation.

Victoria Dickenson a noté que René de Rabié consignait méthodiquement le cycle de vie des insectes : il a montré les différentes étapes de la chenille, de la chrysalide et, enfin, du papillon aux couleurs éclatantes. Comme pour la collection de fruits, il est probable que les « garçons et femmes de jardin » aient participé à la collecte de ces spécimens. La directrice a ajouté que le petit-fils de René de Rabié, Armand Gabriel Paparel de la Boissière, a peut-être également participé à cette collecte. Sous la tutelle de son grand-père depuis son plus jeune âge, le jeune Armand Gabriel a pu chercher les insectes et les plantes que de Rabié a reproduit à l’aquarelle.
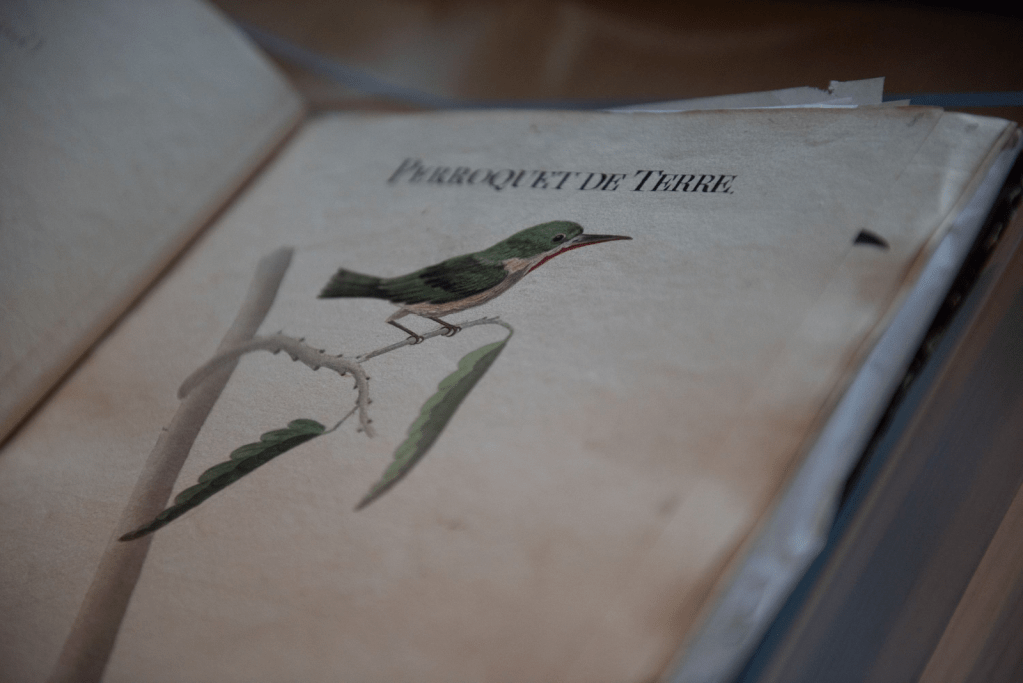
La collection de René Gabriel de Rabié montre également de nombreux oiseaux de Saint-Domingue. On y remarque notamment la prédominance des colombes. Clovis-Alexandre Desvarieux a indiqué qu’en Haïti, sa mère a pris l’habitude de laisser des graines pour les colombes, qui affluent en masse sur le balcon et les terrains de sa famille pour se nourrir.
Dans la partie de la collection consacrée aux oiseaux, Clovis s’est particulièrement intéressé au « malfini » et à la pintade. Le malfini est une espèce de buse communément considérée comme l’aigle d’Haïti; c’est un oiseau imposant redouté par les agriculteurs en raison de son appétit particulier pour les poulets. Clovis-Alexandre a fait remarquer que sans savoir où le malfini se trouve, on peut sentir sur soi le regard de l’oiseau. La pintade, comme l’a fait remarquer Victoria Dickenson, a probablement été introduite sur l’île pour la chasse ou pour l’alimentation. Cet oiseau étranger, symbole de la résilience et de la résistance à l’apprivoisement, est devenu l’emblème du régime Duvalier dans la seconde moitié du xxe siècle. Clovis-Alexandre a fait remarquer avec humour que Duvalier lui-même était un « oiseau étranger », originaire de Martinique, et que sa famille était l’une des rares en Haïti dont les racines sur l’île ne remontent pas à la révolution haïtienne de 1791.
L’artiste a commenté plus généralement les interactions entre les plantes, les oiseaux et les insectes. Il a déclaré que ces trois groupes fonctionnent dans les mêmes écosystèmes et contribuent à leur propagation mutuelle. Les oiseaux se nourrissent de plantes et d’insectes, les insectes se nourrissent de plantes, et les plantes dépendent des insectes butineurs, qui dispersent leurs graines et permettent la poursuite de leur cycle de vie. Ces groupes interagissaient pour fournir à René de Rabié les sujets de son travail sur l’île, mais ce travail les mettait en danger.
Une grande partie du travail de René Gabriel de Rabié s’est déroulée loin de sa « place à vivre », principalement sur les côtes de Saint-Domingue. C’est là qu’il contribuait à la construction de batteries et de forts, qui protégeaient l’île contre l’empiétement britannique et permettaient l’observation de la faune et de la flore côtières. Un voyage vers la France au milieu des années 1770 lui a également permis de documenter certains des nombreux poissons qui peuplent les Caraïbes et le sud de l’Atlantique. Il a peut-être également acheté du poisson à des pêcheurs locaux et à des « canotiers », bateliers esclaves qui étaient souvent proposés à la vente dans le journal de l’île, Affiches américaines, et ont probablement capturé bon nombre des poissons de la collection de Rabié. Clovis-Alexandre a indiqué que les pêcheurs haïtiens attrapent les poissons à mains nues, avec brio. René de Rabié a montré son propre brio en capturant les coloris vifs des poissons de Saint-Domingue, qui, hors de l’eau, perdent rapidement leur couleur.


Parmi les poissons de la collection de Rabié figurent la raie pastenague et le poisson-globe, qui, comme le souligne Clovis-Alexandre Desvarieux, pourraient faire l’objet d’une bande dessinée dans laquelle le duo lutterait contre le crime tout en sensibilisant le public à l’environnement naturel d’Haïti et à l’importance de sa préservation. Le naturaliste a également illustré une conque, limace de mer estimée pour sa superbe coquille et sa chair, dont on fait un plat qui rappelle le ceviche. Clovis-Alexandre nous a expliqué l’importance de la conque dans la culture haïtienne en tant que symbole de rassemblement. On souffle dans ces coquillages, qui produisent un son semblable à celui d’un cor, pour annoncer le début des réunions et des rassemblements. La conque est également un symbole central de la résistance haïtienne, puisqu’une statue de l’esclave marron Mackandal, l’un des premiers chefs de la révolution contre l’esclavage sur l’île dans les années 1750, montre celui-ci en train de souffler dans un de ces coquillages.

Vers la fin de la visite de Clovis-Alexandre Desvarieux, la conversation entourant la collection de Rabié est revenue sur l’importance du sucre à Saint-Domingue et dans le monde entier à cette époque. Clovis-Alexandre a fait remarquer qu’un tiers du sucre européen provenait alors de Saint-Domingue, et que tout le monde en consommait, des confiseurs français aux habitants de Saint-Pétersbourg, qui en mettaient dans leur café. Les processus qui permettaient la prospérité économique de l’Europe et son approvisionnement en produits de luxe ont causé des dommages sans précédent à l’environnement et aux esclaves de Saint-Domingue. Les effets persistants de la déforestation et de la dégradation des sols causées par la colonie continuent de nuire à l’environnement de l’île, et de nombreuses espèces illustrées par René de Rabié doivent composer avec la perte de leur habitat en dehors des réserves naturelles.
L’urbanisation croissante de l’île représente également un défi pour le mode de vie rural, ainsi que pour la faune et la flore d’Haïti. Clovis-Alexandre a aussi noté que la collection met l’accent sur les cultures commerciales et les plantes comestibles, mais donne peu de place aux plantes utilisées en médecine et dans les rituels. La perte des connaissances traditionnelles sur l’environnement est un problème persistant en Haïti. Le groupe Hidden Hands collabore avec le Jardin botanique des Cayes en Haïti pour mieux étudier la collection de René de Rabié et transmettre les conclusions de cette étude à un public plus large. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, la visite de Clovis-Alexandre a fourni de précieux renseignements de première main sur l’environnement d’Haïti, et constitue un pas en avant dans l’exploitation significative de la collection de Rabié.
Ce reportage photo a abordé les différents types de plantes et d’animaux que contient la collection de Rabié à l’Université McGill, ainsi que la relation entre le passé et le présent d’Haïti. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire ici.
The French Colony of Saint Domingue | La colonie française de Saint-Domingue
1665 – 1804
Written by | écrit par Dr. James E. McClellan III
View Essay
Located on the western third of the island of Hispaniola in the Caribbean today occupied by the country of Haiti, the great and terrible French colony of Saint Domingue was overthrown amid the turmoil the French and Haitian revolutions. Never resuscitated, never reincarnated, the colony has all but vanished from the pages of history.1
As incredible as it might seem, in its heyday in the last decades of the eighteenth century tiny Saint Domingue was the single richest and most productive European colony anywhere. It was the world’s leading producer of both sugar and coffee and an important source of cotton and indigo, all valuable commodities. Unrivaled by any other overseas European outpost, Saint Domingue produced more wealth than the whole of the Spanish empire in the Americas. Saint Domingue was not the only contemporary European colony of note, and France was hardly the only colonial power in the eighteenth century, but Saint Domingue was nevertheless the jewel in the crown of the contemporary European colonial enterprise.
Tiny it was, about the size of Maryland in the United States or Belgium in Europe and less than half the size of the Canadian province of Nova Scotia. Considering its mountainous topography, the effective terrain for colonial development on the plains of Saint Domingue was even smaller.
How to account for the astonishing wealth and productivity of old Saint Domingue? The key to understanding the colony’s “success” lies in the fact that the eighteenth-century French colony was the most intense slave-based society ever to have existed. The white population of Saint Domingue in 1789 numbered only about 32,000 souls. Another 28,000 mixed race and free Black people lived the colony. To these figures, one needs add an extraordinary number: 500,000 Black enslaved people, almost 90% of the population, two-thirds born in Africa, who toiled beneath the tropical sun in Saint Domingue. (The total population of Saint Domingue thus about equaled that of contemporary New York or Pennsylvania, the two most populous states in the new United States.) In dramatic contrast, a total of only 700,000 enslaved people inhabited the whole of the United States in 1790, and only sixty percent of people in the most heavily slave state, South Carolina, were enslaved.
The 1780s marked the height of the slave trade. The French slave trade was the third largest after the Portuguese and the British but dominated the market for enslaved people in French possessions. In that decade alone 1,100 expeditions brought to the French West Indies 370,000 enslaved people destined for a life of bitter servitude.
Unimaginable violence underpinned the colony and propelled the economic efflorescence of Saint Domingue. The “Code Noir” issued by Louis XIV in 1685 nominally protected human chattel, but only to the most minimal extent. In the end, it is no surprise that history’s largest and most successful uprising against slavery began on Saint Domingue in 1791 and culminated with the creation of the Republic of Haiti in 1804, the second independent country in the Western Hemisphere after the United States.
The French came late to Hispaniola. Meanwhile, as many as three million indigenous Taíno speakers of Arawak inhabited the island when Columbus first landed in 1492. Within two decades the Spanish had virtually exterminated the Taíno and their culture. In 1605, as their holdings developed elsewhere in the Caribbean, the Spanish withdrew from the western part of Hispaniola, thereby inadvertently creating a no-man’s land and allowing the region to become wholly wild. Into this lush and uninhabited niche slipped the next people to develop Saint Domingue: the pirates!
The French had established colonies on Martinique and Guadeloupe by the 1630s, but only in 1665 did the government of Louis XIV and Colbert lay a tenuous claim to Saint Domingue. Only with the Treaty of Ryswick in 1697 did the major European powers recognize French sovereignty over Western Hispaniola, and even up until the Treaty of Utrecht in 1713, the incipient French colony of Saint Domingue remained weak and marginal with minimal urbanization, with tobacco still the main cash crop, and with a dearth of women. But with peace and the death of Louis XIV in 1715 a new era dawned in Saint Domingue.
Slowly over the succeeding decades, the full armamentaria of French government and French social institutions implanted themselves in Saint Domingue: The French Catholic Church; an administration typical of any French province with a Governor-General and an Intendant; the Armée royale on land and the Royal Navy – the Marine royale – superintending the ports; and the full gamut of legal and judicial institutions. Urbanization grew rapidly, especially after 1750, with real cities in the three administrative departments of the colony: Cap François on the northern coast, Port-au-Prince in the center, and Les Cayes in the south. The respective populations of these three urban centers in 1789 stood at 18,500, 9,400, and 5,600, making Cap François the same size as Dijon in France or Boston in North America. In Cap François especially all the elements of eighteenth-century French urban life manifested themselves: a big church, fountains, public squares, government buildings, military barracks and parade grounds, public baths and laundry facilities, a cemetery, slaughterhouses, bakeries, a convent, poorhouses, a prison, a big hospital, a theater, reading rooms, a dance hall, brothels, bars and gambling houses, a press issuing a twice-weekly newspaper, Masonic lodges, a chamber of commerce, and ultimately, like so many other provincial centers back in the motherland, a royal scientific society, the Cercle des Philadelphes, launched in 1784 and officially recognized as the Société royale des sciences et des arts du Cap François in May of 1789.
Saint Domingue was of the highest economic importance to France. Two thirds of French overseas investments flowed there, and one third of all French foreign trade took place with the colony. One person in eight in France – over three million people – earned their livelihoods in some way connected with colonial trade. France saw a positive balance of trade with Saint Domingue, and colonial goods constituted nearly half of the totality of French exports. Taxes and duties brought millions into the coffers of the French state and the government of Louis XVI.
The French state thus did everything in its power to strengthen and develop its colony in Saint Domingue. To that end, specialized expert knowledge became a key instrument of colonial development, and to harness that power the state tapped a broad range of specialized organizations and experts that it underwrote in several royal institutions back in France. To understand the career of René de Rabié, it is essential to grasp these efforts.
The French Ministry of the Navy and the Colonies at Versailles and the huge Royal Navy itself were important constituents of this “colonial machine,” to be sure, but more in particular the Académie royale de Marine founded in Brest in 1752 served as a locus of expert nautical knowledge. An example of the Navy’s work would be the cartographical expedition of 1784-1785 sent by the ministry to accurately chart Saint Domingue and its waters using the new marine chronometer.
The Royal Navy possessed an extensive body of its own medical personnel, and colonial civil authorities installed additional cadres of paid royal physicians, surgeons, apothecaries, midwives and veterinarians throughout the colony, and they licensed other private practitioners to work in the colony. The Société royale de médecine (1776) in Paris and, through it, the Académie royale des sciences (1666) worked closely and extensively with the Cercle des Philadelphes to investigate diseases rampant in the colonies, including those especially affecting enslaved people. (Parallel to these developments, enslaved people brought into the colony carried with them traditional medicines and healing arts from Africa, including inoculation against smallpox, and a separate slave medicine and pharmacopeia flourished in the countryside; white physicians and surgeons sometimes turned to these highly illegal practices as a last resort.) After the smallpox epidemic of 1771, the practice of inoculation by European inoculators became widespread, much more so than in France itself, not least because enslaved people were considered valuable property.
Organized by the Jardin du Roi, the royal botanical garden in Paris, and the Académie royale des sciences and as part of an extensive network of French royal botanical gardens in Martinique, Guadeloupe and Cayenne in the Americas and other French colonial outposts in the Indian Ocean, the government orchestrated significant efforts to secure, propagate, and commercialize the production of valuable plant commodities, such as cloves and nutmeg. To this end it created and staffed the position of botaniste du Roi in various colonial outposts, and over the years several botanical gardens dedicated to economic botany appeared in Port-au-Prince and in Cap François. One shipment from the Indian Ocean, for example, arrived in Saint Domingue in 1788 with a cargo of pepper plants, cinnamon trees, mango trees, mangosteen fruit, and a few breadfruit trees from Tahiti, the latter particularly welcomed as a food source for slaves. One unique feature of the story of economic botany in Saint Domingue involved an expedition to steal the domesticated cochineal insect that made such a vivid red dying agent from the Spanish in Mexico, the outcome of which launched cochineal dye production in Saint Domingue. Authorities made similar moves to initiate new branches of animal husbandry as well.
It is against this background of the state tapping expertise in support of colonial development that the long career of René de Rabié in Saint Domingue from the 1740s into the 1780s is to be understood. He came to Saint Domingue in 1739, and for more than four decades in his day job he functioned as a royal military engineer building up the colony’s civil and military infrastructure. (He left the colony in 1784 and died in France in 1785.) In that sense de Rabié was a small cog in the larger colonial machine, which makes sense in terms of the dynamic of the colony’s history outlined here. On the other hand, how to account for the extraordinary and voluminous scientific work de Rabié did on the side in botany and natural history is another story that remains harder to elucidate. His astounding watercolors of the birds, fish, crustaceans, mollusks, insects and plants of Saint Domingue in particular – now held in four volumes in the Rare Books and Special Collections branch at McGill Library – challenge us not only to account for this private aspect of de Rabié’s life as a naturalist in Saint Domingue but also to uncover the unsung, but essential “hidden hands” that helped bring it all into being.
References
1 This brief account is based on James E. McClellan III, Colonialism & Science: Saint Domingue in the Old Regime (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992; [With a New Forward by Vertus Saint-Louis], Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010) and James E. McClellan III and François Regourd, The Colonial Machine: French Science and Overseas Expansion in the Old Regime (Turnhout, BE: Brepols, 2012).
Voir l’essai
Située dans le tiers occidental de l’île d’Hispaniola, dans les Caraïbes, aujourd’hui occupé par le pays d’Haïti, la « grande et terrible » colonie française de Saint-Domingue a été renversée dans la tourmente des révolutions française et haïtienne. Jamais ressuscitée, jamais réincarnée, la colonie a pratiquement disparu des pages de l’Histoire.1
Aussi incroyable que cela puisse paraître, à son apogée, dans les dernières décennies du xviiie siècle, la petite Saint-Domingue était la colonie européenne la plus riche et la plus productive au monde. Elle occupait le premier rang mondial pour la production de sucre et de café et était une importante source de coton et d’indigo, matières premières très prisées. Avant-poste européen d’outre-mer inégalé, Saint-Domingue produisait plus de richesses que l’ensemble de l’empire espagnol en Amérique. Elle n’était pas la seule colonie européenne notable de l’époque, et la France n’était pas la seule puissance coloniale du xviiie siècle, mais Saint-Domingue était néanmoins le joyau de la couronne de l’entreprise coloniale européenne.
Elle était minuscule, de la taille du Maryland aux États-Unis ou de la Belgique en Europe, moins de la moitié de celle de la Nouvelle-Écosse. Compte tenu de son relief montagneux, la superficie pouvant être aménagée pour permettre l’essor de la colonie dans les plaines de Saint-Domingue était encore plus réduite.
Comment expliquer la richesse et la productivité étonnantes de l’ancienne Saint-Domingue? La clé pour comprendre le « succès » de cette colonie française du xviiie siècle réside dans le fait qu’il n’y a jamais existé de société dans laquelle l’esclavage était aussi courant. En 1789, la population blanche de Saint-Domingue ne comptait qu’environ 32 000 âmes. Quelque 28 000 personnes métisses et noires libres vivaient également dans la colonie. À ces chiffres, il faut ajouter un nombre extraordinaire : 500 000 esclaves noirs, soit près de 90 % de la population, dont les deux tiers étaient nés en Afrique, travaillaient sous le soleil tropical de Saint-Domingue. La population totale de Saint-Domingue était donc à peu près égale à celle de chacun des deux États les plus peuplés des États-Unis à l’époque, New York et la Pennsylvanie. Contraste frappant, l’ensemble des États-Unis ne comptait que 700 000 esclaves en 1790, et 60 % seulement de la population de l’État le plus esclavagiste, la Caroline du Sud, était composée d’esclaves.
C’est dans les années 1780 que l’apogée de la traite des esclaves est atteint. La traite française est alors au troisième rang en importance, après les traites portugaise et britannique, mais elle domine le marché des esclaves dans les possessions françaises. Au cours de cette seule décennie, 1 100 expéditions amènent dans les Antilles françaises 370 000 esclaves destinés à une vie amère de servitude.
Une violence inimaginable règne alors dans la colonie et alimente l’essor économique de Saint-Domingue. Le « Code noir » promulgué par Louis XIV en 1685 protégeait théoriquement, mais minimalement les êtres humains considérés comme des biens mobiliers. Il n’est donc pas surprenant que le soulèvement contre l’esclavage le plus important de l’histoire ait commencé à Saint-Domingue en 1791 et ait abouti à la création en 1804 de la République d’Haïti, deuxième pays indépendant de l’hémisphère occidental après les États-Unis.
Les Français arrivent tardivement en Hispaniola. Pas moins de trois millions d’autochtones taïnos, qui parlaient l’arawak, peuplaient déjà l’île lorsque Christophe Colomb y débarque pour la première fois en 1492. En vingt ans, les Espagnols exterminent pratiquement les Taïnos et leur culture. En 1605, alors que leurs possessions prospèrent ailleurs dans les Caraïbes, les Espagnols se retirent de la partie occidentale d’Hispaniola, créant ainsi par inadvertance un no man’s land, et le laissant à l’état sauvage. C’est dans ce coin luxuriant et inhabité que s’installent les prochains colons de Saint-Domingue : les pirates!
Les Français établissent des colonies en Martinique et en Guadeloupe dès les années 1630, mais ce n’est qu’en 1665 que le gouvernement de Louis XIV et Colbert revendique timidement Saint-Domingue. Ce n’est que par le traité de Ryswick en 1697 que les grandes puissances européennes reconnaissent la souveraineté française sur l’ouest d’Hispaniola, et la colonie française naissante de Saint-Domingue reste faible et marginale jusqu’au traité d’Utrecht en 1713. Son urbanisation est minimale, le tabac est sa principale culture commerciale et on n’y compte que peu de femmes. Mais la paix et la mort de Louis XIV en 1715 ouvrent une nouvelle ère à Saint-Domingue.
Au cours des décennies suivantes, l’appareillage complet du gouvernement français et des institutions sociales françaises s’implante progressivement à Saint-Domingue : une administration typique de toute province française avec un gouverneur général et un intendant, l’Église catholique française, l’Armée royale sur terre, la Marine royale surveillant les ports, et toute la gamme des institutions juridiques et judiciaires. L’urbanisation s’accélère, surtout après 1750, avec l’émergence de véritables villes dans les trois départements administratifs de la colonie : Cap-Français sur la côte nord, Port-au-Prince au centre et Les Cayes au sud. En 1789, ces trois centres urbains comptent respectivement 18 500, 9 400 et 5 600 habitants, ce qui fait de Cap-Français une ville de la taille de Dijon en France ou de Boston en Amérique du Nord. Cap-Français, en particulier, réunit tous les éléments de la vie urbaine française du xviiie siècle : une grande église, des fontaines, des places publiques, des bâtiments gouvernementaux, des casernes militaires et des terrains de parade, des bains publics et des lavoirs, un cimetière, des abattoirs, des boulangeries, un couvent, des dépôts de mendicité, une prison, un grand hôpital, un théâtre, des salles de lecture, une salle de danse, des maisons closes, des bars et des maisons de jeu, une imprimerie qui publie un journal bihebdomadaire, des loges maçonniques, une chambre de commerce et, enfin, comme tant d’autres centres provinciaux de la mère patrie, une société scientifique royale, le Cercle des Philadelphes, fondée en 1784 et officiellement reconnue comme Société royale des sciences et des arts du Cap-Français en mai 1789.
Saint-Domingue revêtait une importance économique capitale pour la France. Les deux tiers des investissements français à l’étranger y étaient destinés, et un tiers du commerce extérieur français était réalisé avec cette colonie. En France, une personne sur huit tirait ses revenus d’une activité liée au commerce colonial, ce qui représente plus de trois millions de personnes. La France affichait une balance commerciale positive avec Saint-Domingue, et les produits des colonies représentaient près de la moitié des exportations françaises. Les taxes et les droits de douane rapportaient des millions aux caisses de l’État français et au gouvernement de Louis XVI.
L’État français faisait donc tout ce qui était en son pouvoir pour renforcer et développer sa colonie de Saint-Domingue. Les connaissances spécialisées sont ainsi devenues un instrument clé de la croissance des colonies, et pour exploiter ces connaissances, l’État a fait appel à un large éventail d’organisations spécialisées ainsi qu’à des experts de plusieurs institutions royales de France, qu’il finançait. Pour comprendre la carrière de René de Rabié, il est essentiel de comprendre ces efforts.
Le ministère français de la Marine et des Colonies à Versailles et l’énorme Marine royale elle-même étaient certes des éléments importants de cette « machine coloniale », mais c’est surtout l’Académie royale de Marine, fondée à Brest en 1752, qui servait de centre d’expertise en navigation. Un exemple du travail de la Marine est l’expédition cartographique de 1784-1785 organisée par le ministère visant la cartographie précise de Saint-Domingue et de ses eaux à l’aide du nouveau chronomètre de marine.
La Marine royale disposait d’un vaste personnel médical interne, et les autorités civiles coloniales ont mis en place dans toute la colonie des équipes rémunérées de médecins, de chirurgiens, d’apothicaires, de sages-femmes et de vétérinaires, et ont accordé des permis d’exercice à d’autres praticiens privés. La Société royale de médecine (1776) à Paris et, par son intermédiaire, l’Académie royale des sciences (1666) ont collaboré étroitement avec le Cercle des Philadelphes à l’étude des maladies qui sévissaient dans les colonies, notamment celles qui touchaient surtout les esclaves. À la même période, les esclaves amenés dans la colonie apportaient des médicaments traditionnels et des techniques de guérison africaines, notamment l’inoculation contre la variole. Les esclaves dans les campagnes employaient une médecine et une pharmacopée distinctes, pratiques illégales vers lesquelles les médecins et chirurgiens blancs se tournaient parfois en dernier recours. Après l’épidémie de variole de 1771, les Européens dans la colonie ont progressivement adopté la pratique de l’inoculation, bien davantage qu’en France, notamment parce que les esclaves étaient considérés comme des biens précieux.
Le gouvernement a orchestré d’importants efforts pour obtenir, propager et commercialiser des plantes précieuses, comme le clou de girofle et la noix de muscade. Ces efforts étaient organisés par le Jardin botanique du Roi et l’Académie royale des sciences, dans le cadre d’un vaste réseau de jardins botaniques royaux français en Martinique, en Guadeloupe et à Cayenne dans les Amériques, ainsi que dans d’autres avant-postes coloniaux français dans l’océan Indien. Le poste de botaniste du Roi a ainsi été créé et pourvu dans divers avant-postes coloniaux, et au fil des ans, plusieurs jardins consacrés à la botanique économique ont vu le jour à Port-au-Prince et à Cap-Français. Une cargaison provenant de l’océan Indien, par exemple, est arrivée à Saint-Domingue en 1788 avec un chargement de poivriers, de canneliers, de manguiers, de mangoustans et de quelques arbres à pain de Tahiti, ces derniers étant particulièrement appréciés comme source de nourriture pour les esclaves. L’histoire de la botanique économique à Saint-Domingue présente une curiosité : une expédition au Mexique a été organisée pour voler aux Espagnols la cochenille domestiquée qui servait à fabriquer un colorant rouge vif, ce qui a permis le lancement d’une production de teinture à base de cochenilles à Saint-Domingue. Des mesures similaires ont été prises par les autorités pour obtenir de nouveaux animaux d’élevage.
L’État exploitait donc l’expertise de ses citoyens pour soutenir l’expansion coloniale, et c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la longue carrière de René de Rabié à Saint-Domingue, des années 1740 aux années 1780. Arrivé à Saint-Domingue en 1739, il a exercé pendant plus de quarante ans le rôle d’ingénieur militaire royal, chargé de construire les infrastructures civiles et militaires de la colonie (il a quitté la colonie en 1784 et est mort en France en 1785). En ce sens, de Rabié était un petit rouage dans la grande machine coloniale, ce qui est logique au regard de l’histoire de la colonie décrite ici. D’un autre côté, comment expliquer le travail scientifique extraordinaire et volumineux que René de Rabié a accompli en parallèle dans les domaines de la botanique et de l’histoire naturelle? C’est une autre histoire qui reste plus difficile à élucider. En particulier, ses aquarelles étonnantes d’oiseaux, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’insectes et de plantes de Saint-Domingue, aujourd’hui conservées en quatre volumes à la division Livres rares et collections spéciales de la Bibliothèque de l’Université McGill, nous poussent à réfléchir sur cet aspect privé de sa vie de naturaliste à Saint-Domingue, mais aussi à découvrir les « mains invisibles » méconnues, mais essentielles, qui ont contribué à donner vie à cette œuvre.
James E. McClellan III
References
1 Ce bref compte rendu est basé sur James E. McClellan III, Colonialism & Science: Saint Domingue in the Old Regime (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992; [With a New Forward by Vertus Saint-Louis], Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010) et James E. McClellan III and François Regourd, The Colonial Machine: French Science and Overseas Expansion in the Old Regime (Turnhout, BE: Brepols, 2012).
René-Gabriel de Rabié (1717-85)
Ingénieur du Roi et Naturaliste, Saint Domingue
Biography | Biographie
Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson
View Essay
René Gabriel de Rabié was born on 14 June 1717 in Rochefort, France, to the merchant Gabriel Rabié and his wife Marguerite Moine [also Moinne or Moyne]. Rochefort was established by Louis XIV as an arsenal and shipyard for the French Navy. Construction of the Arsenal began in 1666, and the town was laid out “en damier” or in a checkerboard pattern, surrounded by ramparts. “La Corderie” or Rope Walk, where ropes were manufactured for the navy, was constructed between 1666 and 1669, and at 374 metres in length, was one of the longest buildings in Europe at the time.
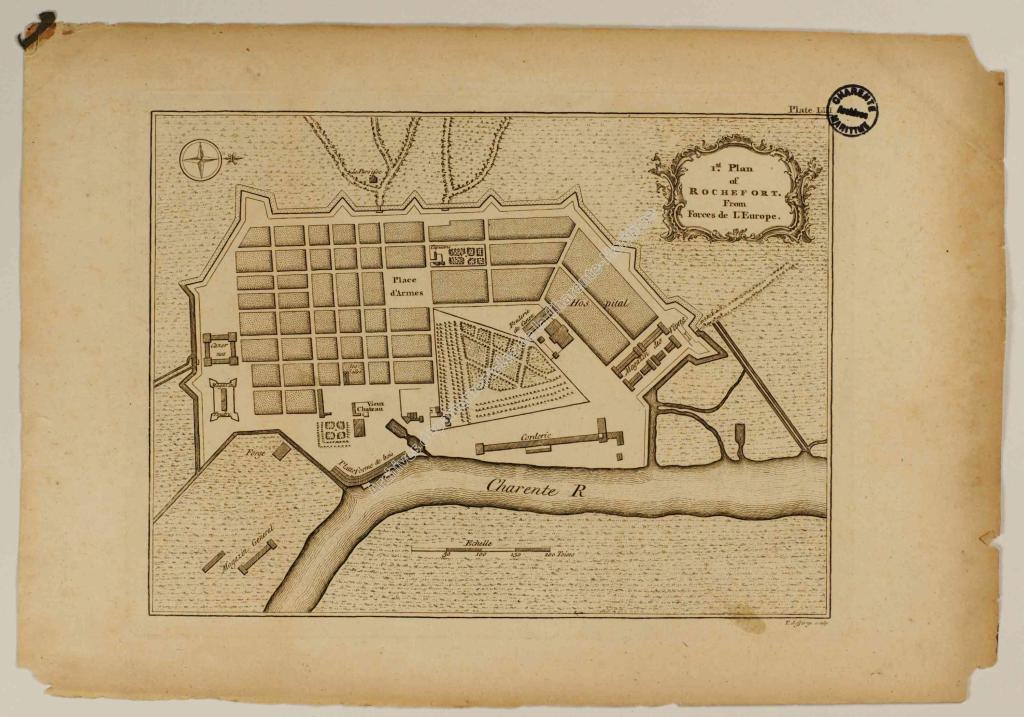
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, France. http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/56ae409f4123700478cbed126d64c376
Rochefort was a major port of embarkment for North America and the Caribbean. Although not as significant as La Rochelle, Nantes or Bordeaux, Rochefort was also a slaving port. Merchants and shipowners in Rochefort participated both in the transport of “les engagés” (Europeans indentured for 3 years – “les 36 mois”) as well as “la traite négrière” (slave trade).1
Training as an Engineer
Prior to the establishment of the École royale du génie (Royal school of engineering) at Mezières in 1748, would-be engineers followed a course of study often under the tutelage of their father or other relatives already working as engineers. René Gabriel’s father was not an engineer but a metalworker or supplier of metal fittings, likely serving the needs of the Arsenal or shipyards; he would have recognized his son’s aptitude for a career with the corps of engineers associated with the Marine (Navy).
René Gabriel himself outlined his training and education in a letter written in 1753: “In 1739, after several years of drawing and three years of mathematics, I served three years at Rochefort as a “volunteer” [intern] under M. Lefebvre Chief engineer.”2 Like other aspirants, René Gabriel studied mathematics and drawing, and acquired the skills required to draw and read a map, use measuring and surveying instruments, and prepare topographical sketches and descriptions. His formal education was followed by an internship, which he served under the Ingénieur en chef (Chief engineer) of Rochefort, likely Joseph Étienne Lefebvre de Bréron (1701-65).
Even after years of study and expense – in de Rabié’s case at least 8 or 9 years – there was no guarantee of a position as an “ingénieur ordinaire de Sa Majesté” (an officer-engineer). At this period, there were about 300 military engineers in France, the number fluctuating with increases during wartime. Between 1716 and 1739, a time of relative peace when de Rabié finished his internship, there were four times as many candidates as available positions. Many who had completed their studies and internship sought positions outside France, in the colonies or with the Compagnie des Indes.3 In 1742, the 25-year-old de Rabié sailed for Saint Domingue.
In the 1770s, after thirty years of service, de Rabié became the chief engineer for the town of Cap Français in Saint Domingue. He designed many of the public monuments and buildings in Le Cap (as it was known), including the Hôpital de la Charité with its parterres and fountains as well as two plans for Versailles-style bosquets (forest groves) for the grounds of the Maison du gouverneur. He was also the architect for the re-building (1772–74) of the second-largest church in the Atlantic Empire, Notre-Dame-de-l’Assomption on the Place d’Armes in Le Cap, the original partially destroyed by an earthquake in 1771.

Despite his skill and accomplishments, de Rabié was constantly frustrated in his efforts for promotion, and his correspondence documents his setbacks and successes. In 1758, he received his Brevet or commission as “ingénieur”, something he had been promised in 1755. In 1773, he became a colonel, and finally ended his career in 1784 as a Brigadier, with an annual salary of 8000 livres. His struggles for promotion and recognition were typical of the problems encountered by the members of the corps of engineers at this period.
Family Life
René de Rabié arrived in Saint Domingue in 1742 a bachelor, but sometime before 1749, he married Anne Le Bon. Le Bon or Lebon is a name associated with a large “Créole” family in Saint Domingue.4 In the context of Saint Domingue in the 18th century, the term “Créole” referred to a person born in the colony, and could comprise residents of European, African or mixed descent.5 By 1760, the de Rabié family – at least four or five children, husband and wife, and their enslaved servants – were living near the Hôpital de la Charité, on the “chemin du haut du Cap”, close to a Le Bon family property.6 Four of the children survived to adulthood, Jacquette or Jaquette Marie Anne, born on 17 May 1750; Pierre René, born 1 January 1754; Jean Joseph (Duverger), born 4 September 1757; and Louise Constance, born 24 April 1763.
The de Rabié family was intimately connected with the military life of the colony. As a member of the Croix de Saint Louis (1771), a Colonel (1773), and later the Ingénieur en chef de la partie nord (Chief engineer for the north sector), de Rabié himself became one of les “grands blancs”, the elite of Saint Domingue. De Rabié’s sons also joined the military. Thanks to their father’s solicitations, Pierre René became a Captain in the Régiment du Cap, and his brother Jean Joseph, a captain in the artillery in the colony.7 Both sons died in Saint Domingue in their mid-thirties, Pierre René in 1790 and Jean Joseph in November 1791.
De Rabié’s eldest daughter Jaquette Anne Marie married Claude-François Paparel de la Boissière (c1740-c1782) in 1767. The de la Boissière family owned a coffee plantation at Marmelade near Le Cap. In 1780, de Rabié’s youngest daughter, the seventeen-year-old Louise-Constance, married Louis-Alexandre Longuet de Monplaisir (b. 1757 in Nantes), who worked as a draftsman/engineer for de Rabié. In 1786 Longuet fell ill and died in 1788. Louise Constance married again in 1796 in Edenton, South Carolina, where she had moved after the Haitian Revolution. Her marriage to Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, the Baron de Nuits (b. 1757) was short-lived as both perished in a shipwreck off the Azores on 11 November 1801.8
Return to France
In 1784, René Gabriel de Rabié finally took the medical leave he had been requesting since 1775. De Rabié had by then been 42 years in the colony, showing remarkable resilience when so many Europeans died shortly after arriving or at an early age. He arrived in France in September 1784 to join his widowed daughter Jaquette Anne Marie Rabié de la Boissière, who had moved to Paris in 1782 with her son.9 De Rabié did not recover his health in France and died 9 March 1785 in Paris, in the house he leased at No. 27, rue Mesle in the Third Arrondissement, attended by his daughter and a woman from Saint Domingue named Marie, who cared for his health and whom he promised to return to Saint Domingue.10 In September 1785 his daughter petitioned the Marine for 120 livres to pay the return passage for Marie, though there is no record that Marie in fact sailed home.11

References
1 “Rochefort, en tant que port de guerre royal a participé à une vingtaine d’expéditions de traite dès 1715 mais principalement entre 1784 et 1791.” https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2018-02/expo_chairs_noires.pdf
2 “En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef.” De Rabie’s correspondence is preserved in the French naval archives: “Rabié, René Gabriel, ingénieur en chef de la partie du Nord, de l’île de Saint-Domingue.” Secrétariat d’État à la Marine, Archives coloniales, COL E 344, 3 (ark:/61561/up424oimqnma); https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/3
3 See Blanchard Anne. “« Ingénieurs de Sa Majesté Très Chrétienne à l’étranger », ou l’école française de fortifications” Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 20 N°1, Janvier-mars 1973. Etudes d’histoire militaire (XVIIe-XXe siècles) pp. 25- 36, 26, 28-29; DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1973.2383 https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_19
4 There was in this period an imbalance in the proportion of European women to men in the colony, and French immigrants often married into the local families who had been in residence for several generations. See the discussion in Jacques Houdaille, “Quelques données sur la population de Saint-Domingue au XVIIIe siècle”, Population (French Edition), Jul. – Oct., 1973, Vol. 28, No. 4/5 (Jul. – Oct., 1973), pp. 859-872 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/1531260
5 “The term itself derives from the Spanish criollo and Portuguese crioulo, meaning someone or something usually of foreign derivation that becomes native to a new locality. Creolization thus refers to processes of exchange and adaptation …”. Morgan, Philip D., “The Caribbean Environment to 1850”, Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2022), Table 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, accessed 9 June 2023.
6 A 1760 map shows a dwelling labelled Rabié in this location, and not far off, another habitation labelled “LeBon”. Plan de la ville du Cap et de ses environs depuis Limonade jusques et compris la baye de l’Acul pour servir à faire voir les ouvrages projetés pour sa déffense / dressé par ordre de Monsieur de Bellecombe, … gouverneur général de St. Domingue. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 149 DIV 1 P 4; ark:/12148/btv1b55005894z; http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42204818b. Un grand merci à Camille Cordier pour la référence.
7 Dossiers on the brothers are held in the Archives nationales d’Outre Mer: Pierre René Rabié, COL E 344 (ark:/61561/up424hbfjgej; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424hbfjgej/daogrp/0/1); Jean Joseph Rabié (Duverger), COL E 344 (ark:/61561/up424cw041yn; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424cw041yn)
8 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 289BIS
9 Armand-Gabriel-François Paparel de La Boissière (1767 – 1854), was born at Le Cap in 1767 and died in France in 1854.
10 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.
11 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.
Voir l’essai
René Gabriel de Rabié, fils du marchand Gabriel Rabié et de son épouse Marguerite Moine [parfois Moinne ou Moyne], est né le 14 juin 1717 à Rochefort, en France. Louis XIV a fondé la ville de Rochefort afin d’y établir un arsenal et un chantier naval pour la marine française. La construction de l’arsenal a commencé en 1666, et la ville est alors aménagée en damier et entourée de remparts. La Corderie, où l’on fabriquait des cordages pour la marine, a été construite entre 1666 et 1669. À 374 mètres, elle était à l’époque l’un des bâtiments les plus longs d’Europe.
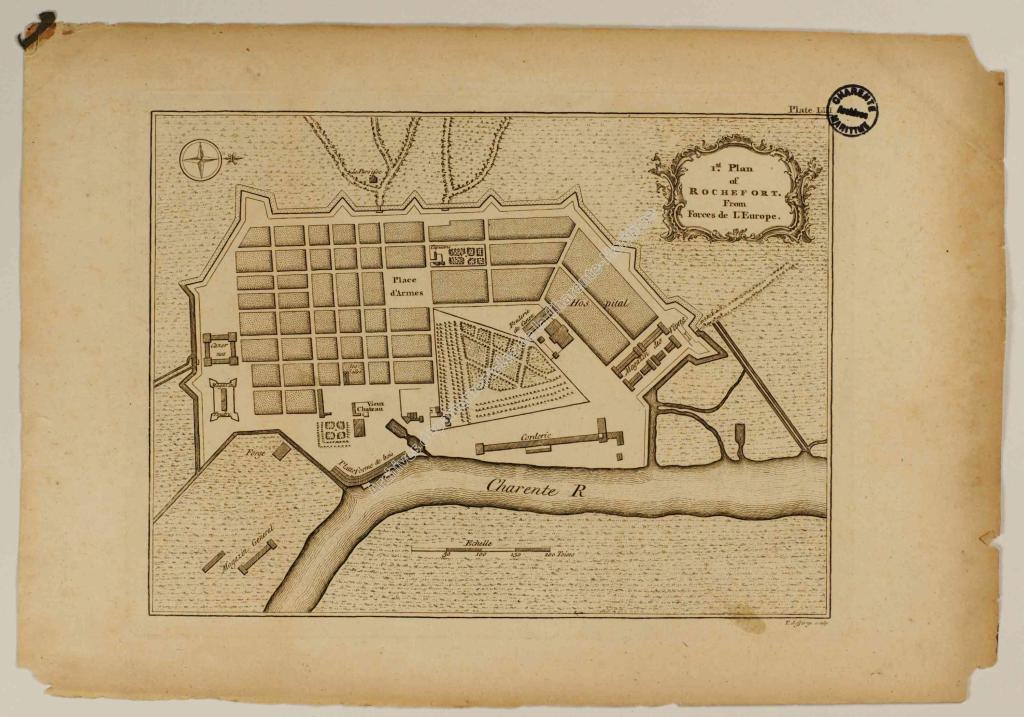
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, France. http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/56ae409f4123700478cbed126d64c376
Rochefort était un port d’embarquement important pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes. Il s’agissait également d’un port de commerce d’esclave, bien que dans une moins grande mesure que La Rochelle, Nantes ou Bordeaux. Les marchands et armateurs de Rochefort participaient à la fois au transport des « engagés » (Européens sous contrat pendant trois ans, aussi appelés les « 36 mois ») et à la traite des esclaves.1
Une formation d’ingénieur
Avant la création de l’École royale du génie à Mézières en 1748, les futurs ingénieurs étudiaient souvent auprès de leur père ou d’un autre membre de leur famille déjà ingénieur. Le père de René Gabriel n’était pas ingénieur, mais métallurgiste ou fournisseur de ferrements, probablement pour l’arsenal ou les chantiers navals. Il avait sans doute reconnu chez son fils les aptitudes nécessaires pour faire carrière dans le corps des ingénieurs associés à la Marine.
René Gabriel lui-même décrit sa formation et ses études dans une lettre écrite en 1753 : « En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef. »2 Comme les autres aspirants, René Gabriel étudie les mathématiques et le dessin, et acquiert les compétences nécessaires pour dessiner et lire une carte, utiliser des instruments de mesure et d’arpentage, et préparer des croquis et des descriptions topographiques. Sa formation officielle est suivie d’un stage, qu’il effectue sous la direction de l’ingénieur en chef de Rochefort, probablement Joseph Étienne Lefebvre de Bréron (1701-1765).
Même après des années d’études et de dépenses – au moins huit ou neuf ans dans le cas de René Gabriel de Rabié – il n’y avait aucune garantie d’obtenir un poste d’« ingénieur ordinaire de Sa Majesté » (officier-ingénieur). À cette époque, la France comptait environ 300 ingénieurs militaires, et ce nombre augmentait en temps de guerre. Entre 1716 et 1739, période de paix relative pendant laquelle de Rabié termine son stage, il y avait quatre fois plus de candidats que de postes à pourvoir. Après avoir terminé leurs études et leur stage, bon nombre de candidats cherchaient donc un emploi hors de France, dans les colonies ou au sein de la Compagnie des Indes.3 En 1742, de Rabié, alors âgé de 25 ans, s’embarque pour Saint-Domingue.
Dans les années 1770, après de nombreuses années de service, de Rabié devient ingénieur en chef de la ville de Cap-Français, à Saint-Domingue. Il conçoit de nombreux monuments et bâtiments publics du Cap (nom usuel de la ville), notamment l’Hôpital de la Charité, avec ses parterres et ses fontaines, ainsi que deux plans de bosquets à la Versailles pour les terrains de la Maison du gouverneur. Il est également l’architecte de la reconstruction (1772-1774) de la deuxième église en importance de l’empire atlantique, Notre-Dame-de-l’Assomption, sur la place d’Armes du Cap, après sa destruction partielle à la suite d’un tremblement de terre en 1771.

Malgré son talent et ses réalisations, de Rabié est constamment frustré dans ses efforts pour obtenir une promotion, et sa correspondance consigne ses revers et ses réussites. En 1758, il reçoit son brevet d’« ingénieur », qui lui avait été promis en 1755. En 1773, il devient colonel. Il termine finalement sa carrière en 1784 avec le grade de brigadier et un salaire annuel de 8 000 livres. Ses difficultés à obtenir une promotion et à voir son mérite reconnu sont caractéristiques des problèmes éprouvés à cette époque par les membres du corps des ingénieurs.
Vie familiale
René Gabriel de Rabié est célibataire quand il arrive à Saint-Domingue en 1742, mais avant 1749, il épouse Anne Le Bon. Le Bon, ou Lebon, est un nom associé à une grande famille « créole » de Saint-Domingue.4 À Saint-Domingue au xviiie siècle, le terme « créole » désigne une personne née dans la colonie, qu’elle soit d’origine européenne, africaine ou métisse.5 En 1760, la famille de Rabié, composée du couple, de ses esclaves et d’au moins quatre ou cinq enfants, vit près de l’Hôpital de la Charité, sur le « chemin du Haut du Cap », à proximité d’une propriété de la famille Le Bon.6 Quatre des enfants ont survécu jusqu’à l’âge adulte : Jacquette ou Jaquette Anne Marie, née le 17 mai 1750, Pierre René, né le 1er janvier 1754, Jean Joseph (Duverger), né le 4 septembre 1757 et Louise Constance, née le 24 avril 1763.
La famille de Rabié est intimement liée à la vie militaire de la colonie. Membre de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis (1771), colonel (1773), puis ingénieur en chef de la partie nord, René Gabriel de Rabié lui-même devient l’un des « grands blancs », l’élite de Saint-Domingue. Ses fils s’engagent également dans l’armée. Grâce aux sollicitations de leur père, Pierre René devient capitaine dans le Régiment du Cap et son frère, Jean Joseph, capitaine dans l’artillerie de la colonie.7 Les deux fils meurent dans la trentaine à Saint-Domingue, Pierre René en 1790 et Jean Joseph en novembre 1791.
En 1767, la fille aînée de René de Rabié, Jacquette Anne Marie, épouse Claude François Paparel de la Boissière (vers 1740-1782). La famille de la Boissière possède alors une plantation de café à Marmelade, près du Cap. En 1780, la plus jeune fille de l’ingénieur, Louise Constance, âgée de dix-sept ans, épouse Louis Alexandre Longuet de Monplaisir (né en 1757 à Nantes), qui travaille comme dessinateur-ingénieur pour de Rabié. En 1786, Longuet tombe malade. Il meurt en 1788. Louise Constance se remarie en 1796 à Edenton, en Caroline du Sud, où elle s’est installée après la révolution haïtienne. Son mariage avec Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, baron de Nuits (né en 1757), est de courte durée : tous deux périssent dans un naufrage au large des Açores le 11 novembre 1801.8
Return to France
In 1784, René Gabriel de Rabié finally took the medical leave he had been requesting since 1775. De Rabié had by then been 42 years in the colony, showing remarkable resilience when so many Europeans died shortly after arriving or at an early age. He arrived in France in September 1784 to join his widowed daughter Jaquette Anne Marie Rabié de la Boissière, who had moved to Paris in 1782 with her son.9 De Rabié did not recover his health in France and died 9 March 1785 in Paris, in the house he leased at No. 27, rue Mesle in the Third Arrondissement, attended by his daughter and a woman from Saint Domingue named Marie, who cared for his health and whom he promised to return to Saint Domingue.10 In September 1785 his daughter petitioned the Marine for 120 livres to pay the return passage for Marie, though there is no record that Marie in fact sailed home.11

References
1 “Rochefort, en tant que port de guerre royal a participé à une vingtaine d’expéditions de traite dès 1715 mais principalement entre 1784 et 1791.” https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2018-02/expo_chairs_noires.pdf
2 “En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef.” De Rabie’s correspondence is preserved in the French naval archives: “Rabié, René Gabriel, ingénieur en chef de la partie du Nord, de l’île de Saint-Domingue.” Secrétariat d’État à la Marine, Archives coloniales, COL E 344, 3 (ark:/61561/up424oimqnma); https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/3
3 See Blanchard Anne. “« Ingénieurs de Sa Majesté Très Chrétienne à l’étranger », ou l’école française de fortifications” Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 20 N°1, Janvier-mars 1973. Etudes d’histoire militaire (XVIIe-XXe siècles) pp. 25- 36, 26, 28-29; DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1973.2383 https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_19
4 Il existe à cette époque un déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes européens dans la colonie, et les immigrants français se marient souvent avec des membres de familles locales installées depuis plusieurs générations. Voir la discussion dans : Jacques Houdaille, « Quelques données sur la population de Saint-Domingue au xviiie siècle », Population (French Edition), juillet-octobre 1973, vol. 28, no 4/5, pages 859 à 872, URL : https://www.jstor.org/stable/1531260.
5 « Le terme lui-même vient de l’espagnol criollo et du portugais crioulo, qui désignent une personne ou une chose généralement d’origine étrangère qui devient indigène d’une nouvelle région. La créolisation désigne donc les processus d’échange et d’adaptation (traduction) ». Morgan, Philip D., « The Caribbean Environment to 1850 », Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; édition en ligne, Oxford Academic, 18 août 2022), tableau 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, consulté le 9 juin 2023.
6 Une carte de 1760 montre une habitation à cet endroit portant le nom Rabié, et non loin de là, une autre habitation portant le nom « LeBon ». Plan de la ville du Cap et de ses environs depuis Limonade jusques et compris la baye de l’Acul pour servir à faire voir les ouvrages projetés pour sa déffense / dressé par ordre de Monsieur de Bellecombe, … gouverneur général de St. Domingue. Bibliothèque nationale de France, département des Cartes et plans, GE SH 18 PF 149 DIV 1 P 4; ark:/12148/btv1b55005894z; http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42204818b. Un grand merci à Camille Cordier pour la référence.
7 Des dossiers sur les frères sont conservés aux Archives nationales d’outre-mer : Pierre René Rabié, COL E 344 (ark:/61561/up424hbfjgej; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424hbfjgej/daogrp/0/1); Jean Joseph Rabié (Duverger), COL E 344 (ark:/61561/up424cw041yn; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424cw041yn).
8 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 289BIS
9 Armand Gabriel François Paparel de la Boissière (1767-1854), né au Cap en 1767 et mort en France en 1854.
10 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.
11 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.
Living in a Slave Society | Vivre dans une société esclavagiste
Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson
Please be aware that this essay contains references to colonial violence that some may find distressing.
Veuillez noter que cet essai contient des références à la violence coloniale qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes.
View Essay
Eighteenth-century Saint Domingue was a slave society, a society whose infrastructure and functioning were made possible by the work of enslaved peoples. Of all the colonies in the French Caribbean, Saint Domingue had the highest ratio of enslaved peoples to French colonists and free people of colour.
Cap Français (Le Cap), where the de Rabié family lived, was described as the “Paris of the Antilles”. Of the 15,000 inhabitants in 1790, fully two-thirds were enslaved peoples, the remaining one-third dominated by the colonists (24%) and free people of colour (10%).1

By the time of the Haitian Revolution, the enslaved population of Saint Domingue numbered over 709,000 people, most working on the plantations that grew sugar, coffee and indigo, but many also working as domestic servants, artisans, and tradespeople. Although René Gabriel de Rabié did not own a plantation, his daughter Jaquette Anne Marie married into the Paparel de la Boissière family who owned a coffee plantation in Marmelade, which was entirely dependent on enslaved labour. The de Rabié family also owned numerous enslaved people who worked in their gardens and houses in Le Cap.
De Rabié himself participated in the buying, selling and trading of his the enslaved people in his household. In 1766, for example, a notice in the weekly newspaper in Le Cap, Affiches Américaines, described the escape of Jean-Louis, a man from the Mesurade area of Liberia, branded on his left breast with the name “RABIE”, who had left his current owner, Sieur Laroche of Fort Dauphin, then in France.2 The following year, a notice described two enslaved women belonging to de Rabié’s household who were “en maronage” or escaped: Louison and Marie-Jeanne, both branded RABIE.3 In September 1769, de Rabié once again advertised for the return of Marie Jeanne, aged 32 or 33 and of medium height, and Louison, aged 42 or 43 with a long thin face. The women had evidently been returned after their first escape in 1767, since the notice stated that they had been once again “marones” since the previous May.
De Rabié also kept, as many slaveholders did, a notebook that listed the enslaved people in his household, recording births, revenues earned and expenses. It was listed in the Inventory made after his death in Paris.4

François Amable Dubreuil de Foureaux, Liste d’esclaves, 1775-1777, first page. Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux [sic], Ant Ms 16-9 https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737
De Rabié also acted as agent on behalf of Jean François Vincent de Montarcher (1730-83), the former Intendant of Saint Domingue, a relative by marriage. In 1774, he advertised the sale of four men: Charlot, a coachman; Cesar, an “Indian” who was also a coachman; Louis, a maître d’hôtel and confiseur (confectioner); Laviolette, a servant and wigmaker; as well as Perrine, a laundress.5 Cesar was likely a “panis” or Amerindian enslaved person, traded into Saint Domingue from Québec.6

This notice also highlights the diversity of skills that enslaved people acquired. Either recently arrived, or second- and third-generation (Créole) enslaved people drove coaches, made preserves and sweets, styled wigs, and laundered and pressed clothes. Other notices in Affiches describe enslaved people as sailors, fishers and divers, cooks and domestics, seamstresses and tailors, saddlers and coopers, bakers, smiths, and carpenters. When someone bought a business, they often also bought the enslaved people necessary to its operation. For example, in 1786, when M. Saussay, Apothicaire du Roi, sold his pharmacy, he included all the implements and equipment as well as the enslaved people necessary for the running of the Shop (“nécessaires pour l’usage dudit Magasin”).7 When de Rabié’s son and daughter-in-law left for France in spring of 1786, they advertised for sale not only their maid, who was a cook and good laundress, with her child, but also a forge, complete with four enslaved blacksmiths.8
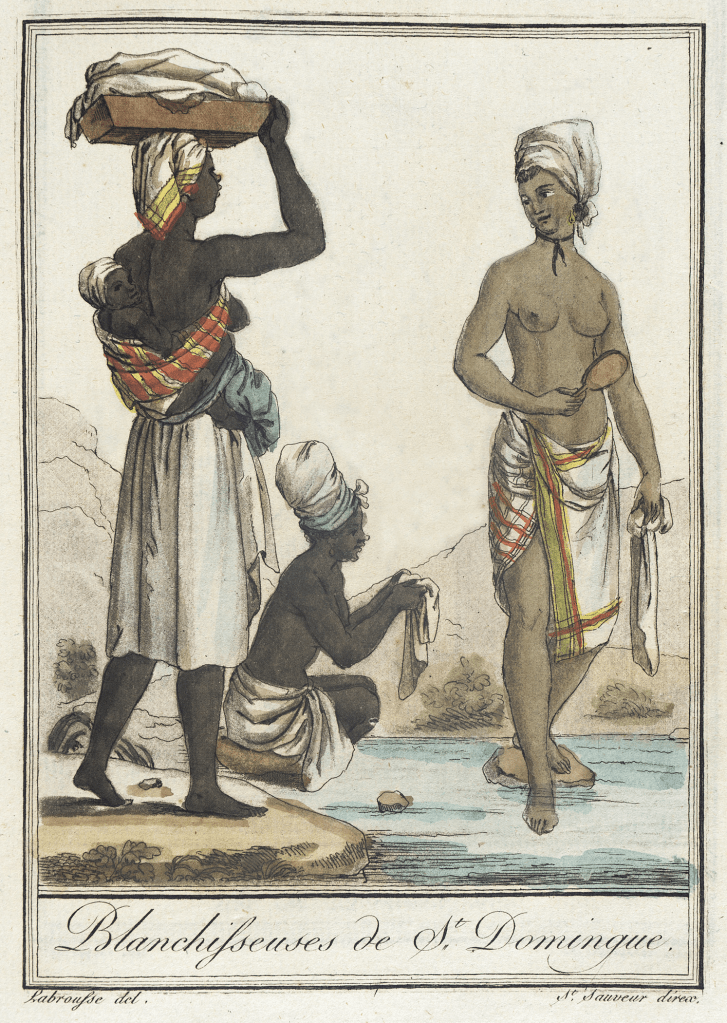
Engraving, ca1797
Los Angeles County Museum of Art, Costume Council Fund (M.83.190.356)
https://collections.lacma.org/node/208559
When De Rabié finally left Saint Domingue to return to France in 1784, he took with him a woman named Marie, who was described in the records as a “mulâtresse”, to care for his health. He also promised to return her to Saint Domingue. “Mulâtre” or “mulâtresse” was one of the categories used by the French in Saint Domingue to describe people of colour. The family of de Rabié’s wife, Anne Le Bon, included a number of people described as “mulâtre libre”, or free person of colour, and it may be that Marie was a member of the extended de Rabié family. There is a record from a census in 1803 for Marie Rabié, a “couturière”, or dressmaker, living at 556 rue Vaudreuil, near the old de Rabié home in Cap Français.9 Was this the Marie who had nursed René Gabriel de Rabié in France? Might she have been de Rabié’s natural daughter?
Every aspect of the de Rabié family’s life in Saint Domingue was made possible through the work of the enslaved servants who cooked and cleaned, and nursed, dressed and served them. It was not, however, only in their personal lives that the de Rabié family members depended on enslaved people. Not only did their businesses rely on enslaved labour, but significantly, the buildings, fortifications, monuments, and gardens that de Rabié himself designed were constructed through the work of enslaved carpenters, masons, joiners, sawyers, and gardeners. Without this labour force, the “Paris of the Antilles” would not have been built.10
References
1 Morgan, Philip D., ‘The Caribbean Environment to 1850’, Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2022), Table 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, accessed 9 June 2023.
2 “un Negre Mesurade, nomme Jean-Louis, etampé sur le sein gauche RABIE, se disant appartenir au Sr. Laroche, du Fort-Dauphin , actuellement en France.” Affiches Américaines, 3 septembre 1766, pp. 308-9. For an excellent description of the practice of branding, see “Les esclaves des habitations de La Marre Dubocq”; https://archives.calvados.fr/page/les-esclaves-des-habitations-de-la-marre-dubocq.
3 “Louison, Negresse Créole, & Marie-Jeanne, aussi Negresse, etampées toutes les deux RABIE, font marones, celle-ci depuis environ un mois, & l’autre depuis le 15 de ce mois. Ceux qui les reconnoitront font pries d’en donner avis a M. Rabie, Ingenieur du Roi au Cap.” (“Louison, a Creole “Negress”, & Marie-Jeanne, also a “Negress”, both branded RABIE, have fled, the first about a month ago, the other since the 15 of this month [June]. Those who see them are asked to notify M. Rabié, Ingénieur du Roi, at Le Cap.”) Affiches Américaines, 24 juin 1767, p. 201. (Author’s translation)
4 “Item, a notebook that appeared to have served the said S. Rabié as a journal in which he recorded family affairs, the births of the “negroes” (nêgres) in his household, the proceeds and expenses…” (“Item un cahier qui parait avoir servi aud. S. Rabié de journal surquel il inscrivait ses affaires de famille, les naissances des nêgres de son habitation, le produit d’icelle et ses depenses…”) For another example of a similar notebook, see Liste d’esclaves, 1775-1777 by François Amable Dubreuil de Foureaux, Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux [sic], Ant Ms 16-9; https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737
5 “Quatre Nègres & une Négresse, appartenans à M. de Montarcher, ancien Intendant de Saint-Domingue, nommés Charlot, cocher; Cesar, Indien, aussi cocher; Louis, maître d’hôtel & confiseur; Laviolette, domestique & perruquier; & Perrine, blanchisseuse: on les donnera à l’essai, & on les vendra ensemble ou séparément, à la meil-leure composition possible. Il faut s’adresser à M. Rabie, Ingénieur en Chef au Cap, ou à M. Rocher, fondé de pro-curation M. de Montarcher.” Affiches, 18 juin 1774, p. 310.
6 See discussion in Brett Rushforth, Bonds of Alliance: Indigenous and Atlantic Slaveries in New France (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2013), 165–73, 299–367.
7 “M. Saussay, Apothicaire du Roi au Cap, n’ayant pu vendre son Magasin de Pharmacie avec les créances y atachées, donne avis qu’il les en extraira & qu’il le vendra en seul muni de tous les ustenciles, vaissaux & Nègres nécessaires pour l’usage dudit Magasin.” Affiches, 25 janvier 1786, p. 40.
8 “M. & Madame Rabié partent pour France du 10 au 15 du mois prochain … il vendra son fonds de boutique, consistant en deux forges bien montees, quatre Negres forgerons, bons ouvriers, & une Négresse nourrice, avec son enfant, cuisiniere, bonne blanchisseuse & repasseuse …” Affiches, 12 avril 1796, p. 192.
9 My thanks to Carrie L. Glenn at Niagara University for this information.
10 Bailey, Gauvin A. Architecture and Urbanism in the French Atlantic Empire: State, Church, and Society, 1604-1830. McGill-Queen’s University Press, 2018, 162. https://books-scholarsportal-info.proxy3.library.mcgill.ca/uri/ebooks/ebooks3/upress/2018-07-09/1/9780773553767, pp 99-101.
Voir l’essai
Au xviiie siècle, Saint-Domingue était une société esclavagiste, dont l’infrastructure et le fonctionnement reposaient sur le travail des esclaves. Saint-Domingue était la colonie française des Caraïbes qui comptait le plus grand nombre d’esclaves par rapport au nombre de colons français et de personnes de couleur libres.
Cap-Français (le Cap), où vivait la famille de Rabié, était décrit comme le « Paris des Antilles ». Sur les 15 000 habitants que comptait la ville en 1790, les deux tiers étaient des esclaves, le tiers restant était composé de colons (24 %) et de personnes de couleur libres (10 %).1

Au moment de la révolution haïtienne, Saint-Domingue compte plus de 709 000 esclaves. La plupart travaillent dans les plantations de sucre, de café et d’indigo, mais ils sont nombreux également à travailler comme domestiques, artisans et commerçants. René Gabriel de Rabié ne possédait pas de plantation, mais sa fille Jacquette Anne Marie avait épousé un membre de la famille Paparel de la Boissière, propriétaire d’une plantation de café à Marmelade, qui dépendait entièrement du travail des esclaves. La famille de Rabié possédait également de nombreux esclaves qui travaillaient dans leurs jardins et leurs maisons au Cap.
René de Rabié lui-même participait à l’achat, à la vente et au commerce des esclaves de son ménage. En 1766, par exemple, une annonce parue dans l’hebdomadaire du Cap, Affiches américaines, décrit la fuite de Jean-Louis, un homme originaire de la région de Mesurade au Libéria, marqué sur la poitrine gauche du nom « RABIE », qui a quitté son propriétaire actuel, Sieur Laroche de Fort-Dauphin, alors propriété de la France.2 L’année suivante, une annonce décrit deux femmes esclaves appartenant à la maison de Rabié qui sont en « marronnage », ou en fuite : Louison et Marie-Jeanne, toutes deux marquées RABIE.3 En septembre 1769, René de Rabié publie une nouvelle annonce pour tenter de retrouver Marie-Jeanne, âgée de 32 ou 33 ans et de moyenne taille, et Louison, âgée de 42 ou 43 ans, au visage long et maigre. Les femmes lui avaient manifestement été rendues après leur première fuite en 1767, puisque l’avis indique qu’elles sont cette fois en fuite depuis le mois de mai précédent.
Comme beaucoup de propriétaires d’esclaves, René de Rabié tient un carnet dans lequel il répertorie les esclaves de sa maison, consigne leurs naissances, les revenus qu’ils rapportent et les dépenses qu’ils occasionnent. Ce carnet figure dans l’inventaire dressé après sa mort à Paris.4

François Amable Dubreuil de Foureaux, Liste d’esclaves, 1775-1777, first page. Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux [sic], Ant Ms 16-9 https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737
René de Rabié agit également en tant qu’agent de Jean François Vincent de Montarcher (1730-1783), ancien intendant de Saint-Domingue, un parent par alliance. En 1774, il annonce la vente de quatre hommes : Charlot, cocher, César, un « Indien » qui était également cocher, Louis, maître d’hôtel et confiseur, Laviolette, domestique et perruquier, ainsi que Perrine, blanchisseuse.5 César était probablement un « panis », c’est-à-dire un esclave autochtone vendu à Saint-Domingue depuis le Québec.6

Cette annonce met également en évidence la diversité des compétences acquises par les esclaves. Qu’ils soient nouvellement arrivés ou issus de la deuxième ou troisième génération (créoles), les esclaves conduisaient des calèches, préparaient des conserves et des confiseries, fabriquaient des perruques, lavaient et repassaient des vêtements. D’autres avis dans les Affiches américaines décrivent des esclaves qui sont marins, pêcheurs et plongeurs, cuisiniers et domestiques, couturières et tailleurs, selliers et tonneliers, boulangers, forgerons et charpentiers. Lorsqu’une personne achetait une entreprise, elle achetait souvent aussi les esclaves nécessaires à son exploitation. Par exemple, en 1786, quand M. Saussay, apothicaire du Roi, vend sa pharmacie, il propose aussi tous les outils, l’équipement et les esclaves nécessaires au fonctionnement de la boutique (« nécessaires pour l’usage dudit Magasin.7 Lorsque le fils et la belle-fille de René Gabriel de Rabié partent pour la France au printemps 1786, ils mettent en vente non seulement leur servante, cuisinière et bonne blanchisseuse, et son enfant, mais aussi une forge, avec quatre forgerons esclaves.8
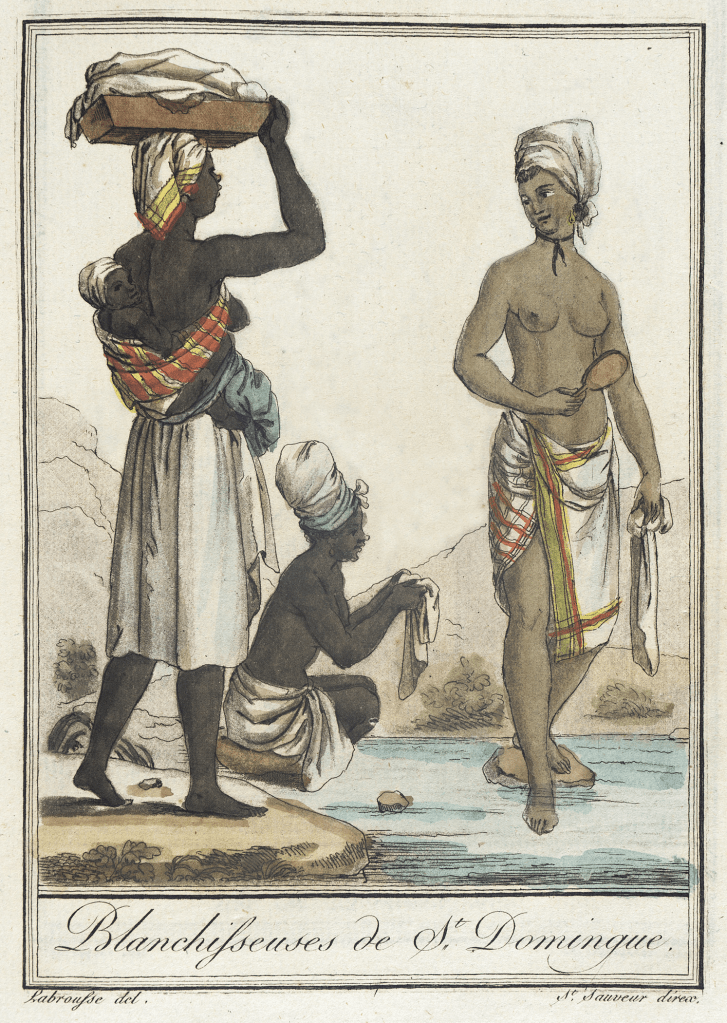
Engraving, ca1797
Los Angeles County Museum of Art, Costume Council Fund (M.83.190.356)
https://collections.lacma.org/node/208559
En 1784, quand René de Rabié quitte finalement Saint-Domingue pour retourner en France, il emmène une femme nommée Marie, décrite dans les registres comme une « mulâtresse », afin qu’elle veille sur sa santé. Il lui promet alors de la ramener à Saint-Domingue. Le mot « mulâtre » ou « mulâtresse » était un des termes utilisés par les Français à Saint-Domingue pour désigner les personnes de couleur. La famille de l’épouse de René de Rabié, Anne Le Bon, comptait plusieurs personnes décrites comme « mulâtres libres », et il est possible que Marie ait fait partie de la famille élargie du naturaliste. Un recensement de 1803 mentionne Marie Rabié, couturière, domiciliée au 556, rue Vaudreuil, près de l’ancienne maison de Rabié à Cap-Français.9 S’agit-il de la Marie qui avait soigné René Gabriel de Rabié en France? Était-elle sa fille naturelle?
Tous les aspects de la vie de la famille de Rabié à Saint-Domingue étaient rendus possibles grâce au travail de ses esclaves, qui s’occupaient de la cuisine et du nettoyage, en plus de soigner et de servir la famille. Mais ce n’était pas seulement dans leur vie personnelle que les membres de la famille de Rabié à Saint-Domingue dépendaient des esclaves. Leurs entreprises aussi reposaient sur le travail des esclaves, mais surtout, les bâtiments, les fortifications, les monuments et les jardins conçus par René de Rabié lui-même ont été construits grâce au travail d’esclaves charpentiers, maçons, menuisiers, scieurs et jardiniers. Sans cette main-d’œuvre, le « Paris des Antilles » n’aurait jamais vu le jour.10
References
1 Morgan, Philip D., « The Caribbean Environment to 1850 », Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; édition en ligne, Oxford Academic, 18 août 2022), tableau 1.3; https://doi-org10.1093/oso/9780197555446.003.0002, consulté le 9 juin 2023.
2 « un Negre Mesurade, nommé Jean-Louis, etampé sur le sein gauche RABIE, se disant appartenir au Sr. Laroche, du Fort-Dauphin, actuellement en France ». Affiches Américaines, 3 septembre 1766, p. 308-309. Pour une excellente description de la pratique de l’impression au fer chaud, voir « Les esclaves des habitations de La Marre Dubocq »; https://archives.calvados.fr/page/les-esclaves-des-habitations-de-la-marre-dubocq.
3 « Louison, négresse Créole, & Marie-Jeanne, aussi négresse, étampées toutes les deux RABIE, sont marones [se sont échappées], celle-ci depuis environ un mois, & l’autre depuis le 15 de ce mois [juin]. Ceux qui les reconnaîtront sont priés d’en aviser M. Rabié, ingénieur du Roi au Cap. » Affiches américaines, 24 juin 1767, p. 201.
4 « Item un cahier qui parait avoir servi aud. S. Rabié de journal surquel il inscrivait ses affaires de famille, les naissances des nègres de son habitation, le produit d’icelle et ses depenses… ») Pour un autre exemple de cahier similaire, voir Liste d’esclaves, 1775-1777 par François Amable Dubreuil de Fonréaux, Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux, Ant Ms 16-9; https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737.
5 “Quatre Nègres & une Négresse, appartenans à M. de Montarcher, ancien Intendant de Saint-Domingue, nommés Charlot, cocher; Cesar, Indien, aussi cocher; Louis, maître d’hôtel & confiseur; Laviolette, domestique & perruquier; & Perrine, blanchisseuse: on les donnera à l’essai, & on les vendra ensemble ou séparément, à la meil-leure composition possible. Il faut s’adresser à M. Rabie, Ingénieur en Chef au Cap, ou à M. Rocher, fondé de pro-curation M. de Montarcher.” Affiches, 18 juin 1774, p. 310.
6 Voir la discussion dans Brett Rushforth, Bonds of Alliance : Indigenous and Atlantic Slaveries in New France (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2013), 165-173, 299-367.
7 “M. Saussay, Apothicaire du Roi au Cap, n’ayant pu vendre son Magasin de Pharmacie avec les créances y atachées, donne avis qu’il les en extraira & qu’il le vendra en seul muni de tous les ustenciles, vaissaux & Nègres nécessaires pour l’usage dudit Magasin.” Affiches, 25 janvier 1786, p. 40.
8 “M. & Madame Rabié partent pour France du 10 au 15 du mois prochain … il vendra son fonds de boutique, consistant en deux forges bien montees, quatre Negres forgerons, bons ouvriers, & une Négresse nourrice, avec son enfant, cuisiniere, bonne blanchisseuse & repasseuse …” Affiches, 12 avril 1796, p. 192.
9 Merci à Carrie L. Glenn de l’Université Niagara pour cette information.
10 Bailey, Gauvin A. Architecture and Urbanism in the French Atlantic Empire: State, Church, and Society, 1604-1830. Presses universitaires McGill-Queen’s, 2018, 162. https://books-scholarsportal-info.uri/ebooks/ebooks3/upress/2018-07-09/1/9780773553767, p. 99-101
The Collections | Les collections
Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson
View Essay
After René Gabriel de Rabié’s death in Paris in March 1785, his daughter Jaquette Anne Marie Paparel de la Boissière engaged a well-known specialist, Sieur Gilles Gaillard, the “maître Naturaliste Breveté de la reine” (Naturalist to the Queen) to inventory the collection her father had brought back with him from Saint Domingue. François Gilles Gaillard was associated with the shop Gaillard et Soeurs that sold natural history specimens and curiosities on the rue Richelieu.1
Acquiring and preserving a collection of objects, or preparing drawings and notes on plants, birds or animals was a not infrequent avocation for some European residents, including doctors, engineers, military officers and plantation owners. De Rabié’s collection epitomizes the kind of materials of interest to collectors, which were sturdy enough to be preserved and conveyed to France.
De Rabié was also not the only collector in Saint Domingue at this period. In 1782, for example, M. Frenaye, who lived at Riviere-Froide near Port-au-Prince, offered for sale his “très beau cabinet d’histoire naturelle” (very fine natural history collection), which included a superb collection of shells, not only from Saint Domingue but from “les Grandes Indes” (Indian Ocean islands) and other islands, mineral specimens and fossils, samples of petrified native woods and fruits, bezoars from the Indies, crystals, and other items too numerous to name.2
There were 24 lots in the de Rabié inventory compiled and evaluated by Gaillard. They included mineral specimens, agates, jasper, alabaster and petrified wood, and an ammonite. De Rabié also brought back to Paris seeds and wood samples, shells, starfish and sea urchins, and curious arrangements of shells into “flowers” (“têtes de fleurs en coquille”).3
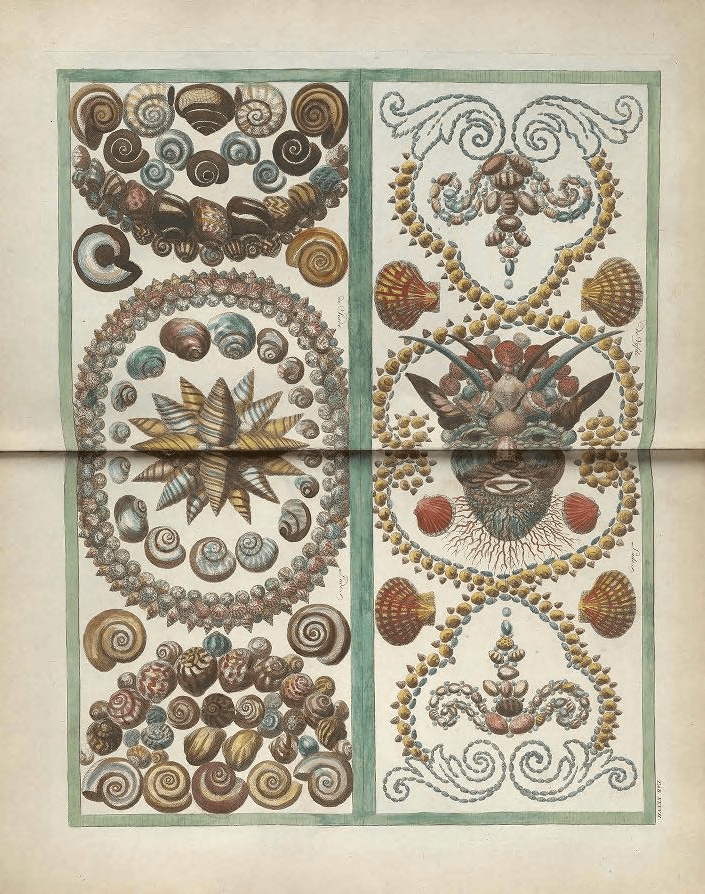
In addition, there was a miscellaneous collection of shells, fish, corals, the beak of a toucan, cocoons, hummingbirds’ nests, and stones. There were also six sets of butterflies framed under glass, perhaps similar to the watercolours of sets of butterflies that de Rabié had painted.
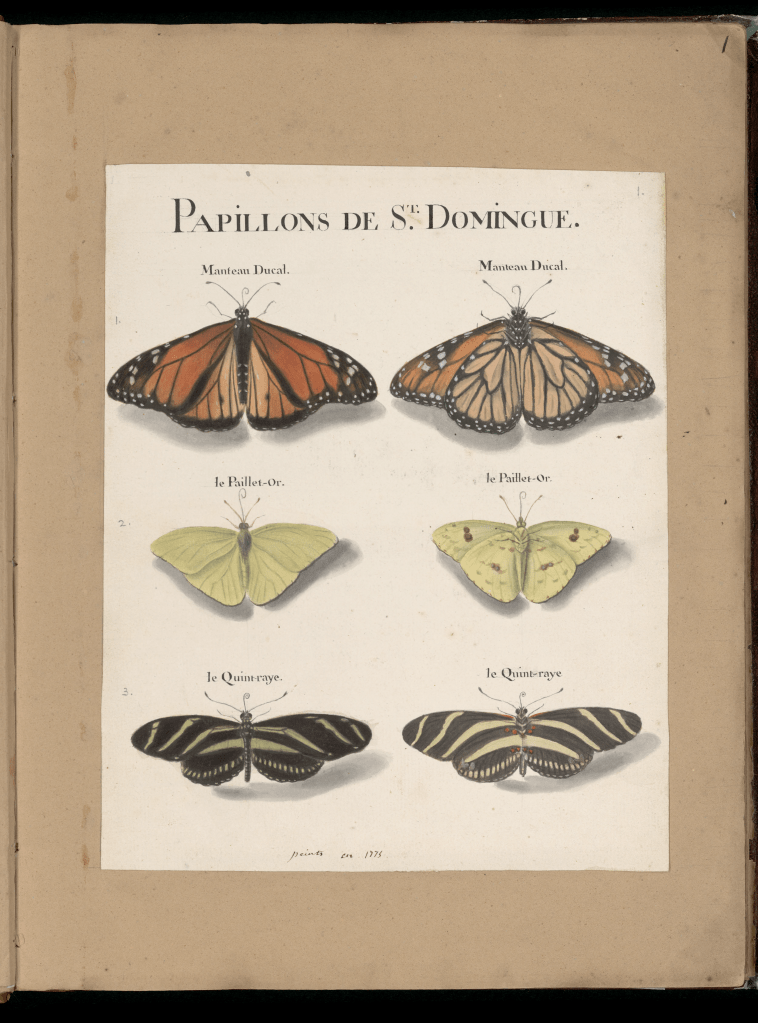
One of the highlights of the collection was a skin or perhaps a mounted specimen of what de Rabié described as a “monkey” (singe) called “le Paresseux” (Sloth). De Rabié painted this animal at Le Cap, where it would have been as much a curiosity as it was in France. The Three-toed Sloth, possibly Bradypus tridactylus, is not native to the island of Hispaniola, but was most likely brought from northern South America to Saint Domingue.
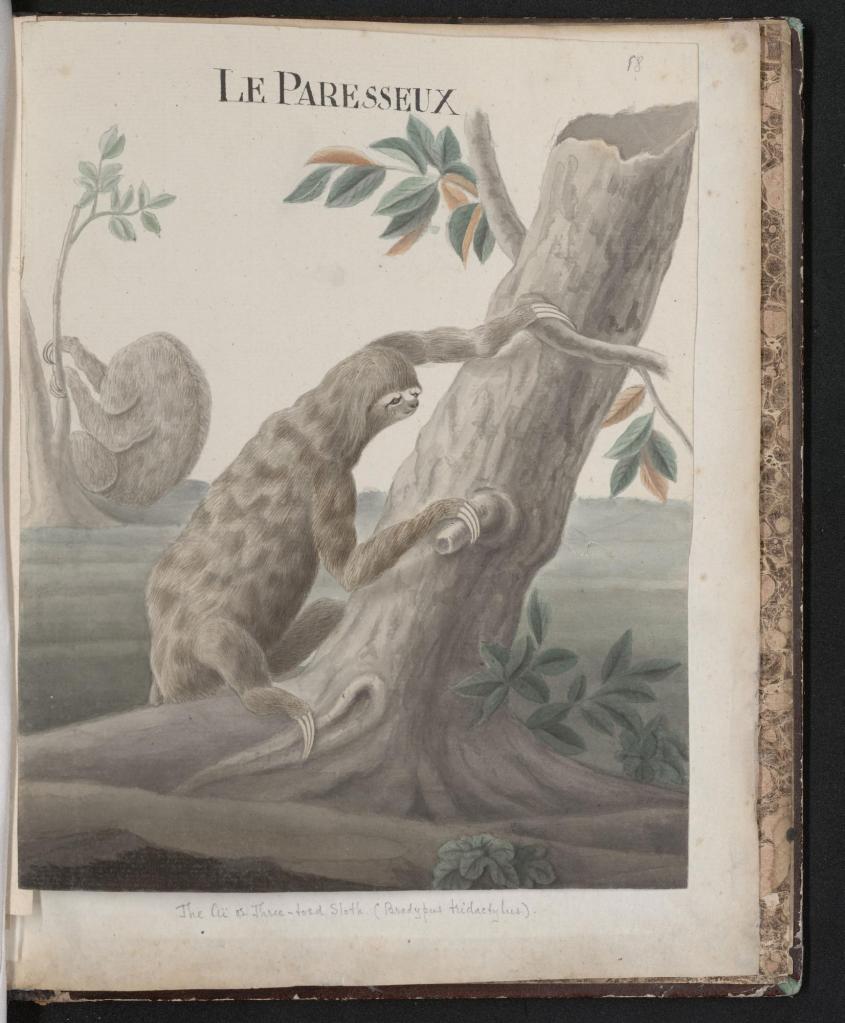
De Rabié’s cabinet included what were classified as “curiosities” – a “Calumet”, fetishes and other objects “de Sauvages” [sic],4 as well as two model boats [?], a quiver with bow and arrows, a Chinese parasol and four ostrich eggs. Père Nicolson in his Essai sur l’histoire naturelle de l’isle de Saint-Domingue (1776) had also included images and descriptions of “fetiches”, and other objects found in Saint Domingue and attributed to the original Indigenous inhabitants.

De Rabié’s collection of natural and artificial objects has disappeared, possibly sold shortly after his death, or dispersed over time. Fortunately, one of the most valuable parts of the collection – the watercolour drawings that de Rabié made in Saint Domingue – is now preserved in the Blacker Wood Natural History Collection at McGill (see Rene Gabriel de Rabié, Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo, vol. 3, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library, http://mcgill.worldcat.org/oclc/61505881). The paintings were described in the Inventory:
A collection of natural history drawings, painted from nature by M Rabié, consisting of fifty-eight birds, sixty-two fruits, sixty fish, fifteen crabs, seventy-three butterflies, fifty-nine insects, seventeen shells, with explanatory notebooks …
(Collection de dessins dhistoire naturelle, peints d’après nature par M Rabié, concistant en cinquante huit oiseaux, soixante deux fruits, soixante poissons, quinze crabes, soixante treize papillons, cinquante neuf insectes, dix sept coquilles avec les cahiers d’expliquation …)
The set of drawings was valued at 380 livres. De Rabié’s daughter Jaquette Anne Marie de la Boissière may have intended to sell all the contents of her father’s house, including the natural history cabinet, but it is evident from subsequent events that she retained the watercolours he painted in Saint Domingue.
In September 1811, Madame de la Boissière presented a box of her father’s natural history drawings to Jean-Pierre Bachasson, Comte de Montalivet and Ministre de l’Intérieur, hoping to sell them to the state. In January 1814 the Ministre demanded a report from the Muséum d’histoire naturelle, and the box of drawings was sent from the Ministry to Jacques Thouin at the Muséum. At a meeting of the curators on 12 January, Jean-Baptiste Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire and René Louiche Desfontaines signed a Rapport that was forwarded to the Ministre.
The Rapport stated that the collection as a whole was of little interest to the Muséum. While they appreciated the drawings and the spirit in which they were made, the collection was no longer of great importance to science. Many naturalists had visited Saint Domingue after 1790, and most of the “novelties” of the flora and fauna had already been published. Nevertheless, they were particularly interested in several birds and fish as well as the drawings of all the insect larvae. They suggested that the Muséum borrow the drawings from Mme La Boissière, whom they acknowledged was in great need of funds, and have them copied for the national collection.5 Mme La Boissière was to be given 300 livres, but it is uncertain whether the drawings were in fact copied. They do not appear today to be in the collections of the Bibliothèque du Muséum national d’histoire naturelle. In the Bibliothèque du Muséum there are, however, 21 watercolours of birds by Madame La Boissière, copies of her father’s watercolours, executed in Saint Domingue between 1778 and 1779.6
Sometime after 1833, the drawings were bound into four albums by the firm of Delarue, Aux Deux Créoles on the rue St-Honoré in Paris. Volume One was dedicated to Birds, Two to Fish and Crustaceans, Three to Insects and Shells, and Four to Plants. Each volume also included a table of contents, written by the same person who wrote additional inscriptions on the back of each drawing. From internal evidence, it would appear that the additional notes were written after 1790, likely by Jaquette Anne Marie de la Boissière. She was still alive in Paris in 1820, but it may have been her son, Armand François Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), who had the drawings bound.
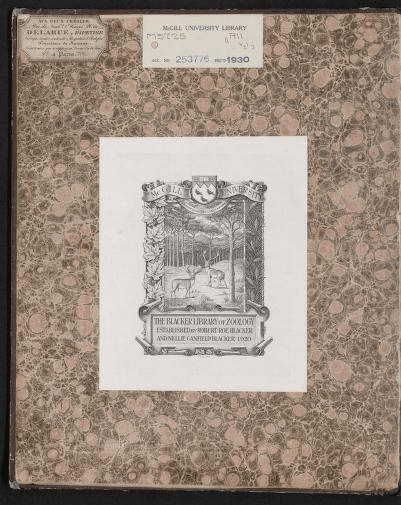
Dr Casey Wood was alerted to the existence of the de Rabié drawings by his friend Alexander Wetmore of the Smithsonian, who was writing on Hispaniolan birds. Wood acquired the drawings from the British antiquarian booksellers Wheldon and Wesley for the Blacker Wood Library in 1930.
References
1 See the description in LACOUR, Pierre-Yves. Les cabinets parisiens d’histoire naturelle In: La République naturaliste: Collections d’histoire naturelle et Révolution française (1789-1804) [online]. Paris: Publications scientifiques du Muséum, 2014 (generated 02 mars 2023). DOI: https://doi.org/10.4000/books.mnhn.5379.
2 “Avis divers”, Supplément, Affiches, 10 août 1774, pp. 304-5.
3 Shell collections were often arranged in decorative patterns in drawers, sometimes in flower shapes. See Claude Sorgeloos, « Murex barclayi : livres de coquilles », Techniques & Culture [En ligne], 59 | 2012, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 19 juillet 2023. DOI : https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.4000/tc.6594
4 Père Nicolson, Essai sur l’histoire naturelle de l’isle de Saint-Domingue : avec des figures en taille-douce A Paris, Chez Gobreau, libraire, Quai des Augustins, à Saint Jean-Baptiste, M.DCC.LXXVI. [1776], 365-371.
5 From Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire and René-Louiche Desfontaines, Rapport. Archives Nationales; Cession: cote F/17/1542/2 (1814).
6 “Recueil de 21 dessins d’oiseaux par Madame Laboissier[sic]”, MNHN Cote: Ms 5030; https://bibliotheques.mnhn.fr/EXPLOITATION/infodoc/digitalCollections/viewerpopup.aspx?seid=MNHN_MS5030
Voir l’essai
Après la mort de René Gabriel de Rabié à Paris en mars 1785, sa fille Jacquette Anne Marie Paparel de la Boissière engage un spécialiste renommé, Sieur François-Gilles Gaillard, « maître naturaliste breveté de la reine », pour qu’il inventorie la collection rapportée de Saint-Domingue par son père. François-Gilles Gaillard était associé à la boutique Gaillard et Sœurs, située rue Richelieu, qui vendait des spécimens d’histoire naturelle et des curiosités.1
Un passe-temps fréquent chez certains résidents européens, notamment les médecins, les ingénieurs, les officiers militaires et les propriétaires de plantations, consistait à acquérir et conserver une collection d’objets, ou à consigner des dessins et des notes sur les plantes, les oiseaux ou les animaux. La collection de René de Rabié est représentative des sujets qui intéressaient les collectionneurs et qui étaient suffisamment solides pour être conservés et transportés en France.
René de Rabié n’était d’ailleurs pas le seul collectionneur de Saint-Domingue à cette époque. En 1782, par exemple, M. Frenaye, qui vivait à Rivière-Froide, près de Port-au-Prince, proposait à la vente son « très beau cabinet d’histoire naturelle », qui comprenait une superbe collection de coquillages provenant de Saint-Domingue, des « Grandes Indes » (îles de l’océan Indien) et d’autres îles, ainsi que des spécimens minéraux et de fossiles, des échantillons de bois et de fruits indigènes pétrifiés, des bézoards des Indes, des cristaux et d’autres objets trop nombreux pour être cités.2
Quant au cabinet de René de Rabié, dont l’inventaire a été compilé et évalué par François-Gilles Gaillard, il comptait 24 lots. Il comprenait des spécimens minéraux, des agates, du jaspe, de l’albâtre et du bois pétrifié, ainsi qu’une ammonite. L’ingénieur a également apporté à Paris des graines et des échantillons de bois, des coquillages, des étoiles de mer et des oursins, ainsi que de curieux arrangements de coquillages « en fleurs » (« têtes de fleurs en coquille »).3
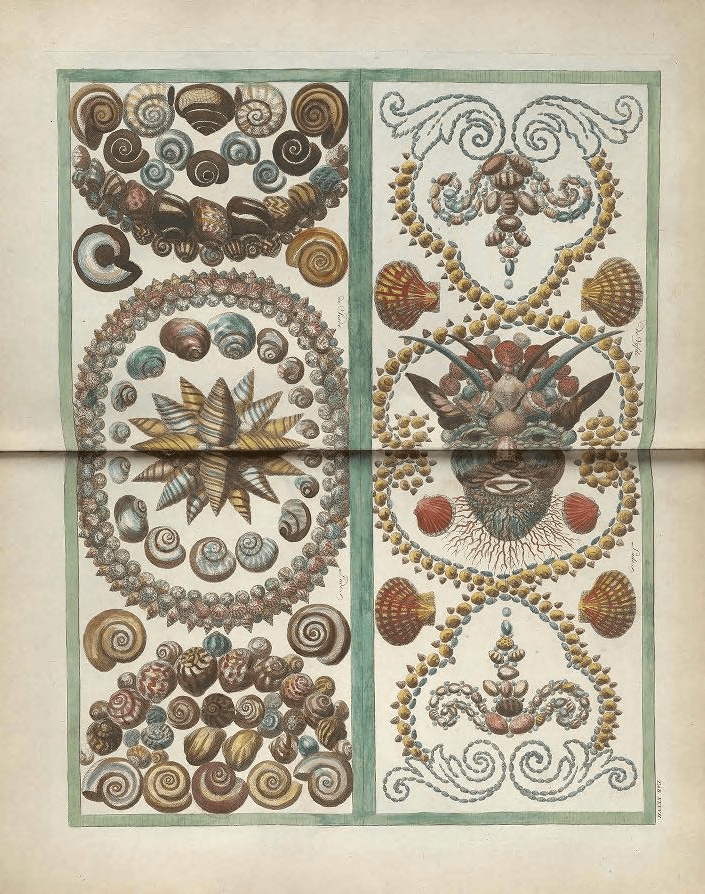
KB, nationale bibliotheek, libre de droits.
https://www.kb.nl/ontdekken-bewonderen/topstukken/rariteitenkabinet-seba
Les biens de René de Rabié comprenaient en outre une collection hétéroclite de coquillages, de poissons, de coraux, de cocons, de nids de colibris et de pierres, ainsi qu’un bec de toucan, et six séries de papillons sous verre, peut-être les sujets de certaines des aquarelles peintes par le naturaliste.
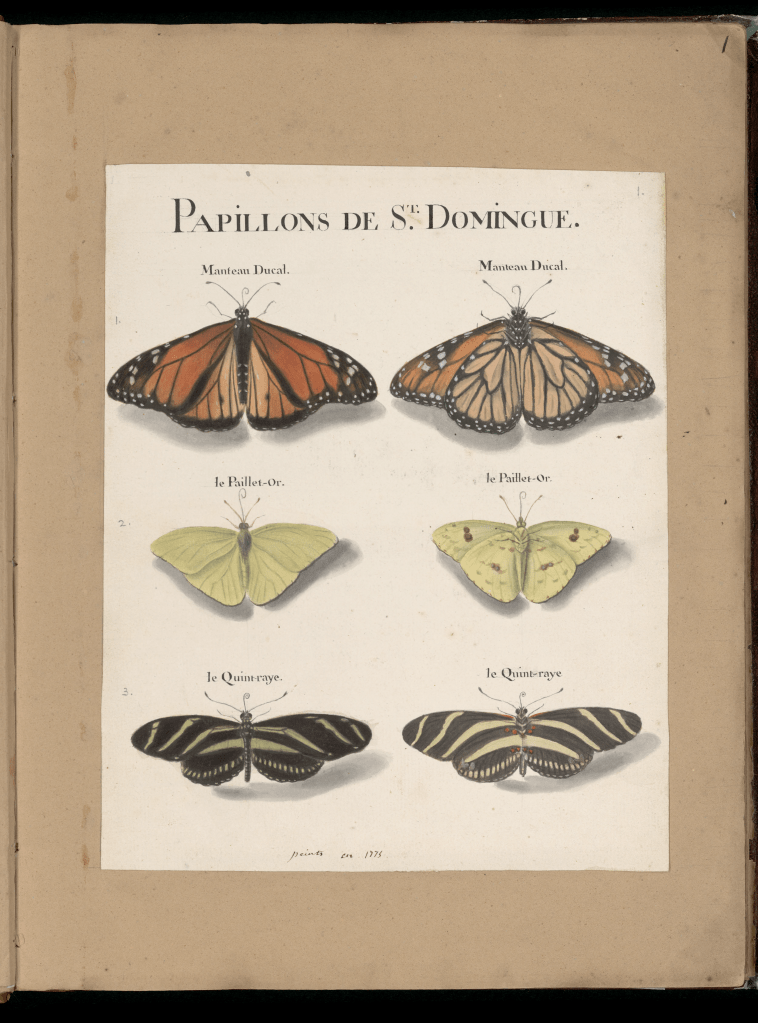
Le cabinet de René de Rabié comprenait des objets considérés comme des « curiosités » : un « calumet », des fétiches et autres objets « de Sauvages [sic] », ainsi que deux maquettes de bateaux [?], un carquois avec un arc et des flèches, une ombrelle chinoise et quatre œufs d’autruche. Le père Nicholson, dans son Essai sur l’histoire naturelle de l’isle de Saint-Domingue (1776), fournissait également des images et des descriptions de « fétiches » et d’autres objets trouvés à Saint-Domingue et attribués aux premiers habitants autochtones.
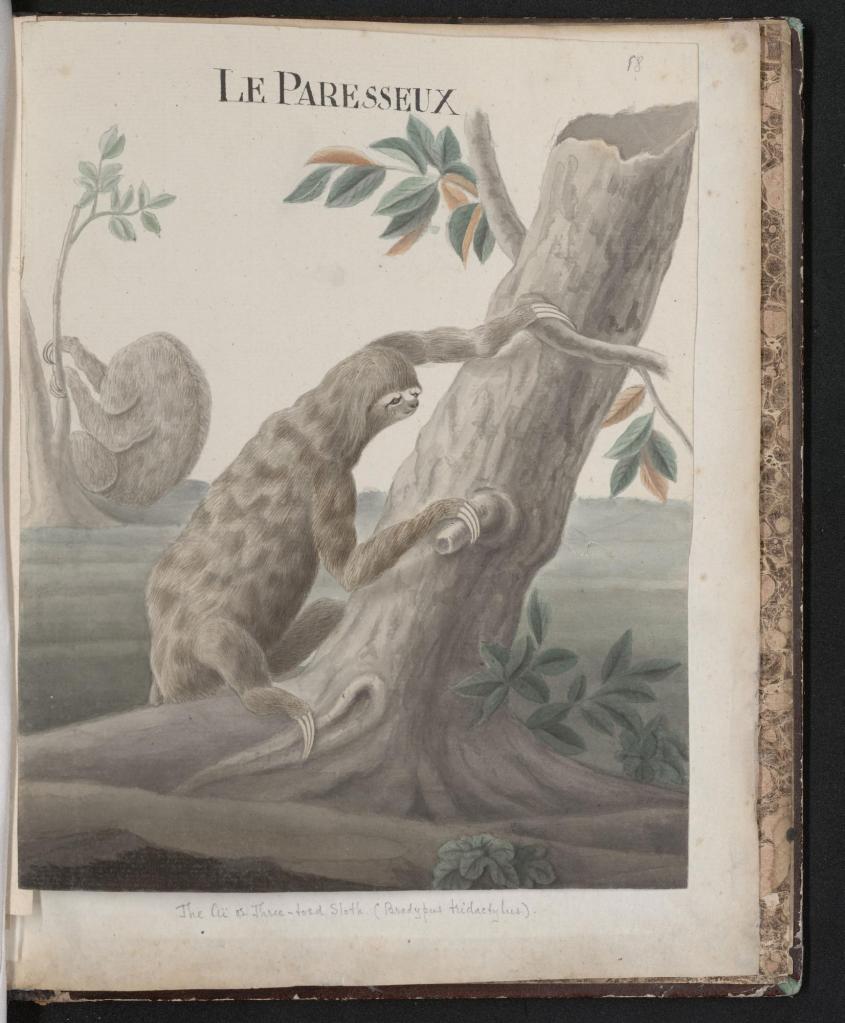
Le cabinet de René de Rabié comprenait des objets considérés comme des « curiosités » : un « calumet », des fétiches et autres objets « de Sauvages [sic] », ainsi que deux maquettes de bateaux [?], un carquois avec un arc et des flèches, une ombrelle chinoise et quatre œufs d’autruche. Le père Nicholson, dans son Essai sur l’histoire naturelle de l’isle de Saint-Domingue (1776), fournissait également des images et des descriptions de « fétiches » et d’autres objets trouvés à Saint-Domingue et attribués aux premiers habitants autochtones.

La collection d’objets naturels et artificiels de René de Rabié a disparu, probablement vendue peu après sa mort ou dispersée au fil du temps. Heureusement, l’un des éléments les plus précieux de la collection, les aquarelles réalisées par le naturaliste à Saint-Domingue, est aujourd’hui conservé dans la Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de l’Université McGill (voir René Gabriel de Rabié, Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo, vol. 3, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill, http://mcgill.worldcat.org/oclc/61505881):
Collection de dessins d’histoire naturelle, peints d’après nature par M. Rabié, consistant en cinquante-huit oiseaux, soixante-deux fruits, soixante poissons, quinze crabes, soixante-treize papillons, cinquante-neuf insectes, dix-sept coquilles avec les cahiers d’explication
La série de dessins était estimée à 380 livres. La fille de René de Rabié, Jacquette Anne Marie Rabié de la Boissière, avait peut-être l’intention de vendre tout le contenu de la maison de son père, y compris le cabinet d’histoire naturelle, mais les événements qui ont suivi indiquent qu’elle a conservé les aquarelles qu’il avait peintes à Saint-Domingue.
En septembre 1811, Jacquette de la Boissière présente à Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet et ministre de l’Intérieur, une boîte contenant les dessins d’histoire naturelle de son père, dans l’espoir de les vendre à l’État. En janvier 1814, le ministre demande un rapport au Muséum d’histoire naturelle, et la boîte de dessins est envoyée du ministère à Jacques Thouin, au Muséum. Lors d’une réunion des conservateurs le 12 janvier, Jean-Baptiste Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire et René Louiche Desfontaines signent un rapport qui est transmis au ministre.
Selon ce rapport, la collection dans son ensemble présente peu d’intérêt pour le Muséum. Bien que les conservateurs accordent une certaine valeur aux dessins et comprennent l’esprit dans lequel ils ont été réalisés, la collection n’a déjà plus une grande importance scientifique. De nombreux naturalistes se sont rendus à Saint-Domingue après 1790, et la plupart des plantes et des animaux « inédits » pour René de Rabié ont déjà été représentés dans des ouvrages publiés. Le rapport souligne néanmoins l’intérêt de plusieurs dessins d’oiseaux et de poissons, et de tous ceux de larves d’insectes. Les conservateurs proposent donc que le Muséum emprunte les dessins à Jacquette de la Boissière, dont ils reconnaissaient le grand besoin de fonds, et en fasse faire des copies pour la collection nationale.5 Jacquette de la Boissière devait recevoir 300 livres, mais on ne sait pas si les dessins ont effectivement été copiés. Ils ne semblent pas figurer aujourd’hui dans les collections de la bibliothèque du Muséum national d’histoire naturelle. La bibliothèque du Muséum possède toutefois 21 aquarelles d’oiseaux de Jacquette de la Boissière, copies des aquarelles de son père, réalisées à Saint-Domingue entre 1778 et 1779.6
SPeu après 1833, les dessins sont reliés en quatre albums par la maison Delarue, Aux Deux Créoles, rue Saint-Honoré à Paris. Le premier volume est consacré aux oiseaux, le deuxième aux poissons et crustacés, le troisième aux insectes et coquillages, et le quatrième aux plantes. Chaque volume comprend également une table des matières, rédigée par la personne qui a aussi ajouté des inscriptions au dos de chaque dessin. D’après certains indices, il semble que les notes supplémentaires ont été écrites après 1790, probablement par la fille aînée de René de Rabié, Jacquette Anne Marie Rabié de la Boissière. Elle vivait encore à Paris en 1820, mais c’est peut-être son fils, Armand François Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), revenu en France en 1793 après avoir fui à Philadelphie en raison de la révolution haïtienne, qui a fait relier les dessins.
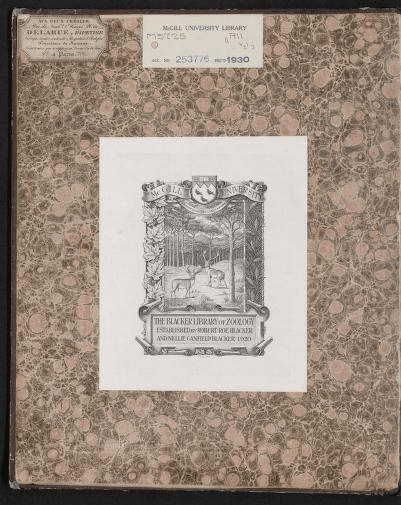
Le Dr Casey Wood a été informé de l’existence des dessins de René de Rabié par son ami Alexander Wetmore, du Smithsonian, qui écrivait sur les oiseaux d’Hispaniola. Le Dr Wood a acquis les dessins en 1930 auprès des libraires-antiquaires britanniques Wheldon et Wesley pour la bibliothèque Blacker-Wood.
References
1 Voir la description dans LACOUR, Pierre-Yves. Les cabinets parisiens d’histoire naturelle, dans La République naturaliste : Collections d’histoire naturelle et Révolution française (1789-1804) [en ligne]. Paris : Publications scientifiques du Muséum, 2014 (généré le 2 mars 2023). DOI : https://doi.org/10.4000/books.mnhn.5379.
2 “Avis divers”, Supplément, Affiches, 10 août 1774, pp. 304-5.
3 Les collections de coquillages étaient souvent disposées de manière décorative dans des tiroirs, parfois en forme de fleurs. Voir l’illustration de la collection Seba, fig. 11 dans Claude Sorgeloos, « Murex barclayi : livres de coquilles », Techniques & Culture [en ligne], 59 | 2012, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 19 juillet 2023. DOI : https://doi-org/10.4000/tc.6594.
4 Le père Nicholson fournissait des images et des descriptions de « fétiches » et d’autres objets dans son Essai sur l’histoire naturelle de l’isle de Saint-Domingue : avec des figures en taille-douce, A Paris, Chez Gobreau, libraire, Quai des Augustins, à Saint Jean-Baptiste, M.DCC.LXXVI. [1776], 365-371.
5 « Les manuscrits sont assez insignifiants, composés de notes fort courtes et dénuées d’intérêt : ils n’offrent aucun détail sur les caractères et les mœurs des objets qu’ils concernent : seulement ceux qui sont relatifs aux insectes indiquent le nom vulgaire du végétal sur lequel vit chacun de ces insectes. » De plus, « Ces dessins coloriés ne sont pas des chefs-d’œuvre; mais on ne peut se dissimuler qu’ils ne soient faits dans un très bon esprit et précisément avec le genre de talent qu’exigent les naturalistes. Chaque objet représenté est parfaitement reconnaissable, et souvent l’auteur donne une preuve de goût dans le choix des attitudes qu’il a données à ses animaux. » L’ouvrage n’a « plus la même importance aujourd’hui qu’à l’époque où l’auteur l’avait conçu ». Mais les conservateurs soulignent l’intérêt de « quelques objets dont les figures, ou nous manquent ou sont publiées avec inexactitude ». Extraits de Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire et René-Louiche Desfontaines, Rapport. Archives Nationales; Cession : cote F/17/1542/2 (1814).
6 « Recueil de 21 dessins d’oiseaux par Madame Laboissier [sic] », Cote du MNHN : Ms 5030; https://bibliotheques.mnhn.fr/EXPLOITATION/infodoc/digitalCollections/viewerpopup.aspx?seid=MNHN_MS5030
The Albums | Les albums
Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson
View Essay
There are 266 watercolours in the de Rabié albums held in the Blacker Wood Natural Collection at McGill University in Montreal. Painted by René de Rabié (1717-85) in Saint Domingue between 1767 and 1784, they have survived revolutions, war, ocean voyages, multiple moves, ministerial neglect, and re-binding until Casey Wood acquired them for the McGill Library in 1930. You can view the albums here.
The watercolours were inventoried in Paris after de Rabié’s death in early 1785. They were described as
Item Collection de dessins d’histoire naturelle, peints d’après nature par M Rabié, concistant en cinquante huit oiseaux, soixante deux fruits, soixante poissons, quinze crabes, soixante treize papillons, cinquante neuf insectes, dix sept coquilles avec les cahiers d’expliquation prisés trois cent quatre vingt livres
[Item Collection of drawings of natural history, painted from life by M. Rabié, consisting of fifty eight birds, sixty-two fruits, sixty fish, fifteen crabs, seventy-three butterflies, fifty-nine insects, seventeen shells with explanatory notes, valued at three hundred and eighty livres]
In 1811, when Mme La Boissière, de Rabié daughter, attempted to sell the paintings to the Muséum d’histoire naturelle in Paris, they were in a ‘boîte’ or ‘caisse’. This may have been a wooden box that de Rabié himself had prepared for the initial shipment of his watercolours from Saint Domingue to Paris in 1784. After the Muséum curators refused the purchase, the box was returned to Mme La Boissière. By the time they were sold to Wheldon and Wesley in the 1920s, the watercolours had been bound into four albums, each with leather covers stamped in gold with the words “St Domingue” and the volume title: ‘Oiseaux’, ‘Poissons-Crustacées’, ‘Coquillages-Insectes’, ‘Fruits’. With the exception of the ‘Coquillages-Insectes’ album, each volume had marbled end papers. All had the label of the bindery, Delarue Papeterie Aux Deux Créoles at No 60, Rue du Faub[ourg] St Honoré. (The business was founded in 1833 and closed in 1904.)
Each volume was prefaced with a title page and ‘Table’ listing the paintings. The paintings were re-numbered, likely at the time of binding. Some of the original numbers on the rectos and versos, presumably written by de Rabié, were cut off when the watercolours were trimmed, but an analysis of the remaining numbers with the later numbering system indicates that only a very few of the watercolours de Rabié brought to Paris might be missing.
Almost all the watercolours carry identifications and notes written by de Rabié on the versos, often with a place and date of painting. These are usually short scrawls, written in ink or pencil, often abbreviated (‘grand. nat.’ for ‘grandeur naturelle’, for example). De Rabié’s simple notes often gave a catalogue number, identified the subject, the scale at which it was painted (life size, or a fraction of life size), and on most, the date and the place, and a signature (‘Rabié’ or sometimes just ‘R’).
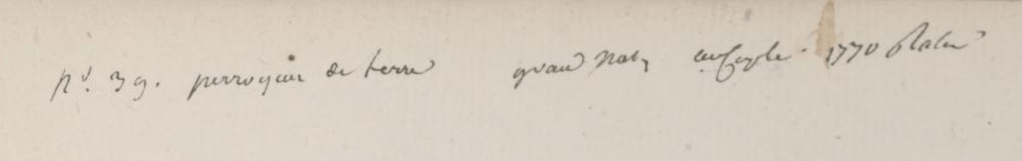
Occasionally the watercolours are signed on the recto in a more formal script, similar to that de Rabié used on the maps and plans he drew in his official capacity, or more neatly written. This occurs more commonly on watercolours painted earlier (1768), or those he drew with borders, as if preparatory for publication.
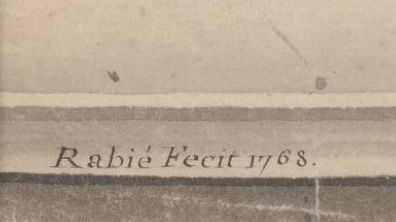
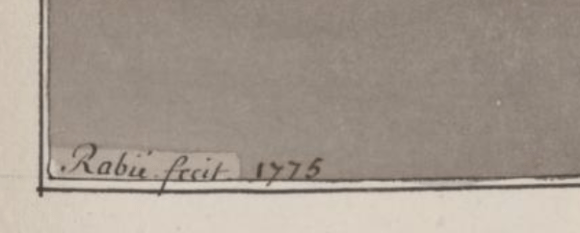
De Rabié attempted to draw his subjects life size, when possible. For the insects, he would draw them at their correct size, then cut them out and paste them on to larger sheets, writing the names and sometimes notes directly on the sheet.
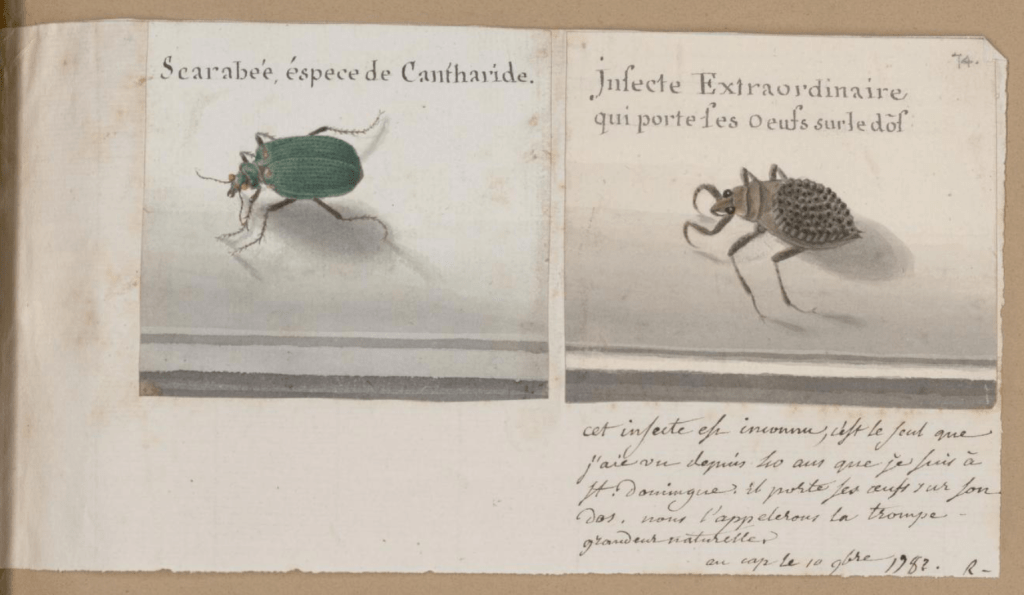
Other Hands
There is, however, at least one other hand at work on the watercolour albums. This hand – the editor – tidies up the original inscriptions, adding capitalisations, expanding abbreviations, correcting misspellings, often re-numbering the paintings, and occasionally providing additional notes.
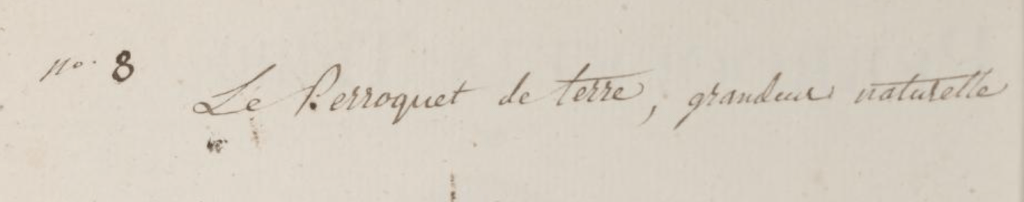
This appears to be the same person that wrote the title pages and prepared the lists in the Tables.

For the most part, the editor simply copies de Rabié’s often untidy script into a more legible form. The objective seemed to be to order the unbound papers; often the transcription is incomplete, as can be seen below. De Rabié includes information on where he observed the flying fish – in the ‘rade’ or road – the sheltered water where ships can anchor – of Le Cap. He says that this species differs from those seen in the open ocean. He painted it on 24 September 1773. The editor only transcribes the name and size of the fish.

In the volume entitled ‘Fruits’, however, the editor becomes the author, adding extensive notes for the majority of the plants depicted. The note on ‘canne à sucre’, for example, takes up almost the entire back of the sheet in two columns. It also provides a clue to the author/editor.
The watercolour, according to de Rabié’s note, was painted in 1770. The inscription below this rather perfunctory label includes, however, a detailed description of sugar making, as well as information on the type of sugar grown in Saint Domingue and the productivity of the plantations, citing statistics from 1790, five years after de Rabié’s death. There is also mention of a ‘careful experiment’ (‘une expérience faite avec soin’) comparing the sweetening power of cane sugar to beet sugar.1 These notes point to an author well-informed on the cultivation and manufacture of sugar in Saint Domingue, who also has access to information on sugar yields in 1790, which is almost the last year in which sugar was produced in quantity on the plantations in Saint Domingue. The author also has information about the relatively new process for manufacture of sugar from sugarbeet, first introduced into France at the end of the 18th century and encouraged by Napoléon as a substitute for the sugar no longer available from Saint Domingue, due both to the Haitian Revolution and the continental blockade.
The author also adds many notes about how foods were prepared and who ate them. For example, the note on cassava relates that ‘The juice is released with great care, the root is dried, turned into flour, which is grilled between two hot iron plates, which produces cassava, which is used for bread; on the South American continent, this flour is also prepared in a different way, and is called tapioca.’2 Of the banana, the author writes, ‘The banana is the main food source of the negroes, and even the owners.’3 In describing the Barbados cherry, the author notes, ‘This fruit, which has no stone but seeds, is rather sour and is eaten only in jams.’4 For the banana plantain or fig banana, the note describes how ‘This fruit is eaten ripe, raw, or grilled, or baked in the oven, but it does not replace bread, as the banana does. The cooking banana is a type of banana plant.’ The note adds a cultural reference: ‘It grows slightly less tall and its leaves are less long, it is likely that the leaves of the fig tree used by our first parents to hide their nudity, according to scripture, was the cooking banana, given the size of its leaves.’5
These notes imply long acquaintance with Saint Domingue and appreciation of its local foods and their preparation. They could not, however, have been written by Jaquette Rabié de la Boissière. In 1783 she fell from a horse, and was paralysed on her right side, which forced her to write with her left hand. Her handwriting became almost illegible.
A Family Legacy
Given the care given to these watercolours, however, I would suggest their annotation and preservation were a family project. I think that the author/editor is Armand Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), de Rabié’s grandson. Almost no examples of Paparel de la Boissière’s handwriting have been located. The comparison with his signature on the inventaire of his daughter in 1814 does, however, show a similarity to the handwriting in the additional notes.
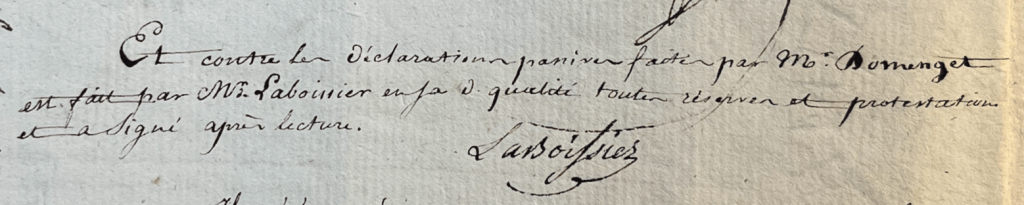
Until the age of 15, Armand Gabriel grew up in Saint Domingue in his grandfather’s house, and he would have been familiar with his grandfather’s great project, perhaps even helping him collect the caterpillars and shells, or hold up the specimens for their portraits. He would also have watched his mother at work on the copies of her father’s bird paintings, which she made in 1778 and 1779, when Armand was 11 and 12.
After the start of the French Revolution in 1789, Paparel de la Boissière returned to Saint Domingue and his mother likely returned to Saint Domingue. The notes about sugar and coffee imply someone with a solid knowledge of cultivation and production of these crops, and an interest in the revenues from plantations. (Almost all former colonists continued to have an interest in their properties, as the detailed account of indemnification for the losses was not published until 1829, and indemnifications remained unpaid for decades after.)
How food is prepared, however, might infer a different kind of knowledge. The re-copying of the inscriptions and the added notes on the ‘Fruits’ may have been written by mother and son together, perhaps during their stay in Philadelphia after 1791, when they sought refuge from another upheaval – the Haitian Revolution. Immersed in a refugee culture, they may have found solace in the ordering and editing of de Rabié’s oeuvre. Sometime around 1800 Paparel de la Boissière returned to France and military service, and by 1801 his mother too is living in Paris.
The care taken in the preservation and subsequent binding of the watercolours after 1833 suggests that they held great meaning for the family. Jaquette Rabié de la Boissière’s abortive attempt to sell them in 1811 speaks to her destitution, but also to her desire to preserve her father’s work in the Muséum. She wrote in a letter of January 1814 that she hoped his work was of value to science (‘cette histoire était utile a la Science’), and she agreed that some of his drawings should be copied for the Muséum collection. She must have also pressed on the Muséum her own copies of the birds, now in the Muséum national d’histoire naturelle collections, though there is no documentary evidence of this donation (see MNHN Cote 5030).
It may have been when Armand Gabriel Paparel de la Boissière returned in 1841 from his position in the civil service at Baume les Dames, that he undertook the task of ensuring his father’s work was properly inventoried and bound. These volumes became part of the family inheritance, likely passing to his wife Reine Antoinette Bullet de la Boissière, and at her death in 1857 to one of her six siblings (only three of whom had offspring). It may have been her brother Abel Ferdinand de Bullet (c1793-1866), who had five children, who inherited the album. (The albums were unlikely to have passed to Paparel de la Boissière’s descendants through his sister, Perrine Françoise, who married first Jean François Vincent de Montarcher (1730-83), as their son, Claude-François Vincent de Montarcher (1762-1840), passed away before Paparel de la Boissière.)
In 1908, Georges Courty (1873-1953), who claimed to be de Rabié’s great nephew, wrote to the Ministère de la Marine requesting to view the documents relating to his ancestor, whom he called ‘naturaliste de St Domingue’. Courty was an established geologist and archaeologist and associated with the Muséum in Paris. He wrote that according to the Archives of the Muséum in Paris, the papers had been lent by de Rabié’s daughter to Georges Cuvier. Courty seems not to have seen the albums, so that it is unlikely they were passed down to him. It is difficult as well to trace Courty’s lineage. If de Rabié was his great-uncle, he would have been part of either Perrine Françoise de la Boissière’s line or related in some way to Anne Lebon’s large and diverse family.
Whoever inherited the de Rabié archive evidently cared for it until its sale to Wheldon and Wesley in the 1920s. Thanks to Casey Wood, de Rabié’s natural history of Saint Domingue is at last in the public domain.
References
1 ‘une expérience faite avec soin a démontré que le sucre de canne comparé au sucre de Betterave, donne à l’eau un cinquieme de plus de douceur.’ (‘A carefully conducted experiment demonstrated that cane sugar compared to beetroot sugar sweetens water by 1/5 more.’) Inscriptions on verso, in “Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo”, vol. 4, 1, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library.
2 ‘on exprime ce jus, … avec grand soin, on fait sécher cette racine, on la réduit en farine qu’on fait griller entre deux plaques de fer chaud, ce qui produit la cassave, qui sert de pain; dans Le continent de l’amerique méridionale, on prépare aussi cette farine d’une autre maniere et qui s’appele tapioca.’ Inscriptions on verso, in “Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo”, vol. 4, 16, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library.
3 ‘Banane est la principale nourriture des negres, et même des propriétaires.’ Inscriptions on verso, in “Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo”, vol. 4, 6, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library.
4 ‘ce fruit qui n’a point de noyau, mais des pepins, est un peu aigre et ne se mange qu’en confitures.’ Inscriptions on verso, in “Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo”, vol. 4, 38, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library.
5 ‘ce fruit se mange mur, cru, ou grillé, ou cuit au four mais il ne remplace pas le pain, comme la Banane. Le figuier-Banane est une espece de Bananier. il vient un peu moins haut et ses feuilles sont moins longues, il est probable que les le figuier dont les feuilles servirent à nos premiers parens à cacher leur nudité, selon L’écriture, étoit le figuier Banane, vû l’ampleur de ses feuilles.’ Inscriptions on verso, in “Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo”, vol. 4, 7, Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library.
Voir l’essai
Les albums créés par René de Rabié (1717-1785) et qui font partie de la Collection Blacker‑Wood de l’Université McGill à Montréal contiennent 266 aquarelles. Peintes par le naturaliste et ingénieur à Saint-Domingue entre 1767 et 1784, elles ont survécu aux révolutions, à la guerre, à des voyages transatlantiques, à de multiples déménagements et à la négligence de ministères, en plus d’être reliées de nouveau plusieurs fois, avant d’être acquises par Casey Wood pour la Bibliothèque de McGill en 1930. On peut consulter les albums ici.
Les aquarelles ont été répertoriées à Paris au début de l’année 1785, après la mort de René de Rabié. Elles ont été décrites comme suit:
Item Collection de dessins d’histoire naturelle, peints d’après nature par M Rabié, concistant en cinquante huit oiseaux, soixante deux fruits, soixante poissons, quinze crabes, soixante treize papillons, cinquante neuf insectes, dix sept coquilles avec les cahiers d’expliquation prisés trois cent quatre vingt livres cy
En 1811, quand Jacquette de la Boissière, fille de René de Rabié, tente de vendre les peintures au Muséum d’histoire naturelle de Paris, celles-ci se trouvent dans une « boîte » ou une « caisse ». Il s’agit peut-être d’une caisse en bois que le naturaliste avait lui-même préparée en 1784 pour le premier envoi de ses aquarelles de Saint-Domingue à Paris. Après le refus des conservateurs du Muséum, la caisse est rendue à Jacquette de la Boissière. Dans les années 1920, au moment où elles sont vendues à Wheldon et Wesley, les aquarelles sont reliées en quatre albums, chacun présentant une couverture en cuir et un titre en lettres dorées : « St Domingue », et le titre du volume : « Oiseaux », « Poissons-Crustacées », « Coquillages-Insectes » et « Fruits ». À l’exception de l’album « Coquillages-Insectes », chaque volume est doté de pages de garde marbrées. Tous portent l’étiquette de l’atelier de reliure Delarue Papetier Aux Deux Créoles, situé au 60, rue du Faubourg Saint-Honoré. L’entreprise, fondée en 1833, a fermé ses portes en 1904.
Chaque volume est précédé d’une page de titre et d’une « table » répertoriant les peintures. Celles-ci ont été renumérotées, probablement quand on les a reliées. Certains des numéros d’origine au recto et au verso, vraisemblablement écrits par René de Rabié, ont été coupés quand les aquarelles ont été rognées, mais selon une analyse des numéros restants et du système de numérotation ultérieur, il ne manquerait que quelques-unes des aquarelles que le naturaliste a apportées à Paris.
Presque toutes les aquarelles comportent des renseignements d’identification et des notes écrites par René de Rabié au verso, indiquant souvent le lieu et la date de la peinture. Il s’agit généralement de notes griffonnées à l’encre ou au crayon, souvent abrégées, par exemple « grand. nat. » pour « grandeur naturelle ». Les notes simples de René de Rabié comprennent souvent un numéro de catalogue, le nom du sujet peint, l’échelle à laquelle il est peint (grandeur nature ou fraction de grandeur nature) et, généralement, la date et le lieu, ainsi qu’une signature (« Rabié » ou parfois simplement « R »).
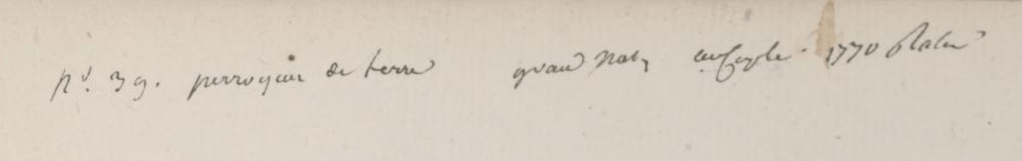
Parfois, les aquarelles sont signées au recto d’une écriture plus formelle, similaire à celle utilisée par René de Rabié sur les cartes et les plans qu’il a dessinés dans le cadre de ses fonctions officielles, ou de façon plus soignée. C’est souvent le cas sur les aquarelles peintes plus tôt (1768) ou sur celles qu’il a dessinées avec des bordures, comme pour les préparer à une éventuelle publication.
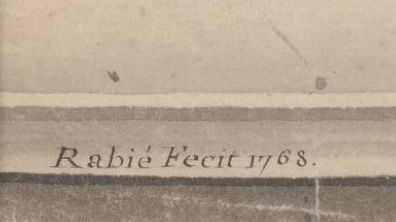
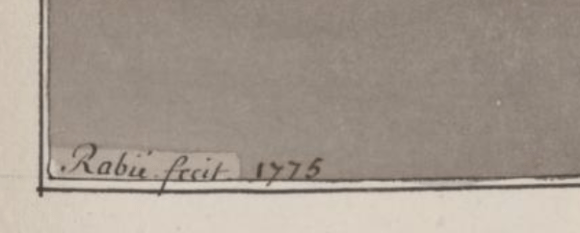
Dans la mesure du possible, René de Rabié dessinait ses sujets en taille réelle. Il dessinait les insectes grandeur nature, puis les découpait et les collait sur des feuilles plus grandes, en écrivant parfois directement sur la feuille leur nom et quelques notes.
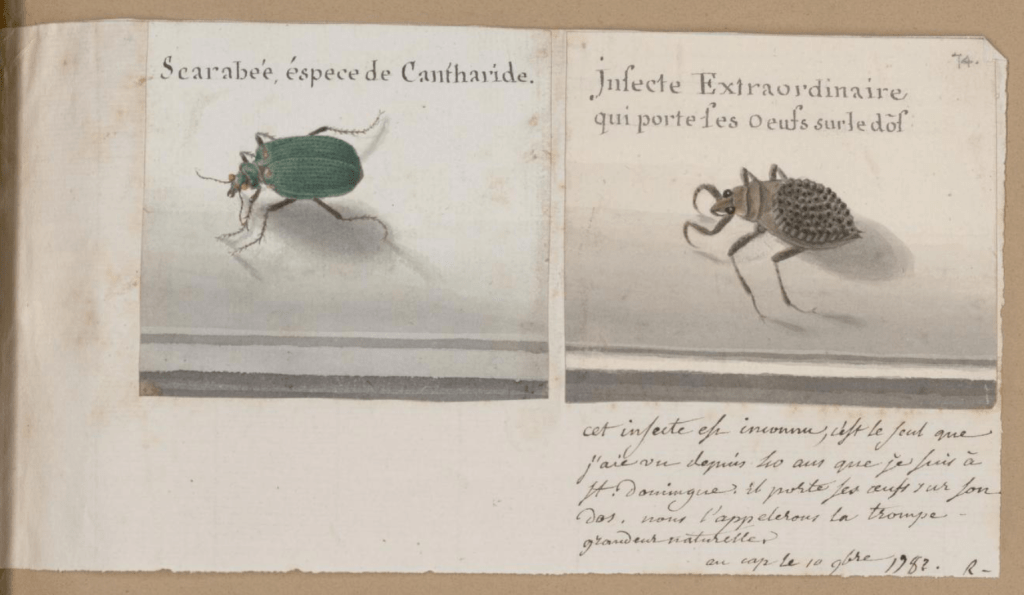
Un autre contributeur
Il y a cependant au moins une autre personne qui contribue à l’œuvre dans ces albums d’aquarelles. Cette personne réalise un travail d’édition : elle met de l’ordre dans les inscriptions originales, ajoute des majuscules, modifie les abréviations, corrige les fautes d’orthographe. Souvent, elle renumérote les peintures, et parfois elle ajoute des notes supplémentaires.
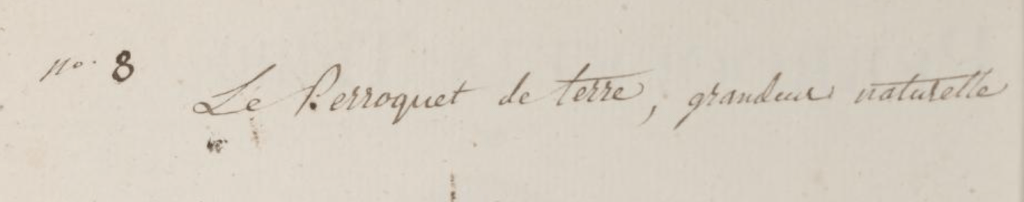
Il semble s’agir de la personne qui a aussi rédigé les pages de titre et préparé les tables des matières.

Dans la plupart des cas, cette personne se contente de copier sous une forme plus lisible l’écriture souvent peu soignée du naturaliste. Son objectif semble être de mettre de l’ordre dans les feuilles non reliées. Souvent, la transcription est incomplète, comme on peut le voir ci-dessous. René de Rabié indique où il a observé le poisson volant : dans la « rade » (eaux abritées où les navires peuvent jeter l’ancre) du Cap. Il précise que cette espèce diffère de celles qui sont observées en pleine mer. Il a peint le poisson le 24 septembre 1773. L’éditeur ne transcrit que le nom et la taille du poisson.

Dans le volume intitulé Fruits, cependant, l’éditeur devient l’auteur : il ajoute des notes détaillées pour la plupart des plantes représentées. La note sur la canne à sucre, par exemple, rédigée en deux colonnes, occupe presque tout l’arrière de la feuille. Elle fournit également un indice sur l’identité de cet auteur-éditeur.
Selon la note de René de Rabié, l’aquarelle a été peinte en 1770. L’inscription sous cette légende plutôt succincte comprend toutefois une description détaillée de la fabrication du sucre, ainsi que des renseignements sur le type de sucre cultivé à Saint-Domingue et la productivité des plantations, et elle cite des statistiques de 1790, cinq ans après la mort du naturaliste. Il est également fait mention d’une « expérience faite avec soin » comparant le pouvoir édulcorant du sucre de canne à celui du sucre de betterave.1 Ces notes indiquent que l’auteur connaît bien la culture et la fabrication du sucre à Saint-Domingue, et a accès à de l’information sur le rendement en sucre en 1790, l’une des dernières années de production de sucre en grande quantité dans les plantations de Saint-Domingue. L’auteur dispose également d’informations sur le procédé relativement nouveau de fabrication du sucre à partir de betteraves, introduit pour la première fois en France à la fin du xviiie siècle et recommandé par Napoléon pour remplacer le sucre que l’on ne pouvait plus aller chercher à Saint-Domingue, en raison de la révolution haïtienne et du blocus continental.
L’auteur ajoute également de nombreuses notes sur la façon dont les aliments étaient préparés et les personnes qui les consommaient. Par exemple, la note sur le manioc indique « on exprime ce jus avec grand soin, on fait sécher cette racine, on la réduit en farine qu’on fait griller entre deux plaques de fer chaud, ce qui produit la cassave, qui sert de pain; dans le continent de l’amerique méridionale, on prépare aussi cette farine d’une autre maniere et qui s’appele tapioca»2 À propos de la banane, l’auteur écrit : « La Banane est la principale nourriture des negres, et même des propriétaires.3 n décrivant la cerise de Barbade, il note : « Ce fruit qui n’a point de noyau, mais des pepins, est un peu aigre et ne se mange qu’en confitures».4 La note sur la figue-banane (banane plantain) indique « Ce fruit se mange mur, cru, ou grillé, ou cuit au four mais il ne remplace pas le pain, comme la Banane. Le figuier-Banane est une espece de Bananier. » La note ajoute une référence culturelle : « Il vient un peu moins haut et ses feuilles sont moins longues, il est probable que le figuier dont les feuilles servirent à nos premiers parents à cacher leur nudité, selon L’écriture, était le figuier Banane, vû l’ampleur de ses feuilles.»5
Ces notes témoignent d’une connaissance de longue date de Saint-Domingue, des aliments locaux et de leur préparation. Elles ne peuvent toutefois pas avoir été écrites par Jacquette Rabié de la Boissière qui, en 1783, a fait une chute de cheval qui l’a paralysée du côté droit, l’obligeant à écrire de la main gauche, ce qui a rendu son écriture presque illisible.
Un héritage familial
Compte tenu du soin apporté à ces aquarelles, il est toutefois probable que leur annotation et leur conservation aient été un projet familial. L’auteur-éditeur est sans doute Armand-Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), petit-fils de René de Rabié. Il n’existe pratiquement aucun exemple de l’écriture de Paparel de la Boissière. La comparaison avec sa signature sur l’inventaire des biens de sa fille en 1814 montre toutefois une similitude avec l’écriture des notes supplémentaires.
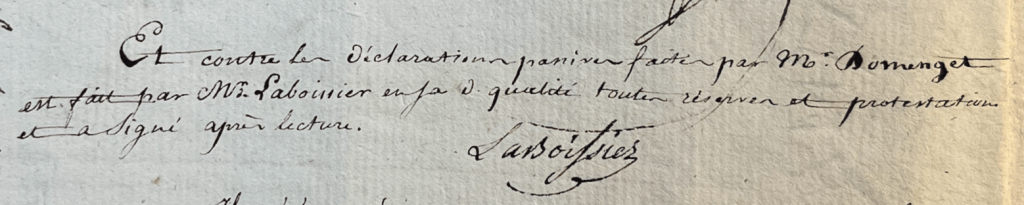
Jusqu’à l’âge de 15 ans, Armand-Gabriel a grandi à Saint-Domingue, dans la maison de son grand-père. Il devait donc bien connaître le grand projet de René de Rabié, et l’a même peut-être aidé à réunir les chenilles et les coquillages, ou à tenir les spécimens pendant qu’ils étaient peints. En 1778 et 1779, alors qu’il était âgé de 11 et 12 ans, il a aussi pu observer sa mère en train de réaliser des copies des peintures d’oiseaux de son père.
Après le début de la Révolution française en 1789, Paparel de la Boissière retourne à Saint-Domingue, et sa mère l’accompagne probablement. Les notes sur le sucre et le café ont sans doute été rédigées par une personne qui connaissait bien la production de ces cultures et qui tirait un revenu des plantations. (Presque tous les anciens colons ont continué de détenir un droit sur leurs propriétés, car le compte rendu détaillé des indemnités exigées pour les pertes subies n’a été publié qu’en 1829, et ces indemnités sont demeurées impayées pendant des décennies.)
Il fallait peut-être un autre type de connaissances pour expliquer la préparation de certains aliments. La copie des inscriptions et l’ajout de notes dans le volume Fruits peuvent avoir été réalisés par la mère et le fils ensemble, peut-être pendant leur séjour à Philadelphie après 1791, alors qu’ils cherchaient refuge contre un nouveau bouleversement : la révolution haïtienne. Plongés dans une culture de réfugiés, ils ont peut-être trouvé du réconfort dans le classement et l’édition de l’œuvre de René de Rabié. Vers 1800, Paparel de la Boissière retourne en France et reprend son service militaire. En 1801, sa mère vit également à Paris.
Compte tenu du soin apporté à la conservation et à la reliure des aquarelles après 1833, celles-ci devaient revêtir une grande importance pour la famille. La tentative infructueuse de Jacquette Rabié de la Boissière de les vendre en 1811 témoigne de son indigence, mais aussi de son désir de préserver l’œuvre de son père en la confiant au Muséum. Dans une lettre datée de janvier 1814, elle écrit espérer que son travail ait une valeur scientifique (« cette histoire était utile à la Science ») et accepter que certains des dessins du naturaliste soient copiés pour la collection du Muséum. Elle a dû également remettre au Muséum ses propres copies des images d’oiseaux, aujourd’hui conservées dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle, bien qu’il n’existe aucune preuve documentaire de ce don (voir la cote MNHN 5030).
C’est peut-être en 1841, lorsque Armand-Gabriel Paparel de la Boissière revient de son affectation dans la fonction publique à Baume-les-Dames, qu’il entreprend de faire inventorier et relier l’œuvre de son père. Ces volumes sont entrés dans l’héritage familial, passant probablement à sa femme Reine Antoinette Bullet de la Boissière, puis, à la mort de celle-ci en 1857, à l’un de ses six frères et sœurs (dont seuls trois avaient des descendants). C’est peut-être son frère Abel Ferdinand de Bullet (vers 1793-1866), père de cinq enfants, qui a hérité de l’album. Il est en effet peu probable que les albums aient été transmis aux descendants de Paparel de la Boissière par l’intermédiaire de sa sœur, Perrine Françoise, qui avait épousé en premières noces Jean François Vincent de Montarcher (1730-1783), car leur fils, Claude-François Vincent de Montarcher (1762-1840), est mort avant Paparel de la Boissière.
En 1908, Georges Courty (1873-1953), qui se dit petit-neveu de René de Rabié, écrit au ministère de la Marine pour demander à consulter les documents relatifs à son ancêtre, qu’il qualifie de « naturaliste de St Domingue ». Géologue et archéologue reconnu associé au Muséum de Paris, Courty écrit que, selon les archives du Muséum, les documents ont été prêtés à Georges Cuvier par la fille de René de Rabié. Courty ne semble pas avoir vu les albums, il est donc peu probable qu’ils lui aient été transmis. Il est également difficile de retracer la lignée de Courty. Si René de Rabié était son grand-oncle, il aurait appartenu à la lignée de Perrine-Françoise de la Boissière, ou aurait appartenu d’une manière ou d’une autre à la grande et diversifiée famille d’Anne Lebon.
Quiconque a hérité des archives de René de Rabié en a manifestement pris soin jusqu’à leur vente à Wheldon et Wesley dans les années 1920. Grâce à Casey Wood, l’histoire naturelle de Saint-Domingue répertoriée par René de Rabié est enfin entrée dans le domaine public.
References
1 « Une expérience faite avec soin a démontré que le sucre de canne comparé au sucre de Betterave, donne à l’eau un cinquieme de plus de douceur. » Inscription au verso, dans « Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo », vol. 4, no 1, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill.
2 Inscription au verso, dans « Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo », vol. 4, no 16, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill.
3 Inscription au verso, dans « Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo », vol. 4, no 6, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill.
4 Inscription au verso, dans « Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo », vol. 4, no 38, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill.
5 ‘Inscription au verso, dans « Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo », vol. 4, no 7, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill.
Dangerously Ephemeral: Paper Production and Preservation in the Eighteenth Century | Dangereusement éphémère : la production et la conservation du papier au xviiie siècle
Written by | écrit par Madison Clyburn
View Essay

Imports from around the world arrived in Le Cap, the city French engineer and naturalist René de Rabié lived in for 42 years. Crushed paint was sold at the “Marché-des-Blancs,” where European merchants and often sailors sold goods from France. Pocket knives, scrapers, and pastel paints were sent from Paris, and Dutch paper was shipped from Holland and Paris. De Rabie likely purchased the majority of his papers and supplies from l’Imprimerie Royale du Cap, which since 1762 was run by Antoine Marie from Nantes. Though the printing house was mainly responsible for publishing Affiches américaines, the colony’s newspaper, it also functioned as a shop, selling quills, sealing wax, portfolios, and very beautiful Dutch paper of different sizes (“très-beau Papier d’Hollande de différentes grandeurs”).1
This is likely where de Rabié purchased the paper used in his drawing of a crab painted with watercolour and gouache in 1782. The drawing is in remarkably good condition, considering it was made in a tropical climate and was shipped to France in 1784. But how were papers protected against heat, humidity, and insects? A solution advertised to protect books and paper from worm and insect attacks was sold at Sieur Menot’s Apothicaire au Cap in 1767—by the spring of 1781, a second anti-insect solution had arrived on the market and was sold by the French colonist Sieur Motard at his home on rue du Lion.2 This unique solution incites questions about eighteenth-century paper making, what a paper surface documents, and the methods used to preserve this dangerously ephemeral material.
Papermaking and Export in the Eighteenth Century
By the eighteenth century, most European paper mills were local production houses, each with varying degrees of durability. Varied tones and surface textures on papers from this time attest to the small-scale local paper mills responsible for producing 500-1,000 sheets of paper per day, depending on the size of the cuts.3 These papers were a mix of pre-sorted and cut linen rags, beaten to a pulp, blended with hemp fibre, set in a mould, dipped in a vat of dilute pulp, and removed to dry. Depending on the papermaker’s method, the papers were stretched, dried on a line, treated, and cut before reaching the market. Other regions practised different papermaking methods.

By the eighteenth century, Dutch papermakers were renowned for their reliable, high-quality papers. Both French and English papermakers were known to imitate Dutch watermarks to signify or increase the quality of their paper. In Saint Domingue, the frequent announcements in Affiches noting the large number of Dutch papers sold at l’Imprimerie Royale du Cap after being unpacked from ships recently arrived from France would suggest that Dutch papers were favoured above any others.
What Does a Paper Wire Profile Say?
A paper’s structure or wire profile often features a watermark, a nod to where the paper was manufactured and by whom and when, in short, a map to the early modern world. In eighteenth-century laid papers, watermarks were centred on one half of the sheet with a countermark centred on the opposite half of the sheet. This way, should the papers be cut to smaller sizes, as they often were, the watermark or countermark would still be evident to the discerning eye if viewed from the paper’s wire side.

The paper de Rabié used for his watercolours includes a variety of watermarks. A watermark on the watercolour of “Le marsouin” (porpoise) is visible once the design is flipped over, and a lightbox is held underneath to reveal a “Pro Patria” watermark representing the Maid of Dort (Dordrecht) and the Garden of Holland (“tuin”). This watermark suggests this particular sheet was made in Holland between the 1760 and 1780s. However, without a countermark, it is impossible to narrow down its production location further. Some watercolours have initials like “VDL,” credited to the Dutch papermaker Van der Ley, who produced paper between 1698 and 1815. Another initial, “IV,” is found on papers dating from 1736-1812. The initial “IV” is associated with the French papermaker Jean Villedary (1668-1758), who was active in Angoumois, France and later in Gelderland, Holland, from 1757-1812, suggesting French or Dutch manufacture. Another example from de Rabié’s volumes features a crowned GR countermark, which likely corresponds to one of Villedary’s paper mills dating to 1745, connoting its French manufacture. Villedary’s watermark of “IV” does, at times, appear in combination with countermarks from other papermakers, meaning Villedary possibly collaborated with other papermakers or other papermakers appropriated his initials—a sign of excellence—to advance their reputation.

Variations of a watermark with a crowned shield mounted with a Strasbourg Lily and the lettering “C&Honig” and “VDL” centres its production in Holland around 1758 to 1760. Other watermarks include one by the Dutch manufacturers D. & C. Blauw and the Oude Blauw mill between 1733 and 1827. D. & C. Blauw refers to an important family of papermakers founded in 1621 by Dirk and Cornelius Blauw, who operated five wind-powered papermills in the Zaanstreek province of North Holland.4 The watermarks on de Rabié’s watercolours align with the many imported Dutch and French papers arriving in Le Cap and are advertised consistently throughout the notices in Affiches américaines.

Preserving Paper in the Tropics
Heat and humidity are not kind to rag paper. During de Rabié’s time in Saint Domingue, he would have also experienced the effects of insects on his art supplies. James Forbes, whose natural history collages reside in McGill’s Blacker Wood Collection, also encountered problems preserving paper during his travels in India. In a letter describing the surroundings, flora, and fauna of Anjengo (now Anchuthengu), Forbes laments “over the ability of ants, termites, and other insects to eat their way through an entire chest of books and papers in a single night.”5
Since books and papers imported and sold in Saint Domingue were easy prey for worms and other insects, paper products were regularly treated with an anti-insect solution in an effort to preserve them for long-term use. After much experimentation in his chemical laboratory, Sieur Menot, an apothecary in Le Cap, extracted the pleasant-smelling liqueur and bottled it for profit. While it may have been helpful for engineer-artists like de Rabié working in Saint Domingue, Menot’s intended clientele were manufacturers whose use of the solution to preserve paper would reflect the service they would be doing for the colony (“du service qu’ils rendront à la Colonie”).6 An advertisement in Affiches américaines notes that its modest price—four escalins for one vial, a carafe for one piastre and a bottle for two piastres—makes it accessible for many people and an inconsequential cost for those who need a lot of it.7 The liqueur was intended to last several years without affecting the paper’s quality.
Exactly one month later, Menot’s second advertisement responds to a flood of inquiries from potential customers to clarify some confusion regarding its use and reiterates instructions on how to treat the paper with said solution (whose ingredients apart from alcohol and sugar remain a mystery).8 To treat the paper, first beat and shake the sheets to remove any foreign bodies. Depending on the item that needed to be preserved, a book might be opened and sprayed with a bottle brush while a sheet of paper, like one de Rabié used for his watercolours, was soaked in the anti-insect liqueur. Then, the book was closed, or sheets of paper were stored together in a closed space, like a box. The next day, they were placed in the sun until the paper dried, after which the paper was ready to be drawn and painted on.
A royal scientific society called the Cercle des Philadelphes launched in the “mad-for-science” summer of 1784.9 The Cercle des Philadelphes, which was interested in all things broadly scientific, wanted to create a learned society focused on science, medicine, and regional development and the organisation of knowledge meant to work in service of colonial administration. The society proposed investigative studies on cochineal (a bug valued for his brilliant red dye) and the creation of a botanical garden, a cabinet for chemistry and natural history, and a public library.

During the first public meeting held on 11 May 1785, the Cercle announced its program of prizes for 1786 and 1787. One of the prizes was meant to help preserve the Cercle and the colony’s use of paper against insect attacks, which, if damaged or illegible, threatened the basis of colonial government. Before and throughout the development of an anti-insect paper treatment, colonists attempted to have enslaved men, women, and children manually pick out bugs and larvae from papers and books.10 All but one of the samples submitted to the Cercle did not work. The one successful sample was made with arsenic and, therefore, was too dangerous for actual use. After several years of failed experimentation, the Cercle remanded the prize, publishing the failed results in 1788.
Considering the speed at which insects ravaged paper in Saint Domingue’s tropical climate, what does the nearly pristine state of de Rabié’s paper collection suggest? Did de Rabié, his daughter, or the enslaved servants in his household experiment with producing a preservative tincture at home? Did his daughter or one of the enslaved servants regularly visit Sieur Menot’s apothecary to purchase a vial of this mysterious liqueur? Did someone or a group of people in the de Rabié household use the prized anti-insect solution to treat the papers that de Rabié applied watercolour and gouache on to document Saint Domingue’s natural history?
References
1 “Avis divers,” in Affiches américaines, 17 December 1766, 434.
2 “MOYEN de garantir les Livres & Papiers de l’attaque des vers & insectes,” in Affiches américaines, 4 février 1767, 39-40; “Avis divers,” Affiches américaines, 22 mai 1781, 1794.
3 Peter Bower, “An Intimate and Intricate Mosaic: Mary Delany & her Use of Paper,” in Mrs. Delany & Her Circle, ed. Mark Laird and Alicia Weisberg-Roberts (New Haven; London: Yale University Press, 2009), 237.
4 Henk Voorn, De papiermolens in de provincie Noord-Holland (De geschiedenis van de Nederlandse papierindustrie, vol. I (Haarlem, 1960), pp. 138.
5 Letter from James Forbes letter, Anjengo, 1772 November 15, copied between 1794 and 1800, Yale Center for British Art, Vol. 6, ff. 65-79. Other examples of people complaining about insect damge occur in Cercle des Philadelphes, Dissertation sur le papier, dans laquelle on a rassemblé tous les essais qui ont été examinées par le Cercle des Philadelphes, sur les moyens de préserver le papier de la piqûre des insects (Port-au-Prince: Mozard, 15 Août 1788), 17. For insects as agricultural pests, see Matthew Mulcahy and Stuart Schwartz, “Nature’s Battalions: Insects as Agricultural Pests in the Early Modern Caribbean,” The William and Mary Quarterly vol. 75, no. 3 (July 2018): 433-464.
6 “Avis divers,” in Affiches américaines, 4 mars 1768, 71.
7 “MOYEN de garantir les Livres & Papiers de l’attaque des vers & insectes,” in Affiches américaines, 4 février 1767, 131-2.
8 “Avis divers,” in Affiches américaines, 20 avril 1768, 131.
9 James E. McClellan III, “Part III. The Cercle des Philadelphes (1784-1792),” in Colonialism and Science: Saint Domingue and the Old Regime (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 183.
10 McClellan III, Colonialism and Science, 218.
Voir l’essai

Les importations provenant du monde entier arrivaient à Cap-Français (le Cap), ville où l’ingénieur et naturaliste français René de Rabié a vécu pendant 42 ans. La peinture broyée était vendue au « Marché-des-Blancs », où les marchands européens, et souvent les marins, vendaient des marchandises provenant de France. Des couteaux de poche, des grattoirs et des pastels étaient envoyés de Paris, et du papier de Hollande était expédié depuis la Hollande et Paris. René de Rabié achetait probablement la plupart de ses papiers et fournitures à l’Imprimerie Royale du Cap, qui était dirigée depuis 1762 par Antoine Marie, originaire de Nantes. L’imprimerie était principalement chargée de publier Affiches américaines, le journal de la colonie, mais elle faisait également office de boutique, et vendait des plumes, de la cire à cacheter, des cartons à dessin et du « très beau papier d’Hollande de différentes grandeurs».1
C’est probablement là que René de Rabié a acheté le papier utilisé pour son dessin d’un crabe peint à l’aquarelle et à la gouache en 1782. Le dessin est dans un état remarquable, si l’on tient compte du fait qu’il a été réalisé dans un climat tropical et expédié en France en 1784. Mais comment protégeait-on le papier contre la chaleur, l’humidité et les insectes? Une solution destinée à protéger les livres et le papier contre les vers et les insectes était vendue chez le Sieur Menot, apothicaire au Cap, en 1767. Au printemps 1781, une deuxième solution anti-insectes était vendue par un colon français, Sieur Motard, dans sa maison de la rue du Lion.2 Cette solution unique soulève des questions sur la fabrication du papier au xviiie siècle, sur l’information fournie par une feuille de papier, et sur les méthodes utilisées pour préserver ce matériau dangereusement éphémère.
La fabrication et l’exportation du papier au xviiie siècle
Au xviiie siècle, la plupart des papeteries européennes étaient des sociétés de production locales, et certaines d’entre elles survivaient moins longtemps que les autres. Les teintes et les textures variées des papiers de cette époque témoignent de l’existence de petites papeteries locales qui produisaient entre 500 et 1 000 feuilles par jour, selon la taille des coupes. Ces papiers étaient faits de chiffons de lin triés et coupés, battus en pâte, mélangés à de la fibre de chanvre, placés dans un moule, trempés dans une cuve de pâte diluée, puis retirés pour le séchage. Les papiers étaient parfois étirés, séchés sur une corde, traités et coupés avant d’être mis sur le marché. Dans d’autres régions se pratiquaient des méthodes différentes de fabrication.

Au xviiie siècle, les fabricants de papier néerlandais étaient réputés pour la fiabilité et la qualité de leurs produits. Les fabricants français et anglais imitaient les filigranes néerlandais afin de souligner la qualité de leur papier. À Saint-Domingue, les annonces fréquentes dans les Affiches américaines faisant état de la grande quantité de papier de Hollande vendu à l’Imprimerie Royale du Cap après avoir été transporté de France par navire laissent à penser que ce papier était préféré à tous les autres.
Que révèle le filigrane d’un papier?
La structure d’un papier comporte souvent un filigrane qui indique où, quand et par qui le papier a été fabriqué. En bref, il s’agit d’une carte du monde moderne à ses débuts. Dans les papiers vergés du xviiie siècle, les filigranes étaient centrés sur une moitié de la feuille, et une contremarque était centrée sur l’autre moitié. Ainsi, si les papiers étaient coupés en morceaux plus petits, comme c’était souvent le cas, le filigrane ou la contremarque restait visible aux yeux perspicaces, sur le côté toile.

Le papier utilisé par René de Rabié pour ses aquarelles comporte divers filigranes. Sur l’aquarelle « Le marsouin », lorsque le papier est retourné et placé au-dessus d’un caisson à lumière, on aperçoit un filigrane, constitué des mots « Pro Patria » et d’une image de la Vierge de Dordrecht et du jardin hollandais (« tuin »). Ce filigrane semble indiquer que la feuille a été fabriquée en Hollande entre 1760 et 1780. Cependant, sans contremarque, il est impossible de déterminer plus précisément son lieu de production. Certaines aquarelles portent les initiales « VDL », attribuées au papetier néerlandais Van der Ley, qui a exercé sa profession entre 1698 et 1815. Une autre initiale, « IV », se trouve sur des papiers datant de 1736 à 1812. L’initiale « IV » est associée au papetier français Jean Villedary (1668-1758), qui travaillait dans l’Angoumois, en France, puis dans la province de Gueldre, aux Pays-Bas, de 1757 à 1812, ce qui laisse supposer que le papier a été fabriqué en France ou aux Pays-Bas. Une autre planche tirée des volumes de René de Rabié présente une contremarque sous forme des lettres GR surmontées d’une couronne, ce qui indique probablement l’une des papeteries de Villedary datant de 1745, et donc une fabrication française. Le filigrane « IV » de Villedary apparaît parfois en combinaison avec les contremarques d’autres papetiers, ce qui semble indiquer que Villedary aurait collaboré avec d’autres papetiers, ou que d’autres papetiers se seraient approprié ses initiales, signe d’excellence, afin de renforcer leur réputation.

Les diverses versions d’un filigrane représentant un écu couronné, le lys de Strasbourg et les mentions « C&Honig » et « VDL » permettent de situer la production du papier en Hollande vers 1758-1760. D’autres filigranes sont visibles, dont celui des fabricants néerlandais D & C Blauw et celui de la papeterie Oude Blauw, exploitée entre 1733 et 1827. D & C Blauw fait référence à une importante famille de papetiers fondée en 1621 par Dirk et Cornelius Blauw, qui exploitaient cinq papeteries à vent dans la province de Zaan, en Hollande-Septentrionale.4 Les filigranes des aquarelles de René de Rabié correspondent à ceux des nombreux papiers importés des Pays-Bas et de France qui arrivaient au Cap et sont régulièrement mentionnés dans les annonces des Affiches américaines.

La conservation du papier sous les tropiques
La chaleur et l’humidité ne sont pas les meilleures alliées du papier de chiffon. Pendant son séjour à Saint-Domingue, René de Rabié a également dû composer avec les effets des insectes sur son matériel artistique. James Forbes, dont les collages d’histoire naturelle sont conservés dans la Collection Blacker-Wood de l’université McGill, a également eu du mal à conserver son papier lors de ses voyages en Inde. Dans une lettre décrivant l’environnement, la flore et la faune d’Anjengo (aujourd’hui connue sous le nom d’Anchuthengu), Forbes déplore « la capacité des fourmis, des termites et d’autres insectes à dévorer en une seule nuit tout le contenu d’un coffre rempli de livres et de papiers ».5
Les livres et les papiers importés et vendus à Saint-Domingue étant la proie facile des vers et d’autres insectes, les produits en papier étaient régulièrement traités avec une solution anti-insectes. Après de nombreuses expériences dans son laboratoire de chimie, le Sieur Menot, apothicaire au Cap, a extrait et commercialisé une liqueur anti-insectes à l’odeur agréable. Si cette concoction pouvait être utile à des ingénieurs-artistes de Saint-Domingue comme René de Rabié, la clientèle visée par l’apothicaire était plutôt constituée de fabricants qui, en l’utilisant pour protéger le papier, « rendront service à la colonie.6 Une publicité parue dans Affiches américaines souligne que son prix modique – quatre escalins pour une fiole, une piastre pour un « poban » (flacon) et deux piastres pour une bouteille – rend la solution accessible à un large public, et abordable pour ceux qui en ont besoin en grande quantité.7 La liqueur était censée se conserver plusieurs années et ne pas altérer la qualité du papier.
Un mois plus tard, la deuxième publicité de Menot répond à une avalanche de demandes de renseignements de clients potentiels, dissipe certaines confusions concernant son utilisation et réitère les instructions sur la manière de traiter le papier avec ladite solution (dont les ingrédients, à part l’alcool et le sucre, demeurent un mystère).8 Pour traiter le papier, il fallait d’abord battre et secouer les feuilles afin d’éliminer tout corps étranger, ouvrir les livres, les asperger avec un goupillon, puis les refermer. Les feuilles de papier, comme celles qu’utilisait René de Rabié pour ses aquarelles, étaient trempées dans la liqueur anti-insectes. Les livres ouverts ou les feuilles étaient exposés au soleil jusqu’à ce que le papier soit sec. On pouvait ensuite dessiner ou peindre sur les feuilles.
Une académie royale appelée le Cercle des Philadelphes a vu le jour à l’été 1784, période faste pour la science.9 Cette académie, qui s’intéressait à tous les domaines scientifiques, voulait créer une société savante axée sur la science, la médecine, le développement régional et l’organisation des connaissances au service de l’administration coloniale. Le Cercle proposait des études approfondies sur la cochenille (insecte apprécié pour la teinture rouge vif qu’il fournit) et la création d’un jardin botanique, d’une bibliothèque publique et d’un cabinet de chimie et d’histoire naturelle.

Lors de la première réunion publique tenue le 11 mai 1785, le Cercle annonce son programme de prix pour 1786 et 1787. L’un de ces prix est destiné à une solution pour protéger le papier utilisé par le Cercle et la colonie contre les attaques d’insectes. Si ce papier était endommagé ou rendu illisible, en effet, le gouvernement colonial serait menacé. Avant et pendant l’élaboration d’une solution anti-insectes pour le papier, les colons ont tenté de faire appel à des esclaves – hommes, femmes et enfants – afin que ceux-ci retirent manuellement les insectes et les larves des feuillets et des livres.10 Tous les procédés analysés par le Cercle se sont révélés inefficaces, sauf un, à base d’arsenic, trop dangereux pour être utilisé. En 1788, après plusieurs années d’expérimentations infructueuses, le Cercle annule le prix et publie ses conclusions négatives.
Compte tenu de la vitesse à laquelle les insectes détruisaient le papier dans le climat tropical de Saint-Domingue, que nous indique l’état presque intact de la collection de papiers de René de Rabié? Le naturaliste, sa fille ou les esclaves de sa maison ont-ils fabriqué une solution protectrice expérimentale à domicile? Est-ce que sa fille ou l’un de ses esclaves se rendait régulièrement chez le Sieur Menot, apothicaire, pour acheter un flacon de cette mystérieuse liqueur? Une ou plusieurs personnes de la maison utilisaient-elles la précieuse solution anti-insectes pour traiter les papiers sur lesquels René de Rabié peignait à l’aquarelle et à la gouache afin de consigner l’histoire naturelle de Saint-Domingue?
References
1 « Avis divers », dans Affiches américaines, 17 décembre 1766, 434.
2 « MOYEN de garantir les Livres & Papiers de l’attaque des vers & insectes », dans Affiches américaines, 4 février 1767, 39-40; « Avis divers », Affiches américaines, 22 mai 1781, 194.
3 Peter Bower, « An Intimate and Intricate Mosaic: Mary Delany and her Use of Paper », dans Mrs. Delany and her Circle, éds. Mark Laird et Alicia Weisberg-Roberts (New Haven; Londres : Yale University Press, 2009), 237.
4 Henk Voorn, De papiermolens in de provincie Noord-Holland (De geschiedenis van de Nederlandse papierindustrie, vol. I (Haarlem, 1960), pp. 138.
5 Lettre de James Forbes, Anjengo, 15 novembre 1772, copiée entre 1794 et 1800, Yale Center for British Art, vol. 6, p. 65 à 79. D’autres exemples de personnes se plaignant des dégâts causés par les insectes figurent dans Cercle des Philadelphes, Dissertation sur le papier, dans laquelle on a rassemblé tous les essais qui ont été examinés par le Cercle des Philadelphes, sur les moyens de préserver le papier de la piqûre des insectes (Port-au-Prince : Mozard, 15 août 1788), p. 17. Pour les insectes nuisibles à l’agriculture, voir Matthew Mulcahy et Stuart Schwartz, « Nature’s Battalions: Insects as Agricultural Pests in the Early Modern Caribbean », The William and Mary Quarterly vol. 75, no 3 (juillet 2018) : p. 433 à 464..
6 « Avis divers », dans Affiches américaines, 4 mars 1768, p. 71.
7 « MOYEN de garantir les Livres & Papiers de l’attaque des vers & insectes », dans Affiches américaines, 4 février 1767, 131-132.
8 “Avis divers,” in Affiches américaines, 20 avril 1768, 131.
9 James E. McClellan III, « Part III. The Cercle des Philadelphes (1784-1792) », dans Colonialism and Science: Saint Domingue and the Old Regime (Chicago : The University of Chicago Press, 2010), p. 183.
10 McClellan III, Colonialism and Science, p. 218.
Fashionable Science and the Hidden Collaboration in de Rabié’s Butterfly Designs | La science à la mode et la collaboration invisible dans les dessins de papillons de René de Rabié
Written by | écrit par Madison Clyburn
View Essay

The third volume of French engineer and naturalist René de Rabié’s Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo includes one hundred and twenty-one watercolour sketches pasted into pages: one-hundred and four images depict insects, of which fifty are butterflies, moths, chrysalids, and larvae. De Rabié does not include their Linnean scientific names. Instead, he gives their French or Kréyol names, or sometimes, as in the case of Plate 19, he ascribes to each butterfly a name which references something else. For example, “Le Nocturne” (The Night) due to the muted marble pattern of its wings that blend with the evening sky; “La Pintade” (The Guinea Fowl) for its white spots against black scales reminiscent of a guinea fowl; “Le Brillant” (The Brilliant) because the sunny tropics amplify its shiny appearance; and “Le Léopard” (The Leopard) due its orange and spotted wing pattern evincing a near fur-like texture. De Rabié’s butterfly watercolours, taken as a whole, reflect the fashionable scientific pursuit of documenting the natural world in the eighteenth century. They also address the question of how de Rabié, with the invaluable assistance of the enslaved women and men he owned who worked in his household, captured, raised, and cared for the caterpillars, chrysalids, and butterflies preserved in his paper collection.
De Rabié was not a professional naturalist and directed much of his time toward advancing his career as chief engineer in Cap Français. However, collecting plants, birds, fish, and insects for the construction of ‘curiosity cabinets’ was a stylish and common enough practice for European residents in Saint Domingue, no matter their profession. De Rabié’s interest in Saint Domingue’s insect population was part of a practice in which he depicted and described living creatures as he saw them in the garden, at home or the market, out at sea, or on trips around the island.
In 1813, the curators at the Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) in Paris assessed de Rabié’s drawings. In their 1814 Rapport, they state: “These coloured drawings are not great works of art; but one cannot pretend that they were not executed in a very good spirit and precisely with the kind of talent one finds in naturalists.”1 The Rapport was written in response to de Rabié’s daughter, Jaquette Anne Marie de Rabié de la Boissière’s (1750-1828) attempt to sell her father’s drawings, initially sent to the Ministre de l’Intérieur in September 1811. Though the Rapport expressed little interest as the works “offer no detail on the characters and the habits of the subject [objets] they concern,” there was interest in some images which the museum lacked, notably the “insect larvae, which we [the MNHN] have otherwise only known well in their perfect state” (i.e., butterflies and moths).2 Today, the watercolours of insect larvae, butterflies, and moths allude to the hidden collaborative art behind building natural history collections.
Catching and Preserving Butterflies
How did de Rabié acquire his insect collection? An entry from 1887 in the Scientific American describes two essential tools to catch butterflies: the net and the poison bottle.3 The ‘butterfly hunter’ purchased their net from a shop or easily made one at home by sewing any light material, like Swiss muslin, to an iron wire and bent into a circle of about ten inches in diameter. The net should be approximately arm’s length in depth and attached to a light stick of about four or five feet long. As seen in a manuscript illustration of two elegantly dressed women, one of whom carries a butterfly net over her right shoulder, little changed in the design of a butterfly net between the thirteenth and eighteenth centuries.

The poison bottle is the butterfly catcher’s second tool: a small glass bottle like those druggists sold quinine was preferable since it could easily be kept in one’s pocket and had a wide enough opening to place insects inside easily. To prepare a poison bottle, first, let the druggist put a half ounce of cyanide of potassium in the bottle; then pour just less than an inch of water over the top; finally, sprinkle in enough plaster of Paris, mixing until it forms a thick cream. Allow the cream to set in fresh air for an hour or two until it forms a solid “cake” in the bottom of the vial. Afterward, wipe the residue on the inside of the bottle above the cake with a cloth. This poisonous concoction lasted several months, allowing butterfly catchers to kill their captures quickly before adding them to their boxed collections or using them for artistic impressions. The artist-naturalist Maria Sibylla Merian (1647-1717) describes another efficient method. Merian writes in a letter to Clara Regina Imhoff (1664-97), a former student and friend from Nuremberg, that if one wishes to kill butterflies quickly, “then one must hold the point of a darning needle in a flame, thus making it hot or glowing red, and stick it into the butterfly. They die immediately with no damage to their wings.”4

Camouflage techniques were also popular if the butterfly hunter had difficulty capturing butterflies in flight with a net. The naturalist Shelley Denton (American, 1859-1938) presents two different methods: to use a deceased butterfly as a decoy to attract others of its species by placing it in a conspicuous and sunny spot or to use a piece of paper or leaf cut to resemble the butterfly one’s trying to catch, again placing it in a prominent and easily accessible spot while remaining hidden nearby.5 Other natural history accounts relay the common practice of using a water gun to hit and stun butterflies so that, upon falling to the ground, they could easily be caught before resuming flight, that is, if they were unharmed.6
Between killing the butterfly and disassembling its body, it might need to be dried to protect it against mildew, which is an especially important step if catching butterflies in a tropical climate. Merian, familiar with the humid environment in Suriname, recommends placing a butterfly in a small box coated in lavender oil to preserve its body against natural decay and hungry pests. If butterfly specimens needed additional preservation, turpentine or terebinth oil was brushed over wings for a glossy and protective finish.7
Although the methods mentioned above result in the reasonably easy capture of butterflies, all harm the specimens. Raising butterflies is one way to prevent injury to an artist-naturalist’s specimens by bringing chrysalides and caterpillars home. After hunting for and catching chrysalides and caterpillars among grasses, shrubs, at the foot of trees, under bark, and the shallow depths of soft ground, the naturalist might place their specimens in a special box fitted with perforated panelling to allow plenty of ventilation and a hinged door for easy access to the inside.
De Rabié most likely did not have to travel far; instead, he need only walk outside to his garden to observe many of the butterflies documented in his collection. Gardens were common in Saint Domingue—owned by both colonists and enslaved people, who planted Indigenous, African, and European plants: strawberries, grapes, figs, apples, mulberry, cherries, bananas, cassavas, mangoes, pineapple, and avocados. These succulent crops attracted many kinds of hungry caterpillars and butterflies.8 Though the names of those who captured chrysalids and butterflies are undocumented, we might speculate that the enslaved men and women who tended the de Rabié household gardens carefully captured them while harvesting vegetables for that day’s meal or collecting fruits to make jams.

These individuals might have brought the caterpillars and butterflies indoors, perhaps in a room within de Rabié home resembling the workshop and garden above with a worktable and shelves lining the walls for future specimens. In this space, the variety of hands and knowledge that make up de Rabié’s natural history collection converge as caterpillars munch on leaves that hidden hands brought them every few days while chrysalids latch to shelves that someone installed for their optimal safety and viewing and newly hatched butterflies fly free inside, allowing those unseen helpful hands to catch them gently or kill them so de Rabié might paint them while contained or still.
Making Butterfly Impressions
Many eighteenth- and nineteenth-century artists practiced lepidochromy, a “most interesting description of a very elegant form of decorative art, which may be termed the decalcomania of butterflies’ wing” on paper, porcelain, or glass.9 The naturalist George Edwards (British, 1694-1773) includes a “Receipt for taking the Figures of Butterflies on thin gummed paper” in a 1748 French edition of his Natural History of Diverse Birds—a recipe and practice he claims to have introduced to England for the first time. This recipe appears again in his Essays Upon Natural History and Other Miscellaneous Subjects (London, 1770). However, an anonymous second edition of The art of drawing, and painting in water-colours (London, 1732) offers similar instructions on making “Impressions of any Butterfly in a Minute in all their Colours” using butterfly wings at an earlier date.
Before lepidochromy’s inclusion in artists’ how-to manuals, early modern European artists experimented with this technique, marking the early origins of mixed-media natural history illustration. In the seventeenth century, Rome was a haven for naturalists and artists associated with the Accademia dei Lincei–one of Europe’s oldest scientific institutions.10 Otto Marseus Van Schrieck (1613-78), known for his sottobosco (‘forest floor’) paintings—a genre characterized by the botanical and zoological life that thrives in nature’s undergrowth—was situated at the heart of these scientific activities during his stay in Rome around 1650.

Though likely not the first, van Schrieck’s paintings perhaps best exemplify the merger between science and art by applying real butterfly wings to canvases. Van Schrieck also used butterfly wings in his paper works, applying watercolour, black ink, cut-out paper, and butterfly wing scales to a paper ground.11 Melchior de Hondecoeter (1636-95) and others, some named—Rachel Ruysch (1664-1750), Elias van den Broeck (c. 1650-1708), Johann Falch (1668-1727), Franz de Hamilton (1640-1715?), and Carl Wilhelm de Hamilton (1668-1754)—and many not (German nuns who created religious narratives like Joseph and Potiphar and David as Harper out of butterfly wings and paper), also incorporated butterfly wings in a hyper-realistic yet ornamental fashion to dazzle the viewer.12
As far as we know, De Rabié did not experiment with lepidochromy. Instead, he sketched butterflies in pencil and watercolour by observing them from life and death. De Rabié’s techniques differ from those outlined in The art of drawing or Edwards’ Natural History. Still, these guides help inform aspects of de Rabié’s potential artistic process. For example, where did de Rabié buy gum water to prepare his paper? Or did he make it at home? He likely did not do it himself but delegated that task, perhaps to an enslaved servant in his household, who purchased it from a local bookshop or acquired the ingredients in the market to prepare in the de Rabié kitchens. Did de Rabié kill his butterflies, enlist the help of others, or only sketch them from life until their natural end?

The static depiction of butterflies in the final version of his watercolours suggests he painted them postmortem (see Plate 19 above). However, some of de Rabé’s designs suggest he copied his specimens from life. A watercolour and ink sketch below captures the spontaneity of the first stages of de Rabiè’s artistic practice. Inscribed on the sheet are various notes: “chenille du 18 janvier 1776; chenille du 18 janvier; A; chrisalide de la chenille du 18 janvier; A; chenille d’oeillets [in pencil] chenille qui vit d’oeillets; le Cayman; E; le manteau ducal; chrisalide de la chenille; de la saryer [?] Batard, son papillon dit manteau ducal; E Robe; A papillon de la chenill du 18 janvier.” One can imagine caterpillars A, B, C, and D scuttling slowly before de Rabié’s hand as he takes their likeness. Perhaps an attendant stood nearby to place the caterpillar back in its shelter once de Rabié finished his sketch. This design also suggests de Rabié’s status as a leisured artist-naturalist. Chrysalis A (“chrisalide de la chenille du 18 janvier”) has emerged as a butterfly (“A papillon de la chenill du 18 janvier”), which suggests that de Rabié happened to be home to observe the transformation firsthand. But when away from home, who cared for the caterpillars, chrysalids, and butterflies pictured here to ensure their survival long enough for de Rabié to mark their impression on paper?
References
1 From Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire and René-Louiche Desfontaines, Rapport. Archives Nationales; Cession: cote F/17/1542/2 (1814), translation by Victoria Dickinson.
2 Translation by Victoria Dickinson.
3 “How to Catch and Preserve Moths and Butterflies,” Scientific American Vol. 57, July 9, 1887, 24.
4 Stadtbibliothek Nürnberg, Manuscript no. 167. Translated by Elisabeth Rücker, in “Maria Sibylla Merian: Businesswoman and Publisher,” in Maria Sibylla Merian 1647-1717: Artist and Naturalist, ed. Kurt Wettengl and trans. John S. Southard (Ostfildern: Ruit Cantz Verlag, 1998), 259.
5 Shelley W. Denton, “Catching Butterflies by Means of Decoys,” The Canadian Entomologist 21 no. 6 (1889): 111-2.
6 Eugene Murray-Aaron, The Butterfly Hunters in the Caribbees (New York: Charles Scribner’s Sons, 1894), 184.
7 Universitätsbibliothek Erlangen, Trew-Bibliothek, Brief-Sammlung Ms. 1834, Merian No. 2, trans. Elisabeth Rücker, from “Maria Sibylla Merian: Businesswoman and Publisher,” in Maria Sibylla Merian 1647-1717: Artist and Naturalist, ed. Kurt Wettengl and trans. John S. Southard (Ostfildern: Ruit Cantz Verlag, 1998), 265.
8 James E. McClellan, Colonialism and Science: Saint Domingue in the Old Regime (Chicago: The University of Chicago Press, 2010), 32-3.
9 Scientific American Vol. LX, May 11, 1889, 288.
10 Eric Jorink, “Between Rome and Amsterdam: The Artistic and Scientific Networks of Otto Marseus van Schrieck,” In Medusa’s Menagerie: Otto Marseus van Schrieck and the Scholars (Hirmer), 83-97. See also, V. E. Mandrij, “Painted by Nature, Printed by Artists Butterfly Materials in the Work of Otto Marseus van Schrieck and Maximilian Prüfer,” Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Online 71, no. 1 (2022): 276–312.
11 Otto Marseus van Schrieck (1613-78), Morning Glory and Butterflies, 17th century, watercolour and black ink on paper, glued-on pieces of paper with insect traces, 19.4 x 15.3 cm, Crocker Art Museum, Sacramento, Inv. no. 1871.467.
12 On nuns’ lepidochromy practices, see Herta Wescher, Collage, trans. Robert E. Wolf (New York: Harry N. Abrams, 1968), 8; for more on lepidochromy history and technique, see Laurent Péru, “Papillon imprimés,” Insectes tome 4, no. 183 (2016): 27-29 or Jean Orousset, “Un art oublié: la lépidochromie,” l’Entomologiste tome 64, no. 1 (2008); 47-58.
Voir l’essai

Le troisième volume de Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo, de l’ingénieur et naturaliste français René de Rabié, comprend cent vingt et une esquisses à l’aquarelle collées sur des pages : cent quatre images représentent des insectes, dont cinquante sont des papillons, des papillons de nuit, des chrysalides et des larves. René de Rabié n’indique pas les noms scientifiques des insectes selon la classification linnéenne. Il leur donne plutôt leur nom français ou créole, ou parfois, comme dans le cas de la planche no 9, il attribue à chaque papillon un nom qui fait référence à autre chose : « Le Nocturne » en raison du motif marbré discret de ses ailes, qui se fondent dans le ciel du soir, « La Pintade » pour ses taches blanches sur fond noir qui rappellent cet oiseau, « Le Brillant » parce que les tropiques ensoleillés rehaussent son éclat, et « Le Léopard » en raison du motif orange et tacheté de ses ailes qui évoque une texture semblable à de la fourrure. Dans leur ensemble, les aquarelles de papillons de René de Rabié reflètent la coutume scientifique à la mode au xviiie siècle qui consistait à documenter le monde naturel. On peut se demander comment l’ingénieur, avec l’aide inestimable des esclaves, femmes et hommes, qui travaillaient pour lui, a capturé, élevé et soigné les chenilles, les chrysalides et les papillons conservés dans sa collection de papier.
René de Rabié n’était pas un naturaliste professionnel. Il consacrait une grande partie de son temps à sa carrière d’ingénieur en chef à Cap-Français. Cependant, les collectionneurs de plantes, d’oiseaux, de poissons et d’insectes étaient nombreux chez les résidents européens de Saint-Domingue, quelle que soit leur profession. Ils constituaient ainsi d’élégants « cabinets de curiosités ». L’intérêt de René de Rabié pour les insectes de Saint-Domingue s’inscrivait dans une pratique qui consistait à représenter et à décrire les créatures vivantes telles qu’il les voyait dans son jardin, chez lui, au marché, en mer ou lors de ses voyages autour de l’île.
En 1813, les conservateurs du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) à Paris évaluent les dessins de René de Rabié. Dans leur Rapport de 1814, ils écrivent : « Ces dessins coloriés ne sont pas des chefs-d’œuvre; mais on ne peut se dissimuler qu’ils ne soient faits dans un très bon esprit et précisément avec le genre de talent qu’exigent les naturalistes. »1 Ce rapport a été rédigé à la suite de la tentative de la fille du naturaliste, Jacquette Anne-Marie Rabié de la Boissière (1750-1828), de vendre les dessins de son père, initialement envoyés au ministre de l’Intérieur en septembre 1811. Bien que peu d’intérêt soit manifesté dans le rapport pour ces œuvres, qui « n’offrent aucun détail sur les caractères et les mœurs des objets qu’ils concernent », certaines images qui manquaient au musée ont suscité un certain intérêt, notamment celles des « larves d’insectes qui nous [le MNHN] sont d’ailleurs parfaitement connus dans leur état parfait » (c’est-à-dire les papillons et les papillons de nuit). Aujourd’hui, les aquarelles de larves d’insectes, de papillons et de papillons de nuit témoignent d’un art collaboratif discret ayant contribué à la constitution des collections d’histoire naturelle.
Capture et préservation des papillons
Comment René de Rabié a-t-il acquis sa collection d’insectes? Un article de 1887 paru dans le Scientific American décrit deux outils essentiels pour attraper les papillons : le filet et le flacon à poison.2 Les « chasseurs de papillons » achetaient leur filet dans un magasin ou le fabriquaient facilement chez eux en cousant un tissu léger quelconque, comme de la mousseline suisse, à un fil de fer recourbé en cercle d’environ vingt-cinq centimètres de diamètre. Le filet devait avoir une profondeur équivalente à la longueur d’un bras, et être fixé à un bâton léger de 120 à 150 cm de long. Comme le montre une illustration de manuscrit représentant deux femmes élégamment vêtues, dont l’une porte un filet à papillons sur l’épaule droite, ce filet a peu évolué dans sa conception entre le xiiie et le xviiie siècles.

Le flacon à poison est le deuxième outil des chasseurs de papillons : une petite fiole en verre était préférable, comme celles que les droguistes vendaient pour la quinine, car elle pouvait facilement se glisser dans une poche et avait une ouverture suffisamment large pour y placer facilement des insectes. Pour préparer une bouteille de poison, il fallait d’abord demander au droguiste de mettre 15 grammes de cyanure de potassium dans la bouteille, verser un peu moins de 2,5 cm d’eau par-dessus et, enfin, saupoudrer du plâtre de Paris et mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème épaisse. Il fallait ensuite laisser la crème reposer à l’air libre pendant une heure ou deux, jusqu’à ce qu’elle forme une pâte solide au fond du flacon. On essuyait ensuite les résidus à l’intérieur de la bouteille au-dessus de cette pâte avec un chiffon. Cette concoction toxique se conservait plusieurs mois, et permettait aux chasseurs de papillons de tuer rapidement leurs proies avant de les ajouter à leurs collections ou de les peindre. L’artiste naturaliste Maria Sibylla Merian (1647-1717) décrit une autre méthode efficace. Dans une lettre à Clara Regina Imhoff (1664-1697), une ancienne élève et amie vivant à Nuremberg, elle écrit que pour tuer rapidement des papillons, « il faut tenir la pointe d’une aiguille à repriser dans une flamme pour la rendre chaude ou rouge incandescente, puis la planter dans le papillon. Il meurt immédiatement et ses ailes demeurent intacte ».
3

Les chasseurs de papillons qui avaient du mal à capturer les papillons en vol avec un filet recouraient fréquemment à des techniques de camouflage. Le naturaliste Shelley Denton (États-Unis, 1859-1938) présente deux méthodes : placer un papillon mort dans un endroit bien visible et ensoleillé pour attirer d’autres papillons de la même espèce, ou placer une feuille ou un morceau de papier découpé pour ressembler au papillon que l’on tente d’attraper dans un endroit bien visible et facilement accessible, en restant caché à proximité.4 Selon d’autres comptes rendus, une pratique courante consistait à utiliser un pistolet à eau pour frapper et étourdir les papillons afin que, une fois tombés au sol, ils puissent être facilement capturés avant de reprendre leur vol, à condition qu’ils ne soient pas blessés.5
Entre le moment où le papillon est tué et celui où il est disséqué, il peut être nécessaire de le sécher pour le protéger contre la moisissure, une étape particulièrement importante sous un climat tropical. Maria Sibylla Merian, qui connaissait bien l’environnement humide du Suriname, recommande de placer le papillon dans une petite boîte recouverte d’huile de lavande afin de le protéger contre la décomposition naturelle et les insectes nuisibles. Si les spécimens de papillons devaient être conservés plus longtemps, on badigeonnait les ailes de térébenthine ou d’huile de térébinthe pour les protéger et leur donner un fini brillant.6
Bien que les méthodes mentionnées ci-dessus permettent de capturer assez facilement les papillons, elles endommagent les spécimens. Un bon moyen de ne pas endommager les spécimens d’un artiste naturaliste en ramenant les chrysalides et les chenilles à la maison est l’élevage des papillons. Après avoir cherché et capturé des chrysalides et des chenilles dans les herbes, les arbustes, au pied des arbres, sous l’écorce et dans les sols meubles peu profonds, le naturaliste pouvait placer ses spécimens dans une boîte munie de panneaux perforés, qui permettaient une bonne aération, et d’une porte à charnières qui en facilitait l’accès.
René de Rabié n’avait probablement pas besoin de se déplacer très loin : il lui suffisait de sortir dans son jardin pour observer bon nombre des papillons figurant dans sa collection. Les jardins étaient courants à Saint-Domingue. Ils appartenaient aux colons ou aux esclaves, qui y plantaient des espèces indigènes, africaines et européennes : fraises, raisins, figues, pommes, mûres, cerises, bananes, manioc, mangues, ananas et avocats. Ces cultures appétissantes attiraient de nombreuses espèces de chenilles et de papillons affamés.7 Bien que les noms des personnes qui capturaient les chrysalides et les papillons ne soient pas documentés, on peut supposer que les hommes et les femmes esclaves qui s’occupaient des jardins de la maison de Rabié les capturaient avec soin en récoltant les légumes pour le repas du jour, ou en cueillant des fruits pour faire des confitures.

Ces personnes ont peut-être rapporté les chenilles et les papillons à l’intérieur, peut-être dans une pièce de la maison de Rabié ressemblant à l’atelier et au jardin ci-dessus, avec un établi et des étagères contre les murs pour les spécimens. Dans cet espace, des gens qui nous sont inconnus aujourd’hui ont mis leurs connaissances diverses au profit de la collection d’histoire naturelle de René de Rabié. Des mains invisibles ont apporté les feuilles que les chenilles grignotaient, installé les étagères auxquelles les chrysalides s’accrochaient, assurant leur sécurité et permettant leur observation, et tué ou tenu délicatement les papillons nouvellement éclos qui volaient librement à l’intérieur, afin que le naturaliste puisse les peindre.
Représentation des papillons
De nombreux artistes des xviiie et xixe siècles pratiquaient la lépidochromie, une « forme très élégante d’art décoratif, que l’on pourrait qualifier de décalcomanie des ailes de papillons » sur papier, porcelaine ou verre.8 Le naturaliste George Edwards (Angleterre, 1694-1773) fournit une « Manière de prendre les figures des Papillons sur du papier mince, gommé » dans une édition française de 1748 de son ouvrage Natural History of Diverse Birds. Il s’agit d’une recette qu’il prétend avoir introduite pour la première fois en Angleterre. Cette recette apparaît à nouveau dans son livre Essays Upon Natural History, and Other Miscellaneous Subjects (Londres, 1770). Cependant, une deuxième édition anonyme de The Art of Drawing, and Painting in Water-Colours (Londres, 1732) propose à une date antérieure des instructions similaires pour réaliser « des impressions de n’importe quel papillon dans toutes ses couleurs en une minute » à partir d’ailes de papillons.
Avant que les manuels pratiques destinés aux artistes ne fassent mention de la lépidochromie, certains artistes européens du début de l’époque moderne avaient expérimenté cette technique, marquant ainsi les débuts de l’illustration naturaliste au moyen de techniques mixtes. Au xviie siècle, Rome était un refuge pour les naturalistes et les artistes associés à l’Accademia dei Lincei, l’une des plus anciennes institutions scientifiques d’Europe.9 Lors de son séjour à Rome vers 1650, Otto Marseus Van Schrieck (1613-1678), connu pour ses peintures sottobosco (« sous-bois »), un genre caractérisé par la faune et la flore des sous-bois, était au cœur de ces activités scientifiques.

Bien qu’elles ne soient probablement pas les premières du genre, les peintures de Van Schrieck sont peut-être le meilleur exemple de la fusion entre science et art, puisque l’artiste a appliqué de véritables ailes de papillons sur ses toiles. L’artiste a également utilisé des ailes de papillons dans ses œuvres sur papier, pour ensuite ajouter de l’aquarelle, de l’encre noire, du papier découpé et des écailles d’ailes de papillons.10 Melchior de Hondecoeter (1636-1695) et d’autres artistes, dont certains sont nommés – Rachel Ruysch (1664-1750), Elias van den Broeck (vers 1650-1708), Johann Falch (1668-1727), Franz de Hamilton (1640-1715?) et Carl Wilhelm de Hamilton (1668-1754) – et de nombreux autres sont anonymes (des religieuses allemandes qui ont créé des récits religieux comme Joseph et Potiphar et David harpiste à partir d’ailes de papillons et de papier) ont également utilisé des ailes de papillons comme ornement hyperréaliste pour éblouir le lecteur.11
À notre connaissance, René de Rabié n’a pas essayé la lépidochromie. Il a plutôt dessiné des papillons au crayon et à l’aquarelle en les observant dans la nature et après leur mort. Ses techniques diffèrent de celles qui sont décrites dans The Art of Drawing ou dans Natural History de George Edwards. Ces ouvrages permettent néanmoins de mieux comprendre certains aspects du possible processus artistique de René de Rabié. Par exemple, où achetait-il l’eau de gomme pour préparer son papier? La fabriquait-il lui-même? Il déléguait peut-être cette tâche à un esclave de sa maison, qui achetait l’eau de gomme dans une librairie locale ou en achetait les ingrédients au marché pour la préparer à la cuisine. René de Rabié tuait-il ses papillons, déléguait-il aussi cette tâche, ou se contentait-il de dessiner ses insectes d’après nature jusqu’à leur mort naturelle?

Compte tenu de la représentation statique des papillons dans la version finale de ses aquarelles, il les a probablement peints après leur mort (voir la planche 19 ci-dessus). Toutefois, d’autres de ces dessins représentent probablement des insectes vivants. Une esquisse à l’aquarelle et à l’encre montre la spontanéité des premières étapes de la pratique artistique de René de Rabié. Diverses notes sont inscrites sur la feuille : « chenille du 18 janvier 1776; chenille du 18 janvier; A; chrisalide de la chenille du 18 janvier; A; chenille d’œillets [au crayon] chenille qui vit d’œillets; le Cayman; E; le manteau ducal; chrisalide de la chenille; de la saryer [?] Batard, son papillon dit manteau ducal; E Robe; A papillon de la chenille du 18 janvier ». On peut imaginer les chenilles A, B, C et D rampant lentement devant la main du naturaliste pendant qu’il les dessine. Peut-être qu’un assistant se tenait à proximité pour replacer la chenille dans son abri une fois le croquis terminé. Ces dessins témoignent peut-être du statut d’artiste naturaliste oisif de René de Rabié. La chrysalide A (« chrisalide de la chenille du 18 janvier ») s’est transformée en papillon (« A papillon de la chenille du 18 janvier »). L’artiste se trouvait-il donc chez lui pour observer la métamorphose de ses propres yeux? Mais alors, lorsqu’il était absent, qui s’occupait des chenilles, des chrysalides et des papillons représentés ici et s’assurait qu’ils survivent assez longtemps pour que la naturaliste puisse immortaliser leur image sur le papier?
References
1 D’après Lamarck, Geoffroy de St-Hilaire et René-Louiche Desfontaines, Rapport. Archives nationales; Cession : cote F/17/1542/2 (1814).
2 « How to Catch and Preserve Moths and Butterflies », Scientific American, vol. 57, 9 juillet 1887, p. 24.
3 Stadtbibliothek Nürnberg, manuscrit no 167. Traduit en anglais par Elisabeth Rücker, dans « Maria Sibylla Merian: Businesswoman and Publisher », dans Maria Sibylla Merian 1647-1717: Artist and Naturalist, éd. Kurt Wettengl et trad. John S. Southard (Ostfildern : Ruit Cantz Verlag, 1998), 259.
4 Shelley W. Denton, « Catching Butterflies by Means of Decoys », The Canadian Entomologist 21 no 6 (1889) : 111-112.
5 Eugene Murray-Aaron, The Butterfly Hunters in the Caribbees (New York : Charles Scribner’s Sons, 1894), 184..
6 Universitätsbibliothek Erlangen, Trew-Bibliothek, Brief-Sammlung Ms. 1834, Merian no 2, trad. Elisabeth Rücker, extrait de « Maria Sibylla Merian: Businesswoman and Publisher », dans Maria Sibylla Merian 1647-1717: Artist and Naturalist, éd. Kurt Wettengl et trad. John S. Southard (Ostfildern : Ruit Cantz Verlag, 1998), 265.
7 James E. McClellan, Colonialism and Science: Saint Domingue in the Old Regime (Chicago: The University of Chicago Press, 2010), 32-3.
8 Scientific American, vol. LX, 11 mai 1889, p. 288.
9 Eric Jorink, « Between Rome and Amsterdam: The Artistic and Scientific Networks of Otto Marseus van Schrieck », dans Medusa’s Menagerie: Otto Marseus van Schrieck and the Scholars (Hirmer), 83-97. Voir également V. E. Mandrij, « Painted by Nature, Printed by Artists Butterfly Materials in the Work of Otto Marseus van Schrieck.
10 Otto Marseus van Schrieck (1613-1678), Morning Glory and Butterflies, xviie siècle, aquarelle et encre noire sur papier, morceaux de papier collés avec traces d’insectes, 19,4 x 15,3 cm, Crocker Art Museum, Sacramento, no d’inv. 1871.467.
11 Sur les pratiques de lépidochromie des religieuses, voir Herta Wescher, Collage, traduit par Robert E. Wolf (New York : Harry N. Abrams, 1968), 8. Sur l’histoire et la technique de la lépidochromie, voir Laurent Péru, « Papillons imprimés », Insectes tome 4, no 183 (2016) : 27-29 ou Jean Orousset, « Un art oublié : la lépidochromie », L’Entomologiste tome 64, no 1 (2008); 47-58.
Flowers, Forts, and Groves: Hidden Knowledge and Labour in de Rabié’s Flap Watercolours | Fleurs, forts et bosquets: le savoir invisible dans les aquarelles à rabat de René de Rabié
Written by | écrit par Madison Clyburn
View Essay
Introduction
While in Cap Français (Le Cap) in 1770, the French engineer and naturalist René de Rabié painted the “Oseille de guinée,” Gwozey-péi, or Roselle (Hibiscus sabdariffa), a species of flowering plant in the genus Hibiscus. The plant is indigenous to Western Africa but arrived in the Caribbean islands through the seventeenth-century transatlantic slave trade. De Rabié depicts a branch of the Roselle plant with its leaf and fruit and a branch of the wild cainito tree (Chrysophyllum cainito), both in their natural sizes. Curiously, the Roselle plant includes an impression of the flower in bloom on a superimposed piece of paper, partially attached to the paper support so that a hand may lift the flap, revealing the bud and calyx underneath.


This was by no means an innovative artistic method. Flap images circulated throughout Europe as early as the 1120s, while moveable images, documented as early as 1250, provided ways to visualize and organize knowledge.1 These artworks–interactive, typically narrative-driven, works on paper supports–span religious, anatomical, and erotic subjects and inform social, religious, economic, or political aspects of the subject depicted.2 The continued popularity of images with parts that lift, shift, and rotate continued into the eighteenth and nineteenth centuries.
Eighteenth and Nineteenth-Century Flap Production
The increasing use of flap images in the eighteenth and nineteenth centuries attests to its useful role in artistic imagination and the colonial agenda. Flap images function as interactive communication for everyone, from mathematicians and obstetricians to landscapers hoping to advertise their work and gain commissions to those wanting to impart religious education or create opportunities for pure entertainment.
In a competing market for business, landscape “Improvers” utilized lift-up flaps to show ‘before and after’ landscape views to entice potential clients. Humphrey Repton (1752-1818) was a landscape architect who favoured the moveable technique in his landscape designs. Repton’s Sketches and hints on landscape gardening: collected from designs and observations now in the possession of the different noblemen and gentlemen, for whose use they were originally made (London, 1794), promise ways to improve clients’ properties and cheer through the reveal that flap watercolour designs provide.


Meanwhile, religious ‘turn-ups’ impart moral education as they encourage the handler to lift, turn, and read the flaps, then repeat the process to create and reveal new images. The call to learn through sight and touch is evident in an originally untitled booklet attributed to the Quaker schoolteacher Benjamin Sands (1748-1810), eventually given the title Metamorphosis; or, a Transformation of Pictures (Philadelphia, c. 1787). Publishers made these cheap, didactic pamphlets by folding a sheet of paper twice to create a narrow strip and then dividing its outmost layer into six equally spaced squares with vertical cuts. This transforms the sheet into four rectangular panels with an image on top and underneath. Each panel features a top and a bottom flap to lift, separating the original image and transforming it into something entirely new. This technique differs from a singular flap watercolour, like de Rabié’s, in which a second piece of paper is partially pasted directly to a paper surface.
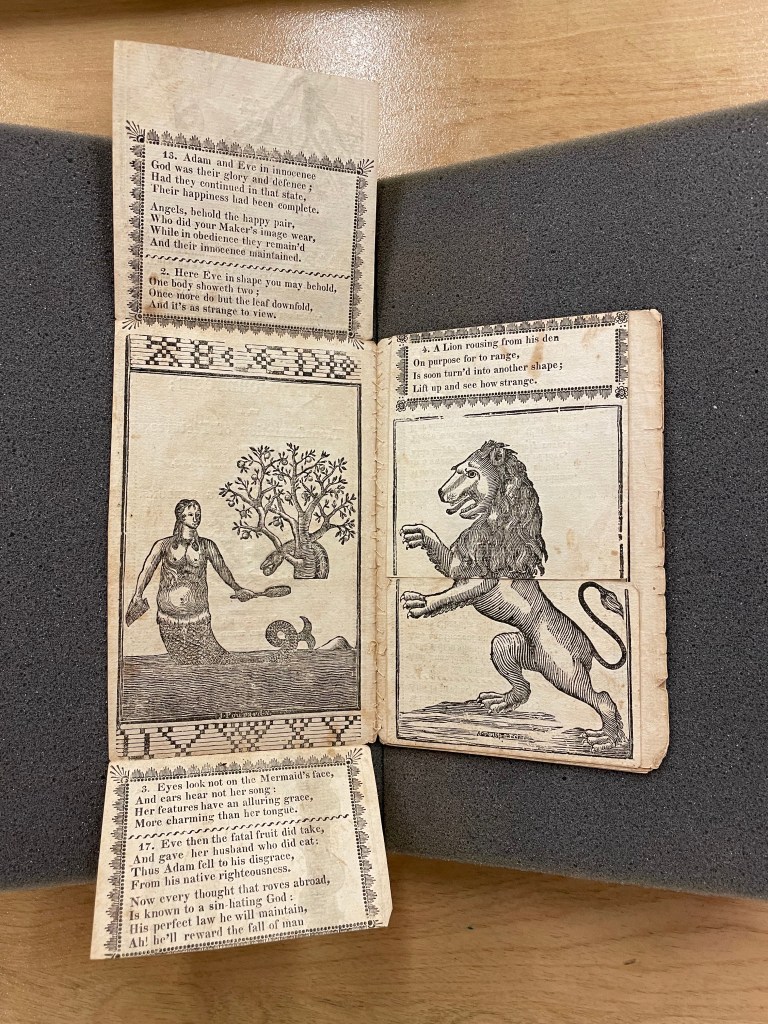
Not all eighteenth and nineteenth-century moveable texts were for economic or moral ends. Some were for the reader or handler’s pure entertainment. For example, Les Transformations Comiques: Pierrot, published in approximately 1880, is a ‘turn up’ pamphlet like Metamorphosis that allows the handler to make and discover a range of humorous transformations. Some moveable books brought the theatre to the homes of many. Armand Bourgade’s Le Diable Rossé (Paris, 1880?) is once such paper theatre. Its pull tabs, located in the bottom center of each page, can be pulled to animate the ‘actors’ on the one-dimensional paper stage.
Even grander is A. Capendu’s Grand Theâtre en Actions (Paris, 1870) with four narratives set into individual panels that lift: “Pauvre Robinson,” “Un Chat comme on en voit peu,” “Trop parler nuit,” and “Réveillez-vous belle endormie.” These four stories, colloquially known as Robinson Crusoe, Puss in Boots, Little Red Riding Hood, and Sleeping Beauty, are most likely what comes to mind when we think of a pop-up diorama book today. Each panel or scene appears like a theatre or peepshow constructed from a four-layered diorama of three cut-outs and a backdrop supported with cardstock strips for optimal perspectival depth accompanied by matching text at the bottom.
This brief walkthrough of a few techniques for creating moveable images in different subjects suggests that they were popular modes of visually and tactilely documenting and disseminating information. With this in mind, what purpose do de Rabié’s flap paintings of the Roselle plant and numerous plans of forts and batteries in Le Cap serve?
René de Rabié’s Flap Watercolours
De Rabié’s flap watercolours do not fall into the moralizing or comic categories. Instead, they record but do not necessarily reveal the hidden knowledge and labour of enslaved peoples who assisted in making his designs a reality. The initial inscription by de Rabié on the back of the image of the Roselle plant identifies the plants but does not offer any further information.3 However, a follow-up inscription in a different unidentified hand does. This second caption could not have been written by his daughter, Jaquette Anne Marie Rabié Paparel de la Boissière (1750-1820), as a riding accident in 1783 paralyzed her right side, forcing her to write, almost illegibly, with her left hand. And so perhaps de Rabié’s grandson, Armand Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), who was familiar with Saint Domingue’s local delicacies from his childhood, wrote the caption that reads: “A branch of the Roselle plant, with its leaf, its flower, and its fruit, natural size, 1770. The fruit is sour and is eaten in jams, which closely resemble currant jelly. A branch of the wild cainito tree. Natural size, see no. 11.”

Today, the Hibiscus rosa-sinensis, choublak, or shoeblack plant–so-called because it was used to polish shoes–is Haiti’s national flower. Its status reflects its long-standing importance within the social fabric of eighteenth-century Saint-Domingue. Regarding the Roselle plant (a different species of Hibiscus), a great deal of knowledge is conveyed through a flap image, which highlights the useful parts of the plant but also its symbolic qualities of resilience and joy as it forcibly travelled with enslaved Africans from West Africa to the Americas through the transatlantic slave trade.
For instance, different plant parts provide the ingredients needed to prepare food and beverages. People used stems, seeds, leaves, fruits (calyces), and flowers to thicken soups, cook with rice, make syrups, jams, sauces, tea, and natural dyes.4 It is also medicinal: its therapeutic properties lower blood pressure, reduce cholesterol and swelling, stimulate diuretic effects and work like an antibiotic.5 Roselle is a critical ingredient in Red Drink, a cooling punch or tea made in many countries in West Africa–you find it as bissap in Senegal, sobolo in Ghana, and zobo in Nigeria. In Saint Domingue, Jamaica, and Brazil, African women and men familiar with the plant made the sweetly tart, spiced Red Drink to cool and help alleviate people’s aching bodies. This boldly red, tangy, therapeutic beverage was consumed to celebrate emancipation and continues to endure today with an additional name–the Juneteenth Drink. Perhaps the de Rabié household learned about the Roselle plant’s nutritive qualities from one of the enslaved people they owned who worked in their house or gardens and who were familiar with utilizing Saint Domingue’s imported plant life, or rather, plants from home, for food and medicaments.
De Rabié’s use of a flap in his watercolour of the Roselle plant is unique among his four volumes of plants, crustaceans, insects and shells. However, that is not to say de Rabié did not often utilize the flap technique for other works. A survey of de Rabié’s maps and architectural plans in the Archives nationales d’outre-mer (ANOM) shows that thirteen of the forty-six drawings include flaps—pieces of cut paper pasted on top of a paper surface to show before and after or exterior and interior perspectives. These plans for forts and batteries speak to the French military presence in Le Cap, such as one for a projected fort on the pass of the Cap du Rade on the Grand Mouton reef. They visually advertise de Rabie’s architectural projects alongside a textual description and an itemized budget.
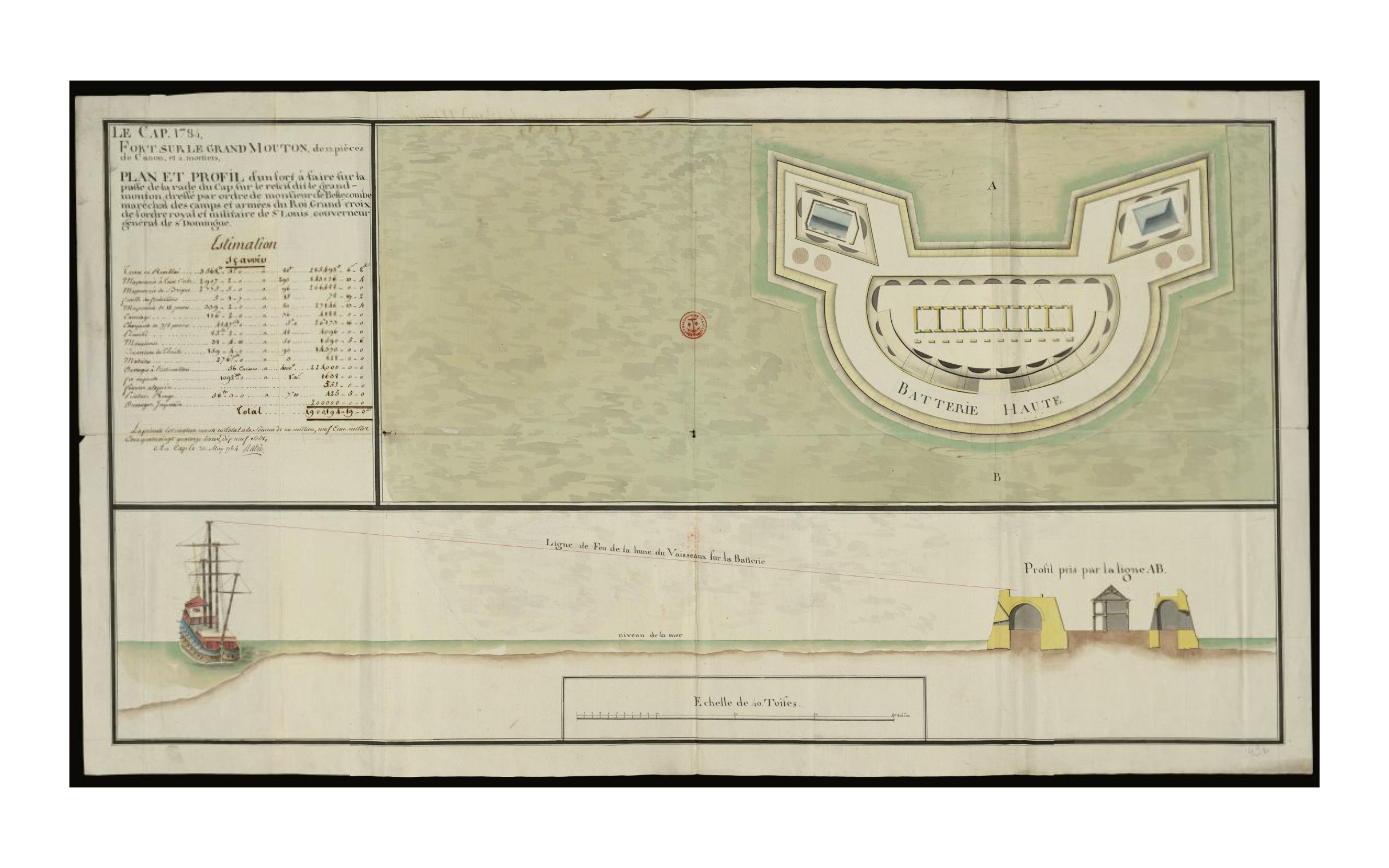
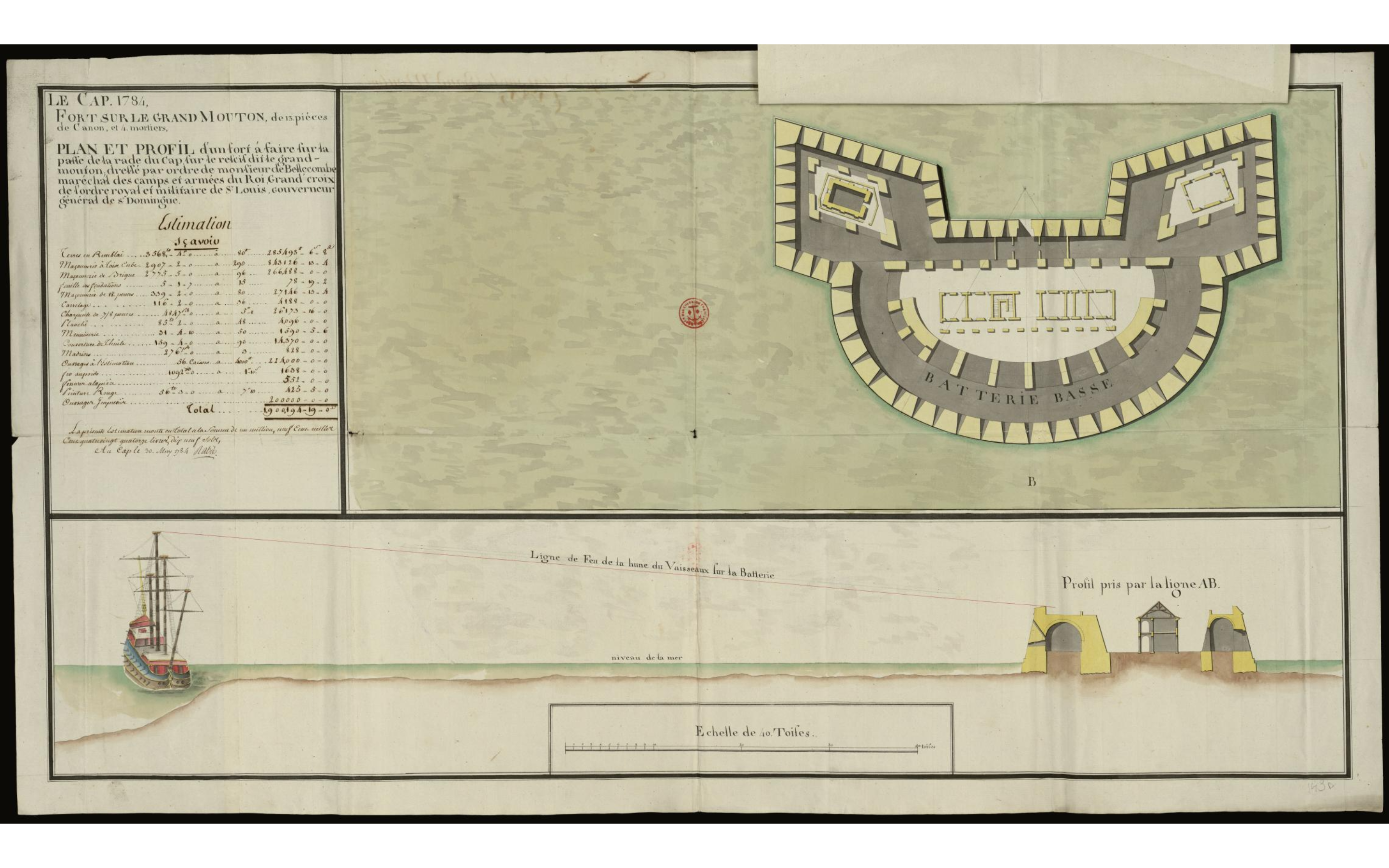
Another drawing, which illustrates a plan of the pathway taken from the exit of Le Cap to the top of the hill where enslaved labourers built the hospital and batteries, includes two flaps. These flap images reveal ways to ‘improve’ the terrain and make it easier for colonial soldiers and settlers to pass through mountainous topography unfamiliar to them. The French state loaned enslaved masons to make these civic projects possible, who then cleared the land with axes and machetes, cut roads into the mountains and constructed paved pathways and lookouts.6
The second flap in the bottom right corner depicts the land immediately in front of the Place Royale, a square located in the southwest sector of Le Cap, with two sets of twelve rows of deciduous trees. Underneath the flap reveals a brown wash without foliage. What is not documented but alluded to in this image are the many people who, with their knowledge of landscaping and gardening, sowed the ground, carried, planted, watered, and trimmed trees to create grounds reminiscent of Versailles. Enslaved gardeners noted for their skills in domestic gardening may have assisted with public works. For example, a notice published in Affiches Américaines, the weekly newspaper in Le Cap, advertises the lease of a pretty garden near the King’s store, as well as an enslaved person whose name is unknown today, noted to be an “excellent gardener.”7 A few years prior, a notice advertising the sale of a garden near Ville du Fort-Dauphin included the enslaved men and women gardeners and brickmakers with the skills to ensure the garden’s success.8
Whether these individuals recorded in the Affiches constructed the pathways or contributed to the landscaping projects outlined in de Rabié’s plans is unknown. However, de Rabié’s moveable watercolours of flowers, forts, and groves encourage reflection on flap technology as a means of revealing and concealing embodied knowledge and the essential role enslaved gardeners’ “hidden hands” played in making de Rabié’s designs for Saint Domingue come to fruition.
References
1 Suzanne Karr Schmidt, “Flaps, Volvelles, and Vellum in Pre-Modern Movable Manuscript and Print,” Journal of Interactive Books vol. 1, no. 1 (April 2022):6-22. DOI: https://doi.org/10.57579/2022JIB001SKS.
2 Jacqueline Reid-Walsh, Interactive Books: Playful Media before Pop-Ups (New York: Routledge, 2018), iii.
3 De Rabié’s inscription reads, “A branch of the Roselle plant with its leaf and its fruit, natural size; and a branch of the wild cainito tree. Natural size, made at Cap-Haïtien in 1770, Rabié. / no. 39.”
4 Judith Carney, In the Shadow of Slavery: Africa’s Botanical Legacy in the Atlantic World (Berkeley: University of California Press, 2011), 178, 182; James J. Beattie, Production of Roselle (U.S. Department of Agriculture, 1937), digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc9193/.
5 A. K. M. Aminulislam et al., “Vegetable Mesta (Hibiscus sabdariffa L. var sabdariffa): A Potential Industrial Crop for Southeast Asia,” in Roselle: Production, Processing, Products and Biocomposites, ed. S. M. Sapuan (London: Academic Press, 2021), 36-37.
6 Gauvin Alexander Bailey, Architecture and Urbanism in the French Atlantic Empire: State, Church, ad Society, 1604-1830 (Montreal; Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2018), 247.
7 “M. Lacombe prévient en outre qu’il affermera le joli Jardin qu’avait le défunt près le magafin du Roi, avec un Négre excellent jardinier, y attaché,” Affiches Américain, 5 Septembre 1780, https://llmc-com.proxy3.library.mcgill.ca/docDisplay5.aspx?set=31772&volume=1780&part=001.
8 “Un Jardin fitué près la Ville du Fort-Dauphin, au bas duquel paffe la riviere. Il y a une manufacture en briqueterie & tuilerie, avec tous fes uftenfiles & 20 Negres ou Négreffes, tant jardiniers que briquetiers. On s’adreffera au Sieur Petiot, Habitant près la Ville du Fort-Dauphin,” Affiches Américain, 30 Août 1777, 520, https://llmc-com.proxy3.library.mcgill.ca/docDisplay5.aspx?set=31772&volume=1777&part=001.
Voir l’essai
Introduction
En 1770, alors qu’il se trouve à Cap-Français (Le Cap), l’ingénieur et naturaliste français René de Rabié peint l’« Oseille de Guinée », gwozey péyi ou roselle (Hibiscus sabdariffa), une espèce de plante à fleurs du genre Hibiscus. Cette plante, originaire d’Afrique occidentale, a été introduite dans les îles des Caraïbes au xvii e siècle pendant la traite transatlantique des esclaves. René de Rabié dessine une branche de roselle avec ses feuilles et ses fruits, ainsi qu’une branche de caïmitier sauvage (Chrysophyllum cainito), toutes deux en grandeur nature. Le dessin de la roselle comprend une curiosité : une fleur qui s’épanouit, dessinée sur un morceau de papier superposé, partiellement fixé au support en papier afin qu’une main puisse soulever le rabat pour révéler le bourgeon et le calice.


paintings on the natural history of St. Domingo, vol. 4, n o 39, Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la
Bibliothèque de l’Université McGill; https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_blackerwood_watercolour- painting-st-domingo_folioM9725R11_v4-20154/mode/2up
Il ne s’agit en aucun cas d’une méthode artistique novatrice pour l’époque. Des images à rabat circulaient déjà en Europe dans les années 1120, tandis que des images mobiles, connues depuis au moins 1250, permettaient de visualiser et d’organiser les connaissances.1 Le sujet de ces œuvres d’art interactives sur support papier est religieux, anatomique ou érotique, et les images fournissent des renseignements sur les aspects sociaux, religieux, économiques ou politiques du sujet en question 2 . La popularité des images comportant des parties qui se soulèvent, se déplacent et tournent ne faiblit pas jusqu’aux xviii e et xix e siècles.2 La popularité des images comportant des parties qui se soulèvent, se déplacent
et tournent ne faiblit pas jusqu’aux xviii e et xix e siècles.
Production d’images à rabat au xviii e et xix e siècles
L’utilisation croissante des images à rabat aux xviii e et xix e siècles témoigne de leur rôle dans l’imagination artistique et le programme colonial. Les images à rabat servent de moyen de communication interactif pour tous, des mathématiciens aux obstétriciens, en passant par les paysagistes qui souhaitent faire la promotion de leur travail et obtenir des commandes, et par les personnes qui veulent enseigner la religion, ou simplement divertir.
Afin d’attirer des clients dans un marché concurrentiel, les paysagistes se servaient de rabats pour montrer les images d’un paysage avant et après leur aménagement. Humphry Repton (1752-
1818), architecte-paysagiste, utilisait cette technique pour montrer ses aménagements paysagers. Son ouvrage Sketches and hints on landscape gardening: collected from designs and observations now in the possession of the different noblemen and gentlemen, for whose use they were originally made (Londres, 1794) montrait les améliorations qu’il pouvait apporter aux propriétés de ses clients grâce à des aquarelles à rabat.


Dans les ouvrages religieux, les rabats inculquent une morale en encourageant le lecteur à soulever, tourner et lire les rabats, puis à répéter le processus pour créer et révéler de nouvelles images. Cette volonté d’enseigner par la vue et le toucher se manifeste dans un livret initialement sans titre attribué à un enseignant quaker, Benjamin Sands (1748-1810), qui a finalement été intitulé Metamorphosis; or, A Transformation of Pictures (Philadelphie, vers 1787). Les éditeurs fabriquaient ces brochures didactiques bon marché en pliant deux fois une feuille de papier pour créer une bande étroite, puis en divisant la couche extérieure en six carrés équidistants à l’aide de coupes verticales. La feuille se transformait ainsi en quatre panneaux rectangulaires, avec une image par-dessus et en dessous. Chaque panneau comportait un rabat supérieur et inférieur à soulever, qui séparait l’image originale et la transformait en quelque chose d’entièrement nouveau. Cette technique diffère de l’aquarelle à rabat unique, comme celle de René de Rabié, dans laquelle un deuxième morceau de papier est partiellement collé directement sur la surface du papier.
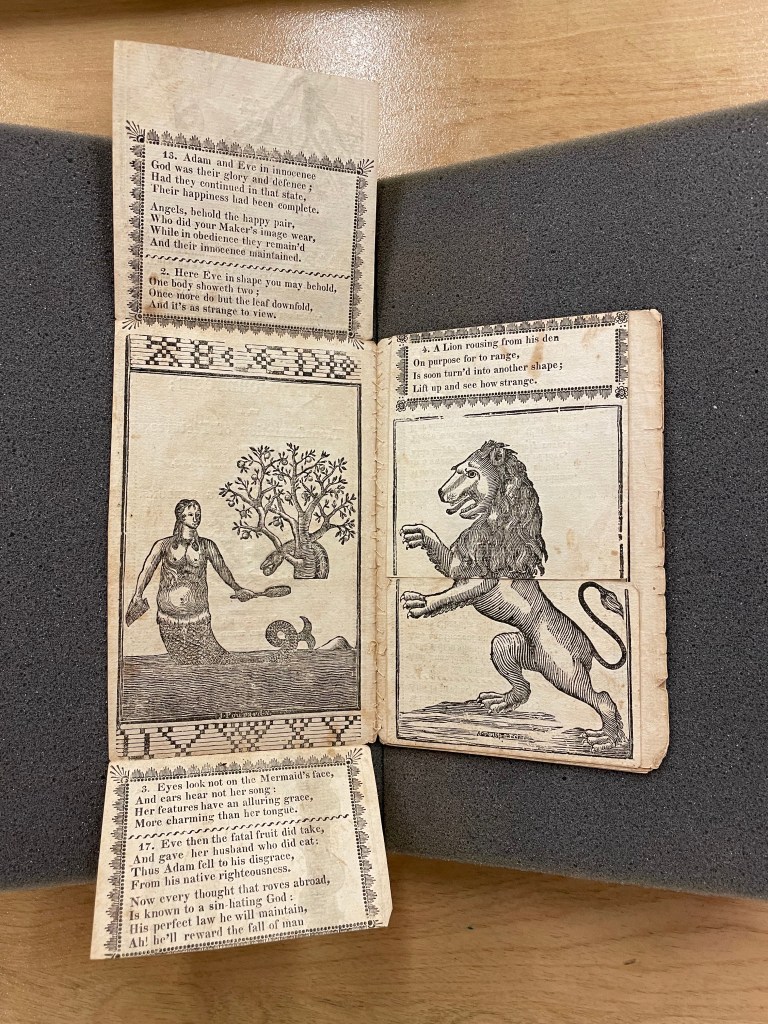
Les textes sur rabats des xviii e et xix e siècles n’avaient pas tous une finalité économique ou morale. Certains d’entre eux étaient destinés au pur divertissement du lecteur. La brochure à rabat Les Transformations comiques : Pierrot, publiée vers 1880 selon le même principe que Metamorphosis, permet par exemple à la personne qui le manipule de créer et de découvrir toute une série de transformations humoristiques. Certains livres animés font entrer le théâtre dans de
nombreux foyers. Le Diable rossé d’Armand Bourgade (Paris, 1880?) est l’un de ces théâtres en papier. Quand elles sont tirées, ses languettes, situées au centre, au bas de chaque page, animent les « comédiens » sur la scène en papier.
Encore plus grandiose, le Grand Théâtre en Actions d’A. Capendu (Paris, 1870) propose quatre récits présentés dans des panneaux individuels qui se soulèvent : « Pauvre Robinson », « Un Chat comme on en voit peu », « Trop parler nuit » et « Réveillez-vous belle endormie ». Ces quatre histoires, mieux connues sous les titres Robinson Crusoé, Le Chat botté, Le Petit chaperon rouge et La Belle au bois dormant, semblent un choix idéal pour un livre animé.
Chaque panneau ou scène apparaît comme un théâtre construit à partir d’un diorama à quatre niveaux composé de trois découpes et d’un fond soutenu par des bandes de carton pour une profondeur de perspective optimale, accompagné au bas du texte correspondant.
Comme l’indique cet aperçu des techniques permettant de créer des images mobiles sur différents sujets, il s’agissait de façons populaires de diffuser de l’information par la vue et le toucher. Dans cette optique, à quoi servaient les peintures à rabat de René de Rabié représentant la roselle et les nombreux plans de forts et de batteries de Cap-Français?
Les aquarelles à rabat de René de Rabié
Les aquarelles de René de Rabié ne relèvent ni de la morale ni de la caricature. Elles témoignent simplement, sans nécessairement les révéler, des connaissances et du travail invisibles des esclaves qui ont contribué à donner corps à ses dessins. L’inscription initiale du naturaliste au dos de l’image représentant la roselle indique le nom de la plante, mais ne fournit aucune autre information 3 , ce que fait cependant une inscription ultérieure, d’une autre main non identifiée. Cette deuxième inscription ne peut pas avoir été faite par sa fille, Jacquette Anne Marie Rabié Paparel de la Boissière (1750-1820), car en 1783, un accident d’équitation l’a paralysée du côté
droit, la contraignant à écrire, de manière presque illisible, de sa main gauche. C’est donc peut-être le petit-fils de René de Rabié, Armand Gabriel Paparel de la Boissière (1767-1854), qui depuis son enfance connaissait bien la flore de Saint-Domingue, qui a rédigé la note se lisant comme suit : « Une branche d’oseille de guinée, avec sa feuille, sa fleur et son fruit, grandeur naturelle, 1770. Le fruit est acide et se mange en confiture, qui approche beaucoup de la gelée de
groseilles. Une branche de caïmitier sauvage – grandeur naturelle, voir le n o 11. »

Aujourd’hui, l’Hibiscus rosa-sinensis (choublak en créole haïtien), aussi appelée shoeblack en anglais parce qu’elle était utilisée pour cirer les chaussures, est la fleur nationale d’Haïti. Ce statut reflète son importance de longue date dans le tissu social de Saint-Domingue au
xviii e siècle. Quant à la roselle (une espèce différente d’Hibiscus), que René de Rabié appelle l’Oseille de Guinée, l’image à rabat fournit de nombreuses informations sur les parties utiles de la plante, mais aussi sur le fait qu’elle symbolise la résilience et la joie, car elle a été transportée avec les esclaves africains d’Afrique de l’Ouest vers les Amériques pendant la traite transatlantique.
Différentes parties de la plante, par exemple, fournissent les ingrédients nécessaires à la préparation d’aliments et de boissons. Les tiges, les graines, les feuilles, les fruits (calices) et les fleurs étaient utilisés pour épaissir les soupes, cuire le riz et confectionner des sirops, des confitures, des sauces, du thé et des colorants naturels.4 La plante possède également des vertus médicinales : elle réduit la tension artérielle, le taux de cholestérol et les gonflements, et a des effets diurétiques et antibiotiques.5 La roselle est un ingrédient essentiel d’une boisson rouge, préparée sous forme de punch rafraîchissant ou de thé dans de nombreux pays d’Afrique de
l’Ouest. On trouve cette boisson sous le nom de bissap au Sénégal, de sobolo au Ghana et de zobo au Nigeria. À Saint-Domingue, en Jamaïque et au Brésil, les Africaines et les Africains qui connaissaient bien cette plante préparaient une boisson rouge épicée, sucrée et acidulée, qui rafraîchissait et soulageait les douleurs physiques. Cette boisson thérapeutique rouge vif était consommée pour célébrer l’émancipation, et elle existe aujourd’hui sous un autre nom: Juneteenth Drink. La famille de Rabié a peut-être découvert les qualités nutritives de la roselle grâce à l’un des esclaves qui travaillaient dans sa maison ou ses jardins, et qui connaissaient bien
les utilisations alimentaires et médicinales des plantes importées de leur pays natal à Saint-Domingue.
L’aquarelle de la roselle est la seule œuvre de René de Rabié qui présente un rabat dans ses quatre volumes consacrés aux plantes, aux crustacés, aux insectes et aux coquillages. Le naturaliste a toutefois utilisé la technique du rabat dans d’autres œuvres. Une étude de ses cartes et de ses plans architecturaux conservés aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM) montre que treize des quarante-six dessins comportent des rabats, morceaux de papier découpés et collés sur une surface en papier afin de montrer des images extérieures et intérieures, ou avant et après un aménagement. Ces plans de forts et de batteries témoignent de la présence militaire française au Cap, comme le plan d’un fort projeté sur la passe de la rade du Cap, sur le récif du Grand Mouton. Ils présentent visuellement les projets architecturaux de René Gabriel de Rabié, et sont accompagnés d’une description textuelle et d’un budget détaillé.
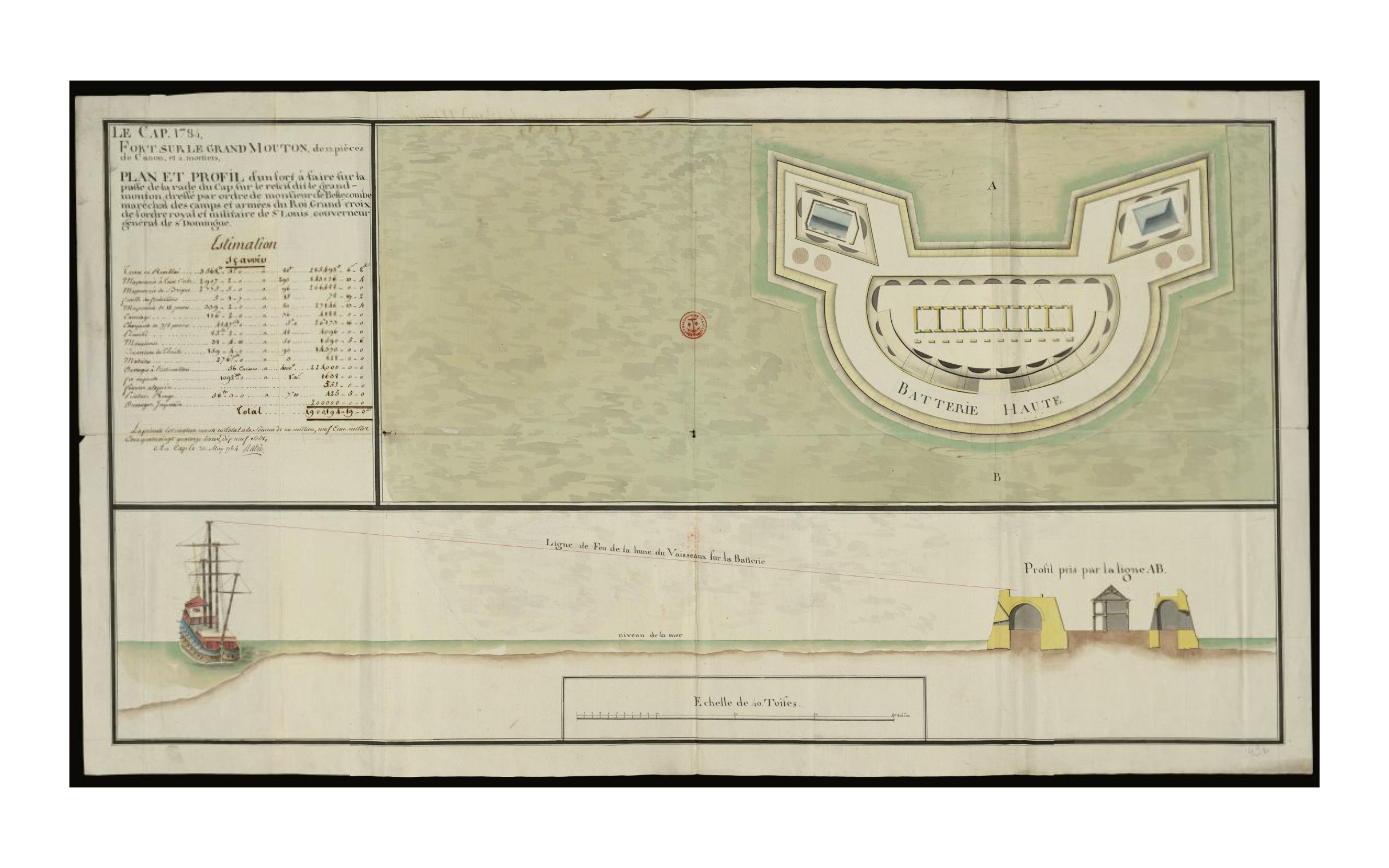
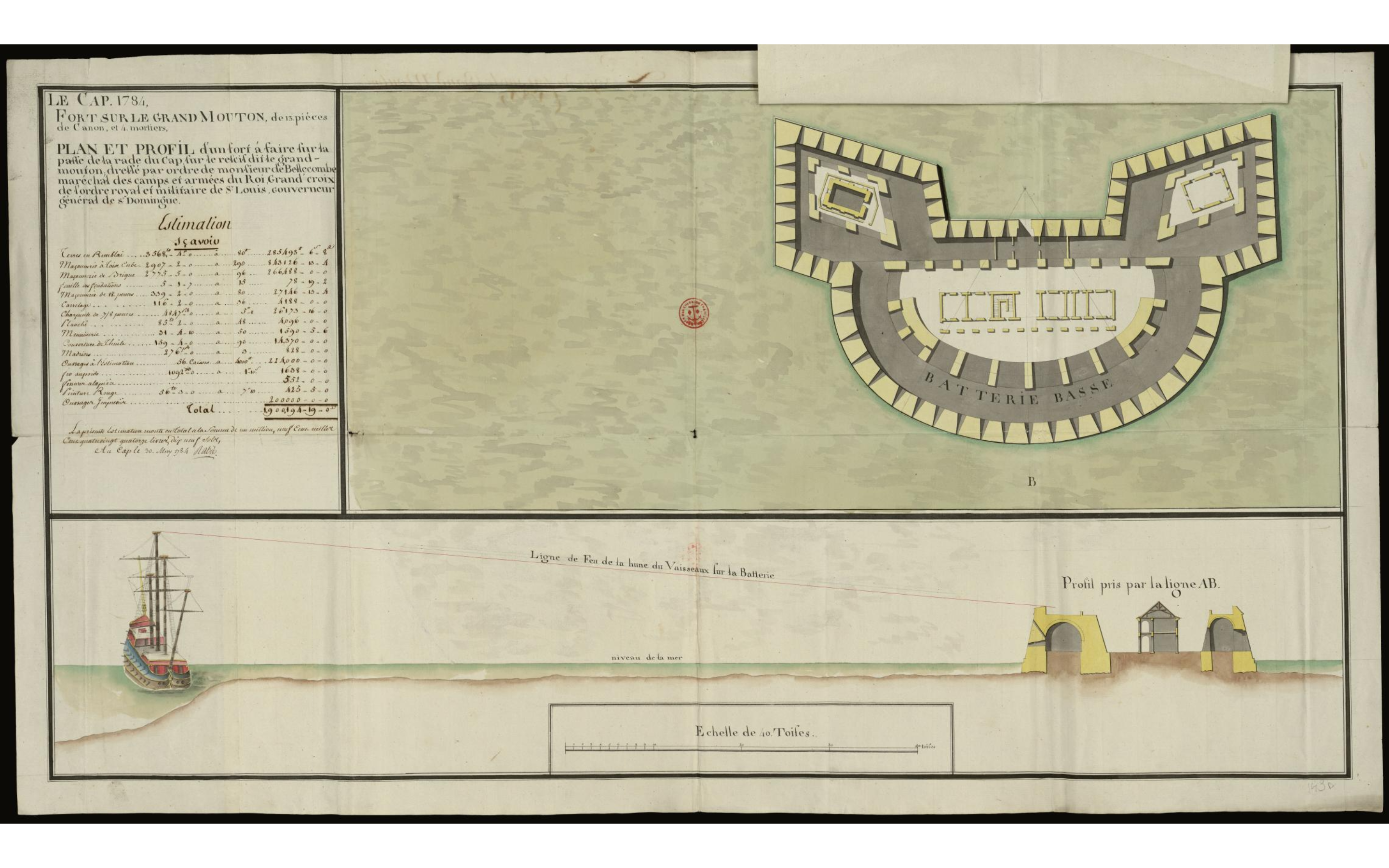
Un autre dessin, qui illustre un plan du chemin emprunté depuis la sortie du Cap jusqu’au sommet de la colline où des esclaves ont construit l’hôpital et les batteries, comprend deux rabats. Ces images révèlent les modifications qui pourraient être apportées au terrain pour faciliter le passage des colons et des soldats dans une région montagneuse qui leur est inconnue. L’État français a prêté des maçons en esclavage pour concrétiser ces projets civiques. Ces
esclaves ont défriché le terrain à la hache et à la machette, creusé des routes dans les montagnes et construit des chemins pavés et des belvédères.6
Le deuxième rabat, dans le coin inférieur droit, représente le terrain situé juste devant la place Royale, située dans le secteur sud-ouest du Cap, avec deux séries de douze rangées d’arbres à feuilles caduques. Sous le rabat, on aperçoit un lavis de bistre sans arbres. Les nombreuses personnes qui, grâce à leurs connaissances en aménagement paysager et en jardinage, ont semé le sol, puis transporté, planté, arrosé et taillé les arbres afin de créer un paysage rappelant Versailles ne sont pas représentées sur l’image, mais on peut deviner leur présence. Des jardiniers en esclavage réputés pour leur expertise des jardins potagers ont peut-être participé aux travaux publics. Par exemple, une annonce publiée dans Affiches américaines, l’hebdomadaire du Cap, propose à la location un joli jardin près du magasin du Roi, ainsi qu’un esclave dont le nom est aujourd’hui inconnu, décrit comme un « excellent jardinier.7 Quelques années auparavant, une annonce pour la vente d’un jardin près de la ville de Fort-Dauphin mentionnait des hommes et des femmes esclaves, jardiniers et briquetiers, ayant les compétences nécessaires pour assurer la réussite du jardin.8
On ignore si les personnes mentionnées dans les Affiches américaines ont construit les chemins ou contribué aux projets d’aménagement paysager décrits dans les plans de René de Rabié. Ses aquarelles mobiles représentant des fleurs, des forts et des bosquets invitent toutefois à réfléchir sur la technologie des rabats comme moyen de révéler et de dissimuler des connaissances incarnées, ainsi que sur le rôle essentiel que les « mains invisibles » des jardiniers esclaves ont joué dans la réalisation des dessins de Saint-Domingue réalisés par René de Rabié.
References
1 Suzanne Karr Schmidt, « Flaps, Volvelles, and Vellum in Pre-Modern Movable Manuscript and Print», Journal of Interactive Books vol. 1, no. 1 (avril 2022):6-22. DOI: https://doi.org/10.57579/2022JIB001SKS.
2 Jacqueline Reid-Walsh, Interactive Books: Playful Media before Pop-Ups (New York: Routledge, 2018), iii.
3 De Rabié’s décrit ainsi l’image, « Une branche d’oseille de Guinée avec sa feuille et son fruit, grandeur naturelle; et une branche de caïmitier sauvage. Grandeur naturelle, réalisée au Cap en 1770, Rabié. / n o 39. »
4 Judith Carney, In the Shadow of Slavery: Africa’s Botanical Legacy in the Atlantic World (Berkeley: University of California Press, 2011), 178, 182; James J. Beattie, Production of Roselle (U.S. Department of Agriculture, 1937), digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc9193/.
5 A. K. M. Aminulislam et al., “Vegetable Mesta (Hibiscus sabdariffa L. var sabdariffa): A Potential Industrial Crop for Southeast Asia,” in Roselle: Production, Processing, Products and Biocomposites, ed. S. M. Sapuan (London: Academic Press, 2021), 36-37.
6 Gauvin Alexander Bailey, Architecture and Urbanism in the French Atlantic Empire: State, Church, ad Society, 1604-1830 (Montreal; Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2018), 247.
7 “M. Lacombe prévient en outre qu’il affermera le joli Jardin qu’avait le défunt près le magafin du Roi, avec un Négre excellent jardinier, y attaché,” Affiches Américain, 5 septembre 1780
8 “Un Jardin fitué près la Ville du Fort-Dauphin, au bas duquel paffe la riviere. Il y a une manufacture en briqueterie & tuilerie, avec tous fes uftenfiles & 20 Negres ou Négreffes, tant jardiniers que briquetiers. On s’adreffera au Sieur Petiot, Habitant près la Ville du Fort-Dauphin,” Affiches Américain, 30 Août 1777, 520,
Jacquette Anne Marie Rabié Paparel de la Boissière (1750 – 1820)
Eldest daughter of René Gabriel de Rabié | Fille aînée de René Gabriel de Rabié
Biography
Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson
View Essay
René Gabriel de Rabié’s eldest daughter Jacquette Anne Marie was a hidden hand in her father’s work in natural history. She copied his paintings, and attempted to preserve them, first offering them to Muséum d’histoire naturelle in Paris, and then ensuring that her son valued his grandfather’s legacy.
An Extended Family
René Gabriel de Rabié (1717-85) arrived in Saint Domingue in 1742 at the age of 25. Within a few years he had established himself as an engineer in Cap Français, where he likely met Anne Françoise Lebon dit Lapointe (1718-before 1780), daughter of a large Créole family in Saint Domingue. (In the context of Saint Domingue in the 18th century, the term “Créole” referred to a person born in the colony, and could comprise residents of European, African or mixed descent.)
Their first daughter Jacquette (Jaquette) was born in 1750. A copy of her baptismal record in the Archives de la Marine provides a glimpse into the Lebon family connections. They included members of the Rotureau and de Saint Martin families, plantation owners in Marmelade. Later another family married into the Lebon-Saint Martin circle, the Aubert du Petit-Thouars, originally from Saumur in France. Another family also married into the Saint Martin clan – the Bullets.
This dense web of familial relationships framed Jaquette de Rabié’s life. In 1793, her son Armand Gabriel François Paparel de La Boissière (1767-1854) would marry his cousin Marie Louise Françoise Martine Aubert du Petit Thouars (1772-95) in Paris. Over thirty years later, the widowed Armand Gabriel married again, to another cousin, Reine Antoinette de Bullet (1788-1851).
The extended Lebon dit Lapointe family also included members described in baptismal records as “Mulâtre libre” or “Mulâtresse libre” (a free person of colour). Simon Lebon dit Lapointe, Anne Lebon’s uncle, had married an African woman named Marie Castau; they had two children, Louis (born in 1733) and Geneviève. Both were described on their marriage certificates as people of colour, and it was noted that both could read and write, an indication of their social status.
The Family Properties
The de Rabié family and its connections by marriage appear as names on a map of Le Cap and environs, made sometime in the early 1780s. ‘Rabié’ is written beside his “place à vivres” (a provisioning ground or country house and gardens) near the establishment of Les Pères de la Charité on the road leading out of the city.
The 1780 map shows a property with a dozen garden plots, three buildings arranged around a square, likely the main dwelling house, and a scatter of outbuildings, quarters for enslaved workers. According to a later description, the houses were made of stone with louvred shutters to let in cooling breezes. There was a spring that never failed even in the driest seasons, and a staff of eight or ten enslaved people to tend the gardens and house.1

A few years later in 1786 another map shows the Rotureau property near Limbé, and the Aubert plantation east of the Haut du Cap. And there now appears in the hills of Marmelade the holding of la Veuve Paparel, de Rabié’s widowed daughter.


Rene Gabriel de Rabié, Muscovy Duck and “Le Chevalier”, details, Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo, vol. 1, pls. 31, 52. Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library, https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_blackerwood_watercolour-painting-st-domingo_folioM9725R11_v1-20186/page/n64/mode/1up; https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_blackerwood_watercolour-painting-st-domingo_folioM9725R11_v1-20186/page/n106/mode/1up.
The Eldest Daughter
Jacquette Marie Anne grew up in Le Cap, likely in the de Rabié family house at 517, rue Notre-Dame, at the corner of rue Vaudreuil; she perhaps also spent time at the country house, reached by a cart road from the Chemin du Haut du Cap.
In 1766, when she was about 16, Jacquette Rabié married Claude François Paparel de la Boissière (c1740-71), a captain in the military in Saint Domingue. The Paparel family had acquired a coffee plantation in Marmelade in the mornes or high country south of Le Cap, which at the time could be reached only on horseback. According to the chronicler of Saint Domingue, Moreau St Méry, the climate was good and the soil fertile but in wet weather it could become the consistency of ‘marmelade’.
John Garrigus describes this area, not made a separate parish until 1773, as the ‘coffee frontier’:
“Many African captives took their first measure of Saint-Domingue in Cap Français, then were forced to walk to their enslaver’s estate. Heading south from the port city, newly arrived people bound for coffee slavery walked past cane fields where other enslaved Africans toiled. The flat land gave way to foot-hills, then mountains. This was the coffee frontier, where slaves labored to fulfill the dreams of colonists too poor or too poorly married to become sugar planters … In the 1770s, colonists forced slaves to cut a road still deeper into the mountains, widening a curved and twisting mule path … Deeper in the interior, the mountain chains ran from east to west, so newcomers had to climb and descend ridges, one after the other, until they entered the isolated parish of Marmelade … Enslaved people were forced to clear the land using axes and machetes, plant coffee bushes in rows along the slopes, and harvest the fruit that their enslavers hoped would make a fortune. It was cold and wet on the high slopes, and people’s clothes turned quickly to rags …”2

There is evidence to suggest that the Paparel family were among the poor colonists who acquired land in the area in the 1730s. The Paparel property was adjacent to that owned by Jean François Vincent de Montarcher (1730-83) who would marry Françoise Perrine Paparel de la Boissière, Claude François’s sister.
In early 1767, Paparel de la Boissière’s mother died, and in March he and de Montarcher advertised for sale her property in Le Cap. In September Paparel and Montarcher advertised together for an “Econome” (manager) to oversee their coffee plantations, and the following year, Montarcher and his wife left for France. Paparel de la Boissière followed his neighbour and sister to France, where he died in Paris in 1771.
There are almost no records of Jacquette’s married life, but on 13 May 1767 she gave birth to a son, Armand Gabriel François Paparel de la Boissière (1767-1854). After her husband’s death, her son, the four-year-old Armand Gabriel, became the ward of his grandfather, René Gabriel de Rabié. La Veuve Paparel returned to Le Cap, where she attended significant events in the life of her extended family, signing baptismal registers and witnessing marriages as “Rabié de la Boissière”.
She also participated in her father’s natural history enterprise. In June 1777 Rabié de la Boissière began to paint a series of watercolours based on her father’s bird paintings. There are 22 signed watercolours now preserved in the collections of the Muséum national de l’histoire naturelle in Paris, all painted between June 1777 and the end of October 1779, and based on works painted by her father between 1770 and 1778.3 Was she making copies in case the originals were lost? Was she learning how to paint, perhaps thinking of a new occupation?
In Paris
In 1782, Jacquette Rabié de la Boissière took her paintings with her when she left for Paris in the company of her son Armand Gabriel, but she kept in close touch with her father and her family’s interests in Saint Domingue. From 1782 on, the year when her father first became seriously ill, both de Rabié and his daughter wrote numerous letters demanding de Rabié’s preferment, leave, and an increase in salary. Her letters not only reveal her solicitude for her father, but also her own circumstances.
In January 1784, she wrote to the governor of Saint Domingue on behalf of her father, excusing her poor handwriting by reason that she had fallen off her horse, which had paralysed her tongue and her right hand, so that she was forced to write with her left. From this point on – she was just 34 – her health began to fail.
Her father retired and left Saint Domingue in the autumn of 1784. In Paris, he took lodgings with his daughter and her son at No. 27, Rue Mesle in the Third Arrondissement. By 11 February 1785, de Rabié wrote that his pension had already run out, and on 12 March he died. The next day Madame Rabié de la Boissière wrote to inform the Naval Ministry of the death of her father and to seek the money owed for his 43 years of service in Saint Domingue, for as she said, her father had left nothing but debts.4 (This was not strictly true, as he left an estate, which included his watercolours, valued at thousands of livres, including over 1800 livres in coin.5)
The death of her father and her limited resources likely forced Madame Rabié de la Boissière to return to Saint Domingue in 1786, presumably with Marie, the woman of colour who cared for her father in his last days. She still owned the Paparel coffee plantation, though she had received no income from the property when she was in France. From 1784 to 1785, Marmelade was at the heart of an epizootic of anthrax that killed animals and people, and was also the site of active resistance by enslaved workers to conditions on plantations, which included strikes and lawsuits. The area where the de Rabié place à vivres was located near Haut du Cap had also been subject to recurrent drought.
The Revolutions
The lives of the de Rabié family and those of countless others in France and the colonies were transformed by the firestorms of first the French and then the Haitian Revolutions. In France, Armand Gabriel Paparel de la Boissière had been recruited as a Second Lieutenant in the Infanterie Condé in 1788 at the age of 21. This was an aristocratic regiment, and after the events of 1789 he may have decided to return to his home in Saint Domingue, from frying pan to fire. First, insurrection broke out in the North of the colony in August 1791; by November, Port-au-Prince was ablaze. Revolts by enslaved peoples in the South and burning of plantations continued into 1792. As the situation in Saint Domingue became increasingly uncertain, hundreds of planters and merchants and their enslaved servants took ship for America. Paparel de la Boissière was among them, arriving in Philadelphia in spring 1793.

It is unclear whether his mother sailed with him, but it seems likely she followed her son to America. Both her brothers were dead in the conflicts in Saint Domingue, Pierre René Rabié in 1790, and Jean Joseph in November 1791, the latter perhaps killed in the conflagration and disorder of Port-au-Prince. Her sister, the widowed Louise Constance Rabié de Longuet may also have returned to Saint Domingue after 1786, but if so, she too fled the colony for the United States, settling in South Carolina, where on 22 May 1796, she married Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, the Baron de Nuits (1757-1801) in Edenton. Both were to perish in a shipwreck off the Azores on 11 November 1801.
In August 1793, Rabié de la Boissière witnessed the marriage of her son to his cousin Marie Louise Françoise Martine Aubert du Petit Thouars (1772-95) in Paris. In the autumn of 1793, when the Terror began, they may have decided it prudent to sail once again for Philadelphia, where Paparel de la Boissière’s daughter Anne Georgette was born in 1795, the same year his wife died on 27 September at the age of 23. He would not remarry for another thirty years.
By June 1801, Rabié de la Boissière was again in Paris, once again petitioning the Naval Ministry for additional funds, writing that she could not manage on the pension of 100 livres that she had been receiving since 1785, since she has received no revenues from her properties in Saint Domingue, and she was infirm, her right side paralysed. She is not successful in her appeal.6
Later Life
For ten years after 1801, Jacquette Rabié de la Boissière subsisted on her small pension and what must have been some support from her extended family, possibly through her daughter-in-law’s brother, Georges Aubert du Petit Thouars (1766-1816), a naval officer, whom she likely met in Philadelphia. In September 1811, once again in need of funds, she attempted to sell her father’s watercolours (and perhaps her own) to the Muséum d’histoire naturelle. Though the sale was refused by the curators, on 2 February 1814, the Ministre did authorize a payment of 300 livres to Madame Rabié de la Boissière, who all agreed was in great need.
By 1816, she was once again in need, bereft even of the amount required to live at Ste Perrine (Périne) de Chaillot, an institution established by the Empress Josephine for the indigent.
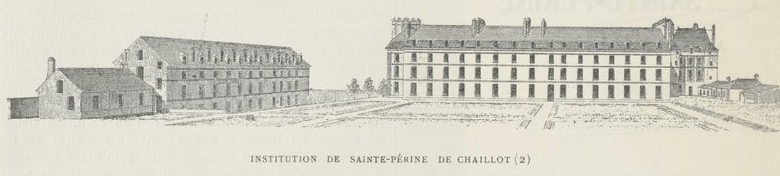
Jacquette Rabié de la Boissière was now 66 years old. In January 1819, she was forced to write again to the Ministry, enclosing a Certificat de Vie (Proof of Life) from the Mairie (City Hall) of the First Arrondissement, and testaments of her incapacity signed by two witnesses. A year later in March 1820, the doctor attached to Ste Perrine, M. Canuet, related that Madame Rabié de la Boissière could no longer leave her room, as she was paralysed and had two incurable lesions on her head. Rabié de la Boissière herself described her pitiful condition, confined day and nightot in a “fauteuil de douleur” (seat of pain) and requiring assistance with every action. She signed her letter in a nearly illegible hand. By 7 July 1820, she was dead.
There is no extant inventaire after Jacquette Rabié de la Boissière’s death in Sainte Perrine. Given her condition and her penury, there may have been little left. And yet, the watercolours she and her father painted in Saint Domingue remained, her father’s likely passed on to her son, and her own preserved in the collections of the Muséum, a legacy of their lives and the natural history of Sainte Domingue.
References
1 In 1790 M. Delahogue, who had acquired his Haut du Cap property, described it in Affiches Américaines : “Une habitation contenant dix sept carreaux de terre ou environ, ci-devant appartenante à M Rabié, sise près de l’Hôpital des pères de la Charité, sur laquelle il y a une belle grande case, plusieurs chambres y attenantes, fermées par une claire-voie, à la suite desquelles sont divers bâtiments & le tout en maçonnerie et à neuf, au milieu desquels passe une source qui ne tarit jamais, même dans les plus grands secs, et qui Ce rend dans un jardin potager, susceptible de revenu. Le Propriétaire y joindra huit ou dix têtes de Nègres qui sont sur ladite habitation, où il y a chemin de voiture, à vendre ou à affirmer”. Affiches Américaines, 27 février 1790, pp 749-50.
2 Garrigus, John D. A Secret among the Blacks: Slave Resistance before the Haitian Revolution, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2023, 121. https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.4159/9780674295094-002.
3 Recueil de 21 dessins d’oiseaux par Madame Laboissier. MNHN Cote: Ms 5030. The drawings are signed ‘Laboissier’ and located to Afrique du Sud (Le Cap) – corrected to Cap Haitien on Calames but not on the digitized records. To date only the rectos have been digitized.
4 For the correspondence, see ANOM Col E344, 216-220.
5 See Inventaire de Mr. Rabié, 17 mars 1785, MC/ET/XX/723, notaire Augustin Rameau.
6 ‘Aidée de quelques resources jusqu’a ce jour j’ai pu vivre avec cette faible pension quoique privée de tous mes revenus de St Domingue, d’apres le déchirement qui prouve cette colonie.’ (‘Aided by a few resources, up to now I have been able to live with this poor pension, even though deprived of all my revenues from St Domingue, after the ripping apart this colony has undergone.’) ANOM, Col E344, 252-255.
Voir l’essai
Née à Cap-Français, Saint-Domingue, le 17 mai 1750; morte à Paris le 7 juillet 1820
Fille aînée de René Gabriel de Rabié, Jacquette Anne Marie a contribué d’une main invisible au travail de son père dans le domaine de l’histoire naturelle. Elle a copié les peintures de René de Rabié et tenté de les préserver, d’abord en les offrant au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, puis en veillant à ce que son fils comprenne l’importance de l’héritage de son grand-père.
Une famille élargie
René Gabriel de Rabié (1717-1785) arrive à Saint-Domingue en 1742, à l’âge de 25 ans. En quelques années, il s’établit comme ingénieur à Cap-Français. C’est probablement là qu’il rencontre Anne Françoise Lebon, dite Lapointe (1718-avant 1780), issue d’une grande famille créole de Saint-Domingue (à Saint-Domingue au xviiie siècle, le terme « créole » désigne une personne née dans la colonie, que cette personne soit d’origine européenne, africaine ou métisse).
Leur première fille, Jacquette, naît en 1750. Une copie de son acte de baptême, conservé aux archives de la Marine, donne un aperçu des liens de la famille Lebon, notamment avec des membres des familles Rotureau et de Saint-Martin, propriétaires de plantations à Marmelade. Plus tard, une autre famille se joint par mariage au cercle Lebon-Saint Martin, les Aubert du Petit-Thouars, originaires de Saumur, en France. Une autre famille s’intègre par mariage au clan Saint-Martin : les Bullet.
Ce réseau dense de relations familiales façonne la vie de Jacquette de Rabié. En 1793, son fils Armand Gabriel François Paparel de la Boissière (1767-1854) épouse à Paris sa cousine Marie Louise Françoise Martine Aubert du Petit-Thouars (1772-1795). Plus de trente ans plus tard, Armand Gabriel, veuf, se remarie avec une autre cousine, Reine Antoinette de Bullet (1788-1851).
La famille élargie Lebon dite Lapointe comprenait également des membres décrits dans les actes de baptême comme « mulâtre » ou « mulâtresse » (personne de couleur) libre. Simon Lebon dit Lapointe, l’oncle d’Anne Lebon, a épousé une Africaine nommée Marie Castau; ils ont eu deux enfants, Louis (né en 1733) et Geneviève. Tous deux étaient décrits sur leurs certificats de mariage comme des personnes de couleur, et il était précisé qu’ils savaient lire et écrire, ce qui indiquait leur statut social.
Les biens familiaux
La famille de Rabié et les familles qui lui étaient unies par alliance apparaissent sur une carte du Cap et de ses environs, dressée au début des années 1780. Le nom « Rabié » est inscrit à côté de sa « place à vivres » (propriété agricole ou maison de campagne avec potagers) près de l’établissement des Pères de la Charité, sur la route qui mène hors de la ville.
La carte de 1780 montre un terrain comptant une douzaine de lots à cultiver, trois bâtiments disposés autour d’un carré, représentant probablement la maison principale, et quelques dépendances, les logements pour les travailleurs en esclavage. Selon une description ultérieure, les maisons étaient en pierre, avec des persiennes qui laissaient entrer une brise rafraîchissante. Une source d’eau sur la propriété ne tarissait jamais, même pendant les saisons les plus sèches, et huit ou dix esclaves s’occupaient des jardins et de la maison.1

Une carte datant de 1786, quelques années plus tard, montre la propriété Rotureau, près de Limbé, et la plantation Aubert à l’est de Haut-Du-Cap. On y voit maintenant la propriété de la veuve Paparel, fille de René Gabriel de Rabié, dans les collines de Marmelade.


René Gabriel de Rabié, canard de Barbarie et « Le Chevalier ». Détails. Original water-colour paintings on the natural history of St. Domingo, vol. 1, nos 31 et 52. Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill, https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_blackerwood_watercolour-painting-st-domingo_folioM9725R11_v1-20186/page/n64/mode/1up; https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_blackerwood_watercolour-painting-st-domingo_folioM9725R11_v1-20186/page/n106/mode/1up.
La fille aînée
Jacquette Anne Marie a grandi à Cap-Français, probablement dans la maison de la famille de Rabié, au 517, rue Notre-Dame, à l’angle de la rue Vaudreuil; elle a peut-être aussi séjourné dans la maison de campagne, accessible par une route charretière depuis le chemin du Haut du Cap.
En 1766, Jacquette Rabié, âgée d’environ 16 ans, épouse Claude François Paparel de la Boissière (vers 1740-1771), capitaine des forces militaires à Saint-Domingue. La famille Paparel avait acquis une plantation de café à Marmelade, dans les mornes, ou hautes terres au sud du Cap, qui à l’époque n’était accessible qu’à cheval. Selon Moreau de Saint-Méry, chroniqueur de Saint-Domingue, le climat était bon et le sol était fertile, mais par temps humide, la terre pouvait prendre la consistance d’une « marmelade ».
John Garrigus décrit cette région, qui n’est devenue une paroisse distincte qu’en 1773, comme la « frontière du café »:
“De nombreux captifs africains ont découvert Saint-Domingue à Cap-Français, avant d’être contraints de marcher jusqu’à la plantation de leur maître. En partant vers le sud depuis la ville portuaire, les nouveaux arrivants destinés à l’esclavage dans les plantations de café passaient devant des champs de canne à sucre où d’autres esclaves africains travaillaient dur. La plaine cédait la place à des collines, puis à des montagnes. C’était la frontière du café, où les esclaves travaillaient pour réaliser les rêves des colons trop pauvres ou trop mal mariés pour acquérir une plantation de canne à sucre (…) Dans les années 1770, les colons ont forcé les esclaves à creuser une route encore plus profonde dans les montagnes en élargissant un sentier muletier sinueux et tortueux (…) Plus à l’intérieur des terres, les chaînes de montagnes s’étendaient d’est en ouest, ce qui obligeait les nouveaux arrivants à gravir et à descendre des crêtes, les unes après les autres, jusqu’à ce qu’ils arrivent à la paroisse isolée de Marmelade (…) Les esclaves étaient contraints de défricher la terre à l’aide de haches et de machettes, de planter des caféiers en rangées le long des pentes et de récolter les fruits dont leurs propriétaires espéraient tirer une fortune. Il faisait froid et humide sur les hauteurs, et les vêtements se transformaient rapidement en haillons (…)2

Si l’on en croit certains documents, la famille Paparel faisait partie des colons pauvres qui, dans les années 1730, ont acquis des terres dans la région. La propriété Paparel était adjacente à celle de Jean François Vincent de Montarcher (1730-1783), qui épousera Françoise Perrine Paparel de la Boissière, sœur de Claude François.
En mars 1767, Françoise Perrine Paparel de la Boissière, dont la mère est morte au début de l’année, et Jean François de Montarcher mettent en vente sa propriété au Cap. En septembre, les époux publient ensemble une annonce pour recruter un « économe » (gérant) chargé de superviser leurs plantations de café. L’année suivante, de Montarcher et sa femme partent pour la France. Claude François Paparel de la Boissière suit son voisin et sa sœur en France, et il meurt à Paris en 1771.
Il n’existe pratiquement aucune trace de la vie conjugale de Jacquette, mais on sait que le 13 mai 1767, elle donne naissance à un fils, Armand Gabriel François Paparel de la Boissière (1767-1854). Après la mort de son mari, elle place ce fils, alors âgé de quatre ans, sous la tutelle de son grand-père, René Gabriel de Rabié. La veuve Paparel retourne au Cap, où elle assiste à des événements importants de la vie de sa famille élargie. Elle signe des registres de baptême et assiste à des mariages sous le nom de « Rabié de la Boissière ».
Elle participe également à l’œuvre naturaliste de son père. En juin 1777, elle commence à peindre une série d’aquarelles d’après les peintures d’oiseaux de René de Rabié. Le Muséum national de l’histoire naturelle à Paris conserve encore 22 aquarelles signées de sa main, toutes peintes entre juin 1777 et fin octobre 1779, et inspirées d’œuvres peintes par son père entre 1770 et 1778.3 Faisait-elle des copies au cas où les originaux seraient perdus? Apprenait-elle à peindre, pour explorer une nouvelle occupation?
À Paris
En 1782, Jacquette Rabié de la Boissière part pour Paris en compagnie de son fils Armand Gabriel, emportant ses peintures avec elle. Elle reste toutefois en contact étroit avec son père et les intérêts de sa famille à Saint-Domingue. À partir de 1782, année où son père tombe gravement malade, elle et sa fille échangent de nombreuses lettres pour demander que René de Rabié obtienne une promotion, un congé et une augmentation de salaire. Ses lettres révèlent sa sollicitude pour son père, mais aussi sa propre situation.
En janvier 1784, elle écrit au gouverneur de Saint-Domingue en faveur de son père. Elle demande qu’on lui pardonne sa mauvaise écriture, causée par une chute de cheval lui ayant paralysé la langue et la main droite et l’obligeant à écrire de la main gauche. Elle n’a alors que 34 ans, et sa santé commence déjà à décliner.
À l’automne 1784, son père prend sa retraite et quitte Saint-Domingue. Il s’installe avec sa fille et son petit-fils à Paris, au 27, rue Meslay, dans le troisième arrondissement. Le 11 février 1785, René de Rabié écrit que sa pension est déjà épuisée. Il meurt le 12 mars. Le lendemain, Jacquette Rabié de la Boissière écrit au ministère de la Marine pour l’informer du décès de son père et réclamer l’argent qui lui est dû pour ses 43 années de service à Saint-Domingue, car, selon elle, son père n’a laissé que des dettes (ce n’est pas tout à fait vrai, car il a laissé un héritage, qui comprend ses aquarelles, évaluées à plusieurs milliers de livres, et plus de 1 800 livres en pièces.)
En 1786, probablement en raison de la mort de son père et de ses ressources limitées, Jacquette Rabié de la Boissière est contrainte de retourner à Saint-Domingue, vraisemblablement avec Marie, la femme de couleur qui a pris soin de son père dans ses derniers jours. Elle est toujours propriétaire de la plantation de café Paparel, même si elle n’a perçu aucun revenu provenant de ce bien pendant son séjour en France. De 1784 à 1785, Marmelade avait été au cœur d’une épizootie de maladie du charbon tuant animaux et humains, en plus d’être le théâtre d’une résistance active des travailleurs en esclavage contre les conditions de travail dans les plantations, qui s’est traduite par des grèves et des procès. La zone où se trouve la place à vivres de la famille de Rabié, près de Haut-du-Cap, avait également été touchée par des sécheresses récurrentes.
Les révolutions
La vie de la famille de Rabié et celle d’innombrables autres personnes en France et dans les colonies sont bouleversées par les révolutions, d’abord en France, puis en Haïti. En France, en 1788, Armand Gabriel Paparel de la Boissière, alors âgé de 21 ans, est recruté comme sous-lieutenant dans l’infanterie Condé, un régiment aristocratique. Après les événements de 1789, il a peut-être décidé de retourner dans sa maison de Saint-Domingue, tombant ainsi de Charybde en Scylla. En août 1791, d’abord, une insurrection éclate dans le nord de la colonie. En novembre, un incendie fait rage à Port-au-Prince. Les révoltes d’esclaves dans le sud et les incendies dans les plantations se poursuivent jusqu’en 1792. Alors que la situation à Saint-Domingue devient de plus en plus incertaine, des centaines de planteurs et de marchands s’embarquent pour l’Amérique en compagnie de leurs esclaves. Paparel de la Boissière en fait partie. Il arrive à Philadelphie au printemps 1793.

Gravure de J.-B. Chapuy d’après J.-L. Boquet, 1795. Coll. Archives départementales de la Gironde, cote : 61 J 66/94.
On ne sait pas si sa mère prend le bateau avec lui, mais il semble probable qu’elle suit son fils en Amérique, ses deux frères étant morts dans les conflits à Saint-Domingue, Pierre René Rabié en 1790, et Jean Joseph en novembre 1791, peut-être tué dans l’incendie et les troubles de Port-au-Prince. Sa sœur veuve, Louise Constance Rabié de Longuet, est peut-être également retournée à Saint-Domingue après 1786, mais si tel est le cas, elle fuit elle aussi la colonie pour les États-Unis et s’installe en Caroline du Sud où, le 22 mai 1796, à Edenton, elle épouse Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, baron de Nuits (1757-1801). Tous deux périssent dans un naufrage au large des Açores le 11 novembre 1801.
En août 1793, Jacquette Rabié de la Boissière assiste à Paris au mariage de son fils avec la cousine de celui-ci, Marie Louise Françoise Martine Aubert du Petit-Thouars (1772-1795). C’est peut-être le début de la Terreur, à l’automne 1793, qui les décide à repartir pour Philadelphie, où la fille d’Armand Gabriel Paparel de la Boissière, Anne Georgette, naît en 1795. La femme d’Armand Gabriel meurt le 27 septembre de la même année, à l’âge de 23 ans. Le veuf ne se remarie que trente ans plus tard.
En juin 1801, Jacquette Rabié de la Boissière est de retour à Paris. Elle demande une nouvelle fois des fonds supplémentaires au ministère de la Marine, écrivant qu’elle ne peut pas vivre avec la pension de 100 livres qu’elle perçoit depuis 1785, car elle ne touche aucun revenu de ses propriétés à Saint-Domingue et qu’elle est infirme, paralysée du côté droit. Sa demande est rejetée.6
Fin de vie
Pendant les dix années qui suivent 1801, Jacquette Rabié de la Boissière vit de sa petite pension et de l’aide que lui apporte sans doute sa famille élargie, peut-être par l’intermédiaire du frère de sa belle-fille, Georges Aubert du Petit-Thouars (1766-1816), officier de marine qu’elle a probablement rencontré à Philadelphie. En septembre 1811, à nouveau dans le besoin, elle tente de vendre les aquarelles de son père (et peut-être les siennes) au Muséum d’histoire naturelle. Bien que les conservateurs refusent l’achat, le 2 février 1814, le ministre autorise le versement de 300 livres à Jacquette Rabié de la Boissière, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est dans le besoin.
En 1816, Jacquette se retrouve à nouveau dans le besoin, dépourvue même du montant nécessaire pour vivre à Sainte-Périne, rue de Chaillot, un établissement pour les démunis fondé par l’impératrice Joséphine.
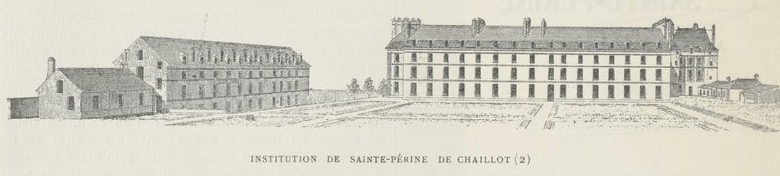
Jacquette Rabié de la Boissière est alors âgée de 66 ans. En janvier 1819, elle est contrainte d’écrire à nouveau au ministère, en joignant un certificat de vie délivré par la mairie du premier arrondissement, et des attestations d’incapacité signées par deux témoins. Un an plus tard, en mars 1820, le médecin de Sainte-Périne, M. Canuet, rapporte que Jacquette Rabié de la Boissière ne peut plus quitter sa chambre, car elle est paralysée et atteinte de deux lésions incurables à la tête. L’indigente décrit elle-même son état pitoyable, écrivant qu’elle est confinée jour et nuit dans un « fauteuil de douleur » et a besoin d’aide pour les plus petits gestes. Sa lettre est signée d’une écriture presque illisible. Elle meurt le 7 juillet.
Il ne subsiste aucun inventaire des biens de Jacquette Rabié de la Boissière après sa mort à Sainte-Périne. Compte tenu de son état et de sa pauvreté, elle n’a probablement pas laissé grand-chose. Pourtant, les aquarelles qu’elle et son père ont peintes à Saint-Domingue ont été conservées, celles de son père ayant probablement été transmises à son fils et les siennes, aux collections du Muséum. Ces œuvres témoignent de leur vie et de l’histoire naturelle de Saint-Domingue.
References
1 En 1790, M. Delahogue, qui avait acquis sa propriété de Haut-Du-Cap, la décrivait ainsi dans Affiches américaines : « Une habitation contenant dix sept carreaux de terre ou environ, ci-devant appartenante à M. Rabié, sise près de l’Hôpital des Pères de la Charité, sur laquelle il y a une belle grande case, plusieurs chambres y attenantes, fermées par une claire-voie, à la suite desquelles sont divers bâtiments; le tout en maçonnerie & à neuf, au milieu desquels passe une source qui ne tarit jamais, même dans les plus grands secs, & qui se rend dans un jardin potager, susceptible de revenu. Le Propriétaire y joindra huit ou dix têtes de Nègres qui sont sur ladite habitation, où il y a chemin de voiture, à vendre ou à affermer ». Affiches Américaines, 13 février 1790, pages 749-50.
2 Garrigus, John D. A Secret among the Blacks: Slave Resistance before the Haitian Revolution, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2023 (traduction), 121. https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.4159/9780674295094-002.
3 Recueil de 21 dessins d’oiseaux par Madame Laboissier. Cote MNHN : Ms 5030. Les dessins sont signés « Laboissier » et leur provenance indiquée est l’Afrique du Sud (Le Cap). Dans le catalogue Calames, une correction a été apportée et Cap-Haïtien est indiqué comme lieu de provenance, mais l’erreur subsiste dans les archives numérisées. À ce jour, seuls les rectos ont été numérisés.
4 Pour la correspondance, voir ANOM Col E344, 216-220.
5 Voir Inventaire de Mr. Rabié, 17 mars 1785, MC/ET/XX/723, notaire Augustin Rameau.
6 « Aidée de quelque ressource jusqu’à ce jour j’ai pu vivre avec cette faible pension quoique privée de tous mes revenus de St Domingue, d’après le déchirement qu’éprouve cette colonie. » ANOM, Col E344, 252-255.


